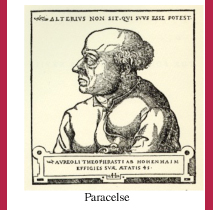En tant qu’objet iconotextuel, tout frontispice dramatique favorise une herméneutique où texte visuel et texte linguistique se lisent l’un à la lumière de l’autre. Si dans cet échange c’est le plus souvent le linguistique qui détermine la réception du visuel, il pourrait être enrichissant d’envisager une modalité de lecture de texte linguistique conditionnée par la lecture du texte visuel. Plus intéressant encore serait de rompre cette dialectique, d’élargir le cadre analytique et d’introduire le texte spectaculaire dans une lecture tryptique. Dans le cas de Tartuffe, considérer le texte iconographique en parallèle du texte spectaculaire et du texte dramatique (et vice versa), permet de mettre en relief tout un ensemble de mécanismes qui problématisent les attentes du lecteur/spectateur de cette pièce quant à la véritable identité de « l’imposteur ».
Cet article s’appuie sur le frontispice de Brissart pour l’édition de Tartuffe des Œuvres Complètes de Molière (1682), gravé par Jean Sauvé. Cette gravure liminaire s’inspire considérablement de celle attribuée à Chauveau qui illustrait l’édition de 1669 (Paris : Barbin)[1].
La gravure de Brissart représente une scène in medias res qui se déroule dans un intérieur bourgeois où l’on peut voir deux fenêtres sur le panneau décoratif côté jardin ainsi qu’un portrait et ce qui semble être une armoire sur celui du lointain centre. Trois personnages y figurent face centre: Elmire se tient près d’une table avec, à ses cotés, Tartuffe. Sous la table se trouve Orgon, qui semble sortir de sa cachette. Au bas de la gravure se trouve une légende « L’IMPOSTEUR ».
Brissart, Frontispicede Tartuffe des Œuvres Complètes de Molière (1682), gravé par Jean Sauvé
Précisément, qui est l’imposteur ? S’agit-il, dans le cadre définit par ce frontispice, de Tartuffe ? Pourrait-on, au contraire, imaginer que ce soit Orgon, maître des lieux, voire Elmire, bourgeoise aux apparences parfaites ? Sortant du cadre, ne pourrait-on pas aussi légitimement considérer ce dernier, le frontispice, comme imposteur ultime ? Serait-on en présence d’une imposture dans le texte visuel ou du texte visuel lui-même ? Le frontispice de Brissart est ainsi en mesure de déconstruire l’exégèse traditionnelle du texte dramatique de Molière selon laquelle l’imposteur serait d’évidence le personnage éponyme et antonomastique de la pièce.
Une recherche assez riche existe déjà sur les frontispices du XVIIe siècle avec, pour ne citer que quelques travaux, ceux de Francoise Siguret, Roger Herzel ou Georges Forestier, ou bien encore, et plus récemment, ceux de Michael Hawcroft, Abby Zanger ou Guy Spielmann. Ne réfutant aucune de ces études, cet article se veut néanmoins novateur en venant bousculer les idées reçues et présenter une perspective inédite, peut-être inattendue. En effet, même si certains de ces articles ont parfois remis en cause un personnage de Tartuffe traditionnellement perçu comme imposteur, notre article s’ancre au contraire pleinement dans la remise en question de l’apparente transparence de l’épigraphe et suggère ainsi une multiplicité d’imposteurs possibles. Notamment l’imposture d’Orgon et d’Elmire, mais aussi, celle ultime, du frontispice lui-même, offrant à l’instance réceptrice une nouvelle lecture iconoclaste des textes iconographiques et dramatiques.
Contrairement à ce qu’affirme Barthes, que le signe linguistique grâce à ses deux fonctions d’ « ancrage » et de « relais » permet d’aider l’instance réceptrice à choisir le bon niveau de lecture dans le texte visuel, l’épigraphe « L’imposteur », dans notre cas, rend le message linguistique ambigu par l’épanouissement de cette « chaîne flottante de signifiés » (44). Le signe linguistique ne fixe pas ici l’interprétation, il la rend plurielle, équivoque, et remet en cause les éléments de l’image au lieu d’en rendre la signification transparente.
Guidée par cette seule présence de l’épigraphe « L’imposteur », le spectateur/lecteur est délibérément lancé à la recherche de ce dernier et cherche à dévoiler sa véritable identité. Qui est l’imposteur ? L’exégèse traditionnelle pousse l’instance spectatrice vers le personnage principal, Tartuffe, dont le nom rentre rapidement dans le langage courant avec la définition d’ « hypocrite ». Or Tartuffe est-il le véritable imposteur comme on pourrait le croire ?
Dans son article « La vérité de l’hypocrite », Philippe Adrien questionne cette prétendue nature de faux dévot de Tartuffe. L’argumentation, tout à fait convaincante, révèle un Tartuffe pas si imposteur que l’on pourrait le croire. En effet, certains éléments du texte dramatique nous poussent, au contraire, à le considérer comme un homme pieux porté par une foi authentique. Certes, Acte V, scène 7, Elmire s’exclame « L’imposteur ! » (v.1885) et tout au long du texte, Dorine dépeint un Tartuffe hypocrite « Il passe pour un saint dans votre fantaisie / Tout son fait, croyez moi, n’est rien qu’hypocrisie » (I, 1), et influence l’instance réceptrice qui s’en tient à la réputation du célèbre satiriste du XVIIe siècle qui a longtemps dénoncé l’hypocrisie chez certains hommes d’Eglise. Cependant, comme le souligne légitimement Philippe Adrien, rien ne prouve que Tartuffe soit un faux dévot, si ce n’est « l’excès de son zèle » (46). Jamais Molière ne mentionne son absence de foi. Tartuffe est d’ailleurs « défini » par les personnages de l’action durant les deux premiers actes où il n’apparaît pas, et ne peut donc se défendre de ce dont il est peut-être injustement accusé. L’on pourrait considérer qu’il ait été « piégé » par ceux qui jalousent sa foi, et/ou sa relation avec le maître de maison. L’instance réceptrice accepte que les paroles proférées par Dorine soient les vraies. Or, pourquoi accepter les propos d’une domestique ? Parce que les gens du peuple des pièces de Molière font souvent preuve de bon sens ? Il semblerait que Tartuffe ne soit pas une comédie comme les autres, alors pourquoi ne pas considérer que Dorine soit une domestique atypique ?
De même, nous ne prenons aucune des éloges d’Orgon au sujet du protagoniste in absentia au sérieux parce que son personnage a lui aussi été stéréotypé par les comédies de Molière : il correspond au père de famille, le type même du monomaniaque. Adrien note qu’au cours des scènes précédant l’arrivée de Tartuffe, « le rire a pour fonction de nous délivrer de toute perplexité » (46). Dans cette position qui le détermine, Tartuffe doit alors se débattre, réaffirmer sa foi avec davantage de zèle pour convaincre ceux qui doutent désormais de lui.
En réalité, rien ne nous empêche de penser que Tartuffe incarne un personnage-symbole dont la voix serait la voie d’accès, justement, à la critique d’une société qui s’acquitterait du désordre de sa propre conduite en se jouant de ceux qui tenteraient de les rappeler à l’ordre. Car, ce sont bien les convictions de Madame Pernelle qui croit qu’ « il en irait bien mieux, si tout se gouvernait par ses ordres pieux », et que, s’adressant à sa famille elle affirme que « Vous lui voulez du mal et le rebutez / Qu’à cause qu’il vous dit à tous vos vérités. /C’est contre le péché que son cœur se courrouce, /Et l’intérêt du Ciel est tout ce qui le pousse » (I, 1).
Bousculant la lecture traditionnelle de Tartuffe, Adrien ne va pas pour autant jusqu’au bout de sa pensée puisque cette remise en cause s’arrête prématurément au personnage de Tartuffe. C’est précisément cette lecture iconoclaste, amorcée par Adrien, qu’il est important de faire aboutir afin de dévoiler tous les imposteurs réellement impliqués. Alors, si Tartuffe n’est pas cet imposteur tant recherché, de qui s’agit-il ?
Ne pourrait-il pas s’agir d’Elmire en ce qu’elle joue également le rôle de la séductrice pour mieux berner Tartuffe ? Ne peut-elle pas également être considérée comme imposteur par les défenseurs d’un schéma familial patriarcal puisqu’elle représente, à ce moment précis, le chef de famille ? C’est elle qui provoque le démasquement de Tartuffe puisque le piège est son idée ; elle est le principal actant. La grandeur de son statut se confirme au niveau de la scénographie puisqu’elle constitue le personnage central dans la gravure liminaire. Se tenant debout au milieu des deux hommes, Elmire organise cette embûche pour faire justice à sa famille. Comme le souligne Siguret, Elmire, « lumière entre deux ombres » (365), est le point de focalisation rayonnant dans la mise-en-scène ; elle est là pour être vue et faire voir. Elle apparaît comme source de vérité à travers laquelle l’illusion de l’imposteur sera enfin exposée au jour, et rompt les liens qui unissaient Tartuffe à Orgon. C’est elle-même qui désigne Tartuffe comme « imposteur ! » (V, 7, v.1885).
Et pourtant, elle est entrée dans son rôle de séductrice si naturellement qu’on pourrait penser que Tartuffe, « si pour être dévot, [il] n’en est pas moins homme » (III, 3), s’est tout simplement trouvé impuissant à repousser cette séductrice. Philippe Adrien éveille également le doute et devine « la tragédie intime d’un personnage » (46) lorsque Tartuffe se lamente à l’idée de rencontrer Elmire (« Hélas », III, 2, v.875). Pris entre les feux de l’amour et les feux de la foi, il ne sait plus vers quoi se tourner.
De plus, comme le souligne Siguret, Elmire signifie « l’hypocrite » (365) au sens grec du terme, et c’est exactement ce rôle qu’elle joue afin de démasquer l’hypothétique hypocrisie de Tartuffe; elle est elle-même imposteur à ce moment précis du drame. En effet, rien n’infirme qu’Elmire n’ait d’arrière-pensées lorsqu’elle élabore son embûche. Ne serait-elle pas simplement jalouse de l’attention que porte son mari à un inconnu, la délaissant sous son propre toit ?
Elmire se présente donc comme une hypocrite idéale, mais qu’en est-il d’Orgon ?
A son tour, Orgon peut facilement revêtir le rôle d’imposteur. De par sa présence sur le lieu même de l’embûche, il représente l’intrus, celui qui est introduit illégitimement. Si l’on considère son statut social, Orgon perd toute sa prestance de bourgeois, obligé de s’abaisser à se dissimuler sous la table. Déchu au rang et rôle de simple laquais ou valet, il est celui qui écoute aux portes. Par rapport à son statut familial, il perd son statut de chef de famille au profit d’Elmire. Il l’écoute, suit ses directives.
Comme nous l’avons vu, l’imposture de ces trois personnages se dévoilent peu à peu sous la loupe de cette analyse. Les doubles-[je]ux de Tartuffe, d’Elmire et d’Orgon s’inscrivent non seulement dans leur position dans l’espace scénique du frontispice, qui d’ailleurs met en scène la nouvelle hiérarchie qui s’établie entre eux, mais également dans la géographie des gestes et des regards, et des jeux de lumières.
Ces trois personnages s’organisent au niveau proxémique autour d’axes de lecture horizontaux et verticaux dessinant une géographie des gestes et des regards qui sont extrêmement riches en interprétations. Alors que la main gauche de chaque personnage, la senestre, est « retournée, collée à un lieu ou le drame prend appui » (Siguret, L’Image ou l’imposture 366) afin de mieux évoquer les secrets et les drames des protagonistes, la main droite, dans une danse révélatrice, présente au spectateur/lecteur la personne dans laquelle chacun voit ou voyait sa vérité. Elmire dans Orgon, Orgon dans Tartuffe et Tartuffe en Dieu. Siguret ajoute à ce propos « Les mains, en particulier, guident la circulation du regard à travers l’image muette et réaniment en dépit du tracé schématique et uniformisé des personnages, la scène figée de l’histoire » (Analyse des gravures 686).
En effet, tout aussi éloquent et symptomatique est le jeu triangulaire des regards des personnages. Celui-ci influence la lecture du spectateur, il impose un point de vue sur l’action qui se déroule, et enveloppe le regard du lecteur qui ne peut alors se détacher de la gravure. Cette géométrie des regards renforce le message linguistique qui, comme nous l’avons vu, ne fixe pas de manière définitive et certaine l’identité de l’imposteur. Elmire regarde Tartuffe, qui lui-même regarde Orgon, qui lui semble regarder Elmire, fermant ainsi la boucle. Qui est l’imposteur ? Tous semblent s’éprouver et se soupçonner.
Enfin, il est intéressant de noter que deux des personnages, Elmire et Tartuffe, tournent leur visage dans la direction opposée de leur corps et de leurs mains. Le spectateur/lecteur remarquera que ces deux personnages sont ceux qui, dans la pièce, jouent un double-je(u).
Les jeux de lumière, riches dans ce frontispice, renvoient à la notion de clair-obscur chère au baroque qui masque autant qu’il montre. Même si certains pourraient arguer que ce fait serait le résultat de la mauvaise qualité de l’imprimerie à l’époque, il se veut, selon nous, étrangement précis quant aux différentes zones touchées par ce procédé hypothétiquement involontaire. Dans son essai sur les frontispices de Molière, Donald Jackson relève d’ailleurs également la manière dont Brissart joue des contrastes comme d’un outil expressif. Ainsi, selon uncode chromatique bicoloresuivant les nuances de blanc et de noir les personnages sont tour-à-tour mis en relief : Elmire blanche sur un fond sombre, Tartuffe sombre sur un fond blanc. Le signifié inhérent à ce code chromatique renforce l’idée d’une identité duelle dans chacun des deux personnages. Elmire, bonne épouse, est également séductrice; Tartuffe lui, selon l’interprétation, oscille entre dévot et faux dévot. Le jeu des deux couleurs dévoile la position manichéenne du frontispice : le blanc et le noir, le bon et le mauvais, le bien et le mal, la chasteté et la luxure. Ce double-je(u) de lumière, de mains et de regards, ces premières en constante contradiction avec ces derniers, souligne cette imposture multiple.
La relation entre les textes linguistique, visuel et dramatique permet de remettre en cause l’idée reçue que le seul imposteur à démasquer est Tartuffe. En effet, si l’on peut considérer chaque personnage du frontispice comme vecteur potentiel d’imposture, il est également clairement envisageable, suivant les arguments soulevés dans cet article, que chacun d’entre eux puisse tout aussi bien être un imposteur[2]. Or, si l’on sort du cadre définit par l’illustration afin de considérer le frontispice lui-même, en tant qu’objet en soi et pour soi, ne pourrait-on pas également entrevoir une imposture ?
A première vue, le frontispice pourrait correspondre à la scène 5 de l’acte IV. Cependant, une lecture attentive du texte dramatique et un examen minutieux du texte visuel révèlent que la scène représentée dans le frontispice ne coïncide aucunement avec une scène du texte imprimé ; il s’agit plutôt de l’interprétation de trois scènes confondues.
En effet, dans la scène 4 de l’acte IV (v. 1362), Elmire enjoint son mari de se mettre sous la table : « Vous bien cacher est un point nécessaire ». Elle lui promet que grâce à ce subterfuge, elle aura raison de celui qui se prétend « homme de bien » : « Quoi que je puisse dire […] c’est pour vous convaincre […]. Je vais par des douceurs […] Faire poser le masque à cette âme hypocrite ». La scène 5, où Elmire fait montre de grands talents de séductrice, est la plus longue des quatre, et fait écho à la scène 3 de l’acte III, où Tartuffe avait alors tenté de la séduire. L’effet de chiasme souligne l’importance de ces deux scènes, à lire l’une à la lumière de l’autre. Elmire tente de faire tomber le masque de Tartuffe qui avait alors commencé à glisser. L’effet comique est ici réitéré par la toux indomptable d’Elmire qui lui sert de prétexte pour envoyer Tartuffe hors scène. Orgon sort de dessous la table à la scène 6, puis une didascalie décisive indique qu’Elmire « fait mettre son mari derrière elle ». Orgon n’est donc pas sous la table lorsque Tartuffe fait son entrée à la scène 7 et, ainsi, ne peut pas le prendre en flagrant délit, comme l’indique le frontispice.
Le frontispice n’est donc pas l’illustration du texte dramatique. Certaines disparités, ou mêmes incohérences, viennent remettre en question la gravure liminaire qui apparaît alors, à la lumière du texte imprimé, comme une véritable imposture. Mais qu’en est-il de la relation entre le frontispice et le texte spectaculaire ?
Cette relation gravures liminaires/texte spectaculaire a été l’une des approches les plus prolifiques parmi les critiques. Zanger, Herzel mais aussi Spielmann et Hawcroft, ont tous cherché à trouver des similitudes ou des dissemblances, sans pour autant connecter leurs résultats à la possible imposture du frontispice. L’article d’Herzel est un document essentiel pour notre analyse car il aborde précisément les différences de décor d’un même frontispice, celui de Tartuffe, effectué par deux artistes différents : Chauveau, puis Brissart quelques années plus tard. L’étude d’Herzel montre, entre autre, que Chauveau a certainement basé son dessin sur le décor existant de la pièce au moment de sa mise en scène, alors que Brissart a retravaillé la gravure à partir de celle de son prédécesseur.
Comparée à la version de Chauveau, celle de Brissart élimine un à un les éléments scéniques théâtraux. Ce sont les planches de la scène qui disparaissent au profit d’un sol unifié. Ce sont les moulures du plafond qui, non-alignées chez Chauveau, deviennent chez Brissart minutieusement rectilignes. « The result, inevitably, is that the background looks not like a stage setting but like an actual room, in which the side and back walls have identical projecting moldings that meet in a perfect mitered corner » (Herzel 939). Alors que Chauveau choisit de mettre l’accent sur la réalité du décor de théâtre, Brissart choisit, lui, de souligner la réalité de la salle de séjour, tout en prenant soin de changer l’épigraphe. Ce ne sera plus « Tartuffe » mais « L’imposteur ».
Même si ce frontispice fait tout pour prendre des allures d’intérieur bourgeois véritable, il reste néanmoins des éléments qui laissent entrevoir le monde du théâtre. En effet, alors que Brissart, au contraire de Chauveau, s’applique à gommer les références au décor de la performance scénique, il ajoute et retouche néanmoins quelques indices. Par exemple, la main gauche d’Orgon qui sort du cadre serait, selon Spielmann, un indice qui permet de rendre l’illusion que la gravure est une reproduction de la scène empirique au moment où la pièce s’est jouée ; indice sensé renvoyer à « sa réalisation scénique » plutôt qu’à la fiction (82). Posée à plat sur le sol de la salle de séjour ou plus exactement sur le bord de la scène, cette main interpelle le spectateur. Grâce au personnage-témoin d’Orgon, le spectateur n’est plus devant l’œuvre, il y est inclus. À l’instar de ces personnages admonesteurs recommandés jadis par Alberti, Orgon prend en charge le regard du spectateur, et le dirige; il acquiert le rôle d’embrayeur visuel, de relais, entre la scène et son spectateur. En effet, Alberti écrit qu’
Il est bon que dans une histoire il y ait quelqu’un qui avertisse les spectateurs de ce qui s’y passe ; que de la main il invite à regarder […], que par un visage menaçant ou des yeux farouches, il leur interdise d’approcher, ou qu’il leur indique qu’il y a là un danger ou une chose digne d’ admiration, ou encore que par ses gestes, il t’invite à rire ou à pleurer avec les personnages. (179)
Tout comme Spielmann, Zanger et Siguret mentionnent respectivement l’importance de ces « signifiers of performance » (29), de ces « intrusion[s] de la réalité théâtrale dans la représentation iconique » (Analyse des gravures 684) afin de garder dans l’esprit de l’instance spectatrice l’interprétation scénique.
Dans la même veine, le personnage d’Orgon, ou plus particulièrement son visage, se révèle être un autre indice significatif. Herzel observe qu’Orgon, sous le crayon de Brissart prend les traits de Molière (297). Selon lui, c’est une manière de remettre en contexte le personnage d’Orgon qui était toujours joué par Molière et ainsi de mettre l’emphase sur la performance davantage que sur le texte dramatique.
Michael Hawcroft, dans son essai « Le théâtre français du XVIIe siècle et le livre illustré »¸ observe qu’après la première moitié du XVIIe siècle, les illustrations représentent généralement un moment dramatique de l’action d’une pièce mais que, contrairement à certaines idées admises, si elles illustrent un moment identifiable, les composantes de l’image ne lui confèrent pas nécessairement « une réelle valeur de document » (327) : les éléments de décor, costumes et autres objets présents dans l’image ne font pas forcément référence à ceux de la scène actuelle.
Alors que ces illustrations représentent des traces non négligeables pour certains historiens du théâtre, Herzel confirme qu’elles peuvent être trompeuses. Dans son article, « The decor of Molière’s Stage : The Testimony of Brissart and Chauveau », il écrit qu’il est possible de recréer en partie le décor d’une scène de Molière en comparant les frontispices réalisés pour ses pièces avec les notes du décorateur Michel Laurent (927). Cependant, Herzel remarque que certains éléments sont omis, comme par exemple les spectateurs assis de chaque côté de la scène.
En outre, et puisque les illustrations devaient se conformer au format de la page du livre, un haut rectangle étroit, qui n’est pas d’ordinaire le format de la scène, Herzel ajoute que: « some of the engravings solve this problem by showing only one side of the stage, others […] by ignoring the wings and showing the actors against the center of the backdrop, and […] by positioning the actors very far downstage from the scenery” (932). La scène apparaît alors plus réaliste par rapport au décor initial (elle ressemble à une « vraie » pièce d’un intérieur bourgeois), mais elle est moins « réelle » (elle n’est plus celle de Molière). En ce qui concerne le sujet des illustrations, Herzel écrit qu’au contraire des éditions des tragédies du XVIIe siècle dont les frontispices dépeignent des évènements purement imaginatifs, les gravures réalisées pour les comédies mettent souvent en scène une action que les illustrateurs trouvaient particulièrement expressive durant la représentation (926).
Abby Zanger offre une perspective originale avec son étude sur les frontispices effectués pour les éditions du théâtre publié de Molière : elle soulève la spécificité particulière de ce type d’illustration qui s’érige comme lieu intermédiaire entre le texte imprimé d’une pièce de théâtre et sa représentation, et par conséquent doit renvoyer alternativement aux deux. Le frontispice contient à la fois des composantes de la fiction du texte dramatique, et s’efforce également de refléter les éléments scéniques, comme pour s’assurer que celui ou celle à qui elle est destinée, n’oublie pas qu’il s’agit bien de théâtre, d’une performance. Cependant, Zanger précise que contrairement à ses illustrations pour Racine et Corneille, celles que Chauveau a réalisées pour Molière sont fidèles aux textes spectaculaires : « It is as if Chauveau, so free in his interpretation of the texts of Corneille and Racine, does not dare take such liberties in the images he produces to illustrate Molière’s plays. […] That is because in illustrating Molière’s plays, rather than embellishing the story-line, translating if form the stage to the page for the reader by filling in necessary details, Chauveau (and its imitators) do not deviate from the playwright’s scenario. Instead, they capture a particular moment on stage » (28). Zanger note néanmoins une « divergence stylistique » dans le frontispice de Tartuffe qui décrit Orgon sortant de sa cachette. Elle considère que le moment aurait pu être exacerbé si l’illustrateur avait représenté Orgon bondissant sur Tartuffe. Au contraire, selon elle, l’illustrateur est resté fidèle au texte dramatique. Zanger semble négliger le fait qu’Orgon surprend Tartuffe dans un acte de séduction de sa femme (ou inversement) - digression importante par rapport au texte dramatique.
En admettant que cette dissonance soit davantage prise au sérieux, il est concevable que l’artiste se soit accordé une certaine liberté artistique. On peut également se demander s’il n’est pas probable que Chauveau ait assisté à un écart d’interprétation durant l’une des représentations où Molière et sa troupe auraient décidé de jouer leur pièce autrement ce soir-là. Guy Spielmann écrit d’ailleurs que, concernant les spectacles de foire, « ce qui se passait sur scène pouvant varier considérablement d’un jour à l’autre, il est impossible de systématiser ou d’idéaliser la relation entre les textes publiés et la performance » (78). En raison du nombre important des variations entre texte, image et performance, l’objectif du frontispice serait alors davantage de théâtraliser une image que d’en représenter une réalité performative. Tartuffe n’est pas un spectacle de foire, mais rien ne nous permet d’affirmer avec certitude que Molière, afin d’augmenter le comique des scènes de séduction entre Elmire et Tartuffe, n’a pas fait varier sa mise en scène de temps à autre. Puisqu’il a été établi que Chauveau aimait assister aux représentations (Herzel 926), il a pu être témoin de cet écart- bien que Zanger émettedes doutes sur le fait que Chauveau soit effectivement l’illustrateur initial du frontispice de Tartuffe (27).
Si le frontispice de Brissart peut légitiment être considéré comme une imposture vis-à-vis des textes dramatique et spectaculaire, deux questions légitimes se posent: pourquoi une telle imposture et quelles en sont les implications ?
Selon Hawcroft, une approche des gravures liminaires souvent négligée jusqu’à présent est celle qui met en relation le frontispice et le texte dramatique lui-même. Il observe avec justesse que les frontispices étaient, tout d’abord, destinés à l’instance lectrice des textes imprimés (325). Plusieurs fonctions primaires évidentes s’esquissent immédiatement quant à la présence d’un frontispice dans le texte dramatique. Tout comme Hawcroft le souligne aussi, les frontispices permettaient certainement l’accroissement de la renommé et de la réussite du texte dramatique, mais aussi de l’auteur et de l’éditeur (326). De plus, sur un marché de l’imprimerie difficile, enjoliver l’édition imprimée d’un frontispice permettait une augmentation notable des ventes (Zanger 26). Dans le cas du corpus de Molière, seulement ses œuvres les plus populaires étaient dotées de gravures liminaires.
Comme mentionné plus tôt, le frontispice réalisé par Brissart pour le Tartuffe de Molière ne correspond à aucune scène identifiable. Entre les deux textes iconographique et dramatique, indépendants l’un de l’autre, une relation ambiguë s’installe, comme un effet d’interpénétration qui nécessite attention, minutie et réflexion. Alors que Siguret ignore (in)volontairement que la scène représentée ne figure pas dans le texte dramatique, Hawcroft est, tout comme nous, intrigué par cette curieuse diffraction. Plusieurs exégèses et fonctions se dessinent d’emblée.
L’objet de la gravure est moins de représenter le texte dramatique que de captiver l’attention d’une audience : « l’illustration [semble] moins générée par le texte que le texte [n’est] commentaire d’une image » (Siguret, L’image ou l’imposture 362) ; le texte visuel occasionne une attente de la part du lecteur/spectateur qui cherche le moment où les textes (dramatiques, spectaculaire, iconique) se rencontrent.
Un autre type d’écart s’impose concernant les instances réceptrices. Parce que le lecteur du texte dramatique peut plus difficilement être berné ou lancé sur des fausses pistes que le serait le spectateur du texte spectaculaire, le frontispice tient ce rôle de déstabilisateur. Ainsi, la didascalie de Molière insérée à l’intérieur du dialogue de Tartuffe, Acte IV, scène 5, « C’est un scélérat qui parle » ne soulève aucune ambigüité chez le lecteur, mais elle garde au contraire le spectateur dans l’ignorance par son absence dans le texte spectaculaire. C’est ainsi pour palier à ce lecteur omniscient que le frontispice, imposteur, est introduit. Au lieu d’informer l’instance lectrice, ce dernier l’abreuve d’indices contradictoires voire chimériques. Jouant de son statut d’informateur stéréotypé, le frontispice exacerbe, séduit. Il entraîne le lecteur dans les méandres du caché, de l’illusion et du fantasmagorique, vers une nouvelle, troisième lecture de la pièce, une perspective que celui-ci n’aurait peut-être pas envisagée auparavant. Zanger ajoute d’ailleurs à cet effet « Frontispieces might organize or disorganize the reading experience » (27). Tout comme le texte spectaculaire, la gravure liminaire se joue de nos sens, manipule les perspectives, mêlent les lectures pour mieux nous conforter dans l’illusion. Si l’on considère que le frontispice est une imposture, alors le lecteur lui-même, s’il ne remet pas en cause l’illustration par rapport au texte dramatique, se fait abuser par la gravure liminaire, tout comme la famille d’Orgon soi-disant dupée par Tartuffe.
Considérant que toute image est un objet construit qui demande à être déconstruit, celle-ci est une invitation directe à « pénétrer » dans le livre, ou dans la salle. « Quand ces livres sont illustrés, il est du devoir du critique d’intégrer les illustrations à son interprétation du livre, car ce dernier met en place des interactions entre le lecteur, le texte, et l’image […]. Les lecteurs qui tentent véritablement de lire les illustrations de ces dramaturges […] peuvent saisir la complexité et la richesse des relations que les artistes engagent avec les textes, et, ce faisant, ils s’engagent eux-mêmes plus intimement avec les textes » (Hawcroft 339). L’instance réceptrice est donc invitée à examiner le dialogue entre les textes dramatiques, spectaculaires et iconiques, leur interprétation respective n’en sera que plus enrichie. Dans notre cas, cet échange crée une distance – bénéfique – qui remet en cause les idées reçues et autres stéréotypes aveuglant et paralysant l’esprit critique. Il revient donc à l’instance réceptrice de faire sens du choix de l’artiste d’unifier l’action de plusieurs scènes en un seul lieu et moment. Elle devra, entre autre, s’interroger sur la signification d’une telle discordance. Est-ce une manière de renforcer le statut ontologique du texte iconographique comme texte indépendant ? Brissart s’appuie t-il sur une didascalie, une indication à chercher dans le texte dramatique ? Interprète-t-il un thème, une relation entre des personnages, leur motivation ? Et pourquoi l’artiste choisit-il de stimuler plus encore le travail d’interprétation du récepteur en modifiant un indice supplémentaire, la légende qui s’avère, après réflexion, être déroutante ?
Une explication plausible serait, selon Hawcroft, une volonté de pimenter une scène trop statique. Siguret note également que Chauveau a généralement préféré les scènes dynamiques dans ses gravures de tragédies et de comédies pour au contraire illustrer, si ce n’est les scènes les plus violentes, du moins celles chargées d’intensité dramatique où les personnages sont dépassés par les situations (Analyse des gravures 681). Loin des scènes statiques et lentes, il favorisait les courses poursuites ou les surgissements. La rencontre des trois personnages de Tartuffe, Elmire et Orgon, en un même lieu à ce moment précis de la fable, est hautement susceptible d’inspirer des artistes comme Chauveau et Brissart. La gravure interprète un instant décisif – ou rendu décisif –, un moment culminant de l’action, un véritable « coup de théâtre » du texte dramatique puisqu’elle met en scène les trois personnages principaux, trois imposteurs, se jouant les uns des autres.
En combinant plusieurs scènes en une, Chauveau et Brissart créent justement un double coup de théâtre. D’une part, ils illustrent ce qui aurait pu être, et intensifient de ce fait la teneur dramatique et la puissance émotive d’un point culminant de l’action : c’est la scène du démasquement d’un imposteur, comme l’indique la légende (reste évidemment à savoir qui est l’imposteur). D’autre part, ils créent une attente du récepteur, attente qui se trouve déçue puisque le moment représenté n’existe pas. La gravure s’inscrit alors d’elle-même doublement comme une « fausse représentation » (Siguret, L’image ou l’imposture 363).
En une seule et même image, le frontispice présente ainsi aux lecteurs une séquence de moments distincts dont la chronologie est volontairement obscurcie. Siguret ajoute à cet effet « comme si [Brissart] voulait représenter sur la même gravure le passé, le présent et l’avenir » (L’image ou l’imposture 369). Hawcroft observe lui aussi ce procédé « Chauveau [et donc dans notre cas, Brissart] introduit dans son unique image bien des évènements, bien des émotions, « toute une histoire » (338). De manière plus prosaïque, cette représentation picturale pourrait prendre la place d’un « instantané » et avoir pour simple objectif de condenser « en une seule composition une série d’actes successifs dont l’exécution en scène prendrait plusieurs minutes » (Spielmann 81). Ce frontispice de Brissart est particulier puisqu’il amasse en son sein à la fois, et pour reprendre une terminologie de Hawcroft (327), une fonction proleptique, puisqu’il donne une indication sur les scènes [à]venir, et une fonction analeptique en ce qu’il permet de garder présente une scène du passé. L’illustration invite de cette manière le lecteur/spectateur à une lecture attentive du texte dramatique afin de décrypter, avec plus d’aisance, le dialogue qui s’instaure entre l’image, le texte et la performance (Hawcroft 326).
Or il est important à ce stade de l’analyse de signaler que cette conversation tripartite est plus complexe qu’il n’y paraît puisqu’elle implique différentes variations de lectures. En effet, l’on remarquera que la fonction signalétique du frontispice et sa signification diffèrent si l’instance réceptrice est confrontée ou non à ce texte visuel avant la connaissance du texte dramatique. L’interprétation de l’image est donc contingente de sa découverte par l’instance réceptrice, selon qu’elle représente un premier contact avec l’intrigue, suit sa représentation scénique et précède la lecture du texte dramatique, ou encore seconde la lecture de la pièce et/ou de sa mise en scène. A propos de la réception des textes dramatique et scénique, Jean-Claude Vuillemin dans son article « En finir avec Boileau… Quelques réflexions sur l’enseignement du théâtre “classique” », insiste sur trois modalités de lecture auxquelles il attribue trois fonctions en mesure d’affecter la réception du lecteur/spectateur. Appliquées à notre analyse, nous avons le cas où l’instance réceptrice a lu la pièce de théâtre avant de voir le frontispice, le texte dramatique « de manière rétroactive, [aura] un impact a posteriori sur la réception » du frontispice, et aura donc une « fonction correctrice » (141). Il indiquera éventuellement au récepteur les identités des personnages du frontispice, et qui est l’imposteur. Dans le cas où l’instance réceptrice a vu le frontispice avant de lire la pièce, les signes émis par la gravure « conditionneront la réception du texte [dramatique] et influenceront à divers degrés l’interprétation des systèmes signifiants textuels : l’on parlera ici de fonction génératrice » (141). Sorte de mise en bouche iconographique, le frontispice éveille l’intérêt de l’instance réceptrice. Ainsi, selon le rapport linéaire et hiérarchique choisi par le lecteur/spectateur, de nouvelles interprétations seront générées :
Cependant, quelque soit l’axe de lecture envisagé, et les différentes exégèses avancées quand à la fonctionnalité du frontispice, ce dernier ne peut-il pas être tout aussi bien appréhendé et constituer un texte autonome en lui-même, pour lui-même ?
1) texte imprimé/production scénique/frontispice
2) texte imprimé/frontispice/production scénique
3) frontispice / texte imprimé/production scénique
4) frontispice/production scénique/texte imprimé
5) production scénique/frontispice/texte imprimé
6) production scénique/texte imprimé/frontispice
Même si tout lecteur et spectateur s’entendent sur le fait que le théâtre est le lieu de constructions, de subterfuges et d’illusions, ces derniers se méfient moins de l’image qui leur apparaît transparente. Nous devons combattre ce cliché du milieu du XXe siècle qui associe frénétiquement la gravure au réalisme. Zanger ajoute « thus if the actor’s face resembles that of Molière, if the costume looks like one described among Molière’s possessions on his death, or if there are elements of staging that match the incidence of certain decors in the plays, then the images are automatically assumed to be accurately reproducing the original stage event » (31). Dans le cas de la gravure liminaire de Brissart, le frontispice se dénonce lui-même en arborant ce titre provocateur. C’est précisément grâce à ce stéréotype évoqué plus tôt, que les analyses précédentes ont négligé de remettre en cause la gravure elle-même. Penser que l’épigraphe du frontispice concernait en réalité l’œuvre iconographique en tant que telle n’avait pas été envisagé. Suivant la veine foucaldienne et la pensée que Magritte établit avec son tableau « ceci n’est pas une pipe », cet article montre comment le frontispice lui-même s’auto-définit « ceci n’est pas la réalité, une copie du texte spectaculaire ou dramatique, ceci est une "imposture" ». Toute image est représentation et pour cela « imposture » par rapport à la « réalité ». Le frontispice s’affirme donc en tant qu’imposture par rapport aux textes spectaculaire et dramatique comme pour mieux défendre sa propre nature et autonomie. Par ailleurs, la pièce de théâtre, dit Herzel, tourne autour de l’un des plus triviaux conflits de tous les temps, la conquête et le control du territoire (935). Il ajoute que le paroxysme de la pièce advient lorsque que toute la famille d’Orgon est sur le point de finir à la rue. C’est dans cette même lutte du territoire que s’inscrit le frontispice. Ni texte spectaculaire, ni texte dramatique, il revendique son propre territoire, sa propre autonomie.
Les frontispices s’affirment en tant que supplément indépendant, un troisième texte qui vient bousculer la dichotomie trop rigide qui s’opère entre texte dramatique et texte spectaculaire.
Selon Zanger, le frontispice représente ce seuil entre le texte dramatique et le texte spectaculaire, une sorte de tiers-lieu, « a site in which performance and publication might be said to converge around the depiction of a visual moment common to both experiences. […] As a threshold, these preliminary engravings do not translate one media into another. Rather, by their very nature as being neither stage acting nor print words but betwixt and between two visual media, gravures liminaires of printed plays provide a site for problematizing not only their own position, but that of the forms for which they serve as threshold » (25).
Roger Chartier, quant à lui, part d’une perspective différente lorsqu’il écrit que les gravures et frontispices sont des dispositifs « pour réduire la distance entre la scène et la page » (44). Cependant, de même que Zanger ouvre une porte sur une nouvelle perspective et s’arrête trop vite sur son seuil, il est tout aussi pertinent de se demander si la distance dont parle Chartier, n’est pas au contraire accrue lorsque la signification entre les textes dramatique et spectaculaire est loin d’être transparente. En effet, si une image illustrant un texte menace de déjouer son interprétation, il faut admettre qu’elle renvoie à autre chose qu’aux textes dramatiques et spectaculaires dont elle s’inspire. Comme nous l’avons montré, le frontispice ne revendique plus un statut de documentaire de l’événement scénique, ni de l’action telle qu’elle a été écrite dans la pièce. D’une part, nous avons vu que ces dissonances incitent l’instance réceptrice à questionner la transparence supposée du texte iconique, et par extension, celle des textes dramatique et spectaculaire. D’autre part, l’illustration permet de remettre en cause une perception première et de susciter l’imagination du récepteur en renvoyant à une autre image, plus abstraite, thématique, voire imaginaire.
L’ambigüité qui caractérise le frontispice, et ce à quoi il pourrait peut-être renvoyer, invoque cependant un autre phénomène : si le frontispice s’affirme en tant que supplément indépendant de tout texte, dramatique et spectaculaire, il n’a plus alors pour fonction de réparer la perte (selon Herzel) d’une quelconque « traduction » de la page à la scène ; si chaque texte (linguistique, spectaculaire, iconique) est considéré dans sa pleine autonomie, l’on ne peut plus raisonnablement parler de « perte ». Cela reviendrait à considérer un lien de dépendance entre les divers textes qu’impliquerait la « traduction » d’un art à un autre, et dont les modifications seraient invariablement percues comme néfastes.
Il est maintenant admis que l’idée d’une traduction littérale d’un médium à un autre est un oxymore, et que la traduction est un texte à part entière. Lechangement inhérent au processus de transposition qu’implique toute « traduction », interdit en même temps tout discours, qui s’inscrirait en termes de gain ou de perte ; et attendu que ces discours s’accompagnent inévitablement de jugements de valeur, ils sont préjudiciables. Le fait que toute traduction s’accompagne de changements est indéniable, il semblerait alors plus intéressant, et surtout légitime, de juger un texte en fonction du support par lequel il se donne à voir et de l’apprécier en tant que tel : « the translation is not some fixed nontextual meaning to be copied or paraphrased or reproduced; rather, it is an engagement with the original text that makes us see that text in different ways » (Hutcheon 16). Nous avons vu que le frontispice de Brissart ne renvoie pas au texte dramatique de Molière et qu’il est impossible de dire s’il reflète effectivement un texte spectaculaire particulier. Il a également été établi qu’il ne fonctionne ni comme transition, ni ne réduit la distance entre les deux, mais qu’au contraire il tend à accroître cette distance.
Afin de se distancer du terme de traduction, Linda Hutcheon favorise le concept d’adaptation comme formule et moyen de revisiter des textes antérieurs. Il est certainement difficile d’ignorer les indices du frontispice de Brissart renvoyant aux textes dont il s’inspire lorsque ceux-ci restent « visibles » :traits de Molière dans la gravure de Brissart et signifiants scéniques dans celle attribuée à Chauveau, par exemple. Cependant, envisager les gravures liminaires comme des adaptations relativise encore l’autonomie du texte iconique. Le terme d’adaptation implique un lien encore trop étroit entre les différents textes, une relation intrinsèque, prévenant l’illustration de revendiquer un véritable statut d’œuvre autonome.
En effet, ce processus a tendance à se faire au détriment du comparé, et l’appréciation du nouvel objet se fait souvent à partir de critères de fidélité par rapport au premier. Or, tout processus d’adaptation requiert le transcodage d’une série de conventions d’un médium à un autre, et s’attendre à une quelconque fidélité, de moyen comme de substance, reviendrait à nier l’opération dans son ensemble, car celle-ci ne se fait pas sans modifications, aussi minimes soient-elles, du(es) texte(s) « adapté(s) ». Ces transformations sont le résultat d’une sélection qui, nécessairement, implique l’exclusion d’une partie de l’hypotexte. Dans certains cas, la construction de l’hypertexte est moins affectée au plan du contenu que sur celui de la forme, c’est le cas de certains frontispices qui représentent une scène aisément identifiable dans les textes dramatique et/ou spectaculaire. Cependant, même lorsque cela s’avère apparemment être le cas, certains aspects de composition de l’illustration n’empêche toujours pas cette réflexivité, à l’instar des « instantané » dont l’illusion [est] aussi trompeuse que celle des clichés de plateau de cinéma, qui ne correspondent pas à ceux qu’on voit à l’écran » (Spielmann 81).
Traduction et adaptation n’ont plus lieu de s’appliquer au texte iconique puisqu’il constitue un moyen d’expression dont les spécificités sont irréductibles à tout autre. Si le frontispice se trouve en un tiers lieu, il ne s’est pas contenté de transporter une action de la scène à l’écran: son sujet n’est plus celui de la pièce, mais le sien, avec des choix de mise en scène, de composition qui lui sont spécifiques. Il convient ainsi d’appréhender le frontispice comme une forme supplémentaire et en même temps nécessairement distincte des textes théâtraux, sorte de mise en abyme de ses représentations à l’intérieur d’un autre système dramatique ; et même si le frontispice de Tartuffe a peut-être permis de préserver une mémoire d’un texte spectaculaire différent du texte dramatique, il reste néanmoins un texte unique.
Le rapport du frontispice de Brissart aux textes spectaculaire et dramatique est véritablement plus complexe qu’il n’y paraît, « le théâtre ne peut être exactement fixé ni dans le jeu, ni par l’écriture, ni, évidemment, lors de sa réception » (Biet 65). C’est ce qui permet le « jeu » ou « double jeu » des interprétations ; la « lecture idéale du théâtre […], reste, malgré tout, imperméable à la volonté monosémique, parce que c’est aussi la polysémie, l’équivoque et l’ambigüité qui intéressent les lecteurs » (59).
Sans une lecture critique, l’instance réceptrice est aisément abusée par une image qui pourrait sembler « fidèle » de par son caractère souvent inductif. En effet, le frontispice pour Tartuffe, bien que vieux de 300 ans, continue de défier les idées reçues. Puisque le nom propre « Tartuffe » est rentré dans le langage courant, le lecteur/spectateur contraint par la « fonction génératrice » dont parle Vuillemin, avant même de lire/voir les textes dramatique/spectaculaires, admet d’emblée que le personnage principal est un faux dévot, et suppose que le titre de la pièce désigne uniquement le personnage de Tartuffe. Cette liberté de lecture est encore ce qui fait la richesse des textes (dramatique, spectaculaire, iconique, etc.), qui leur permet de rester vivants, et les empêchent de sombrer dans le carcan des stéréotypes. Les textes et leur significations échappent constamment à l’auteur, et leur polysémie favorise une herméneutique « ouverte » du/au récepteur.
Notre analyse montre que l’épigraphe ne renseigne pas l’instance réceptrice sur l’identité de l’imposteur, mais qu’elle introduit au contraire une multitude d’imposteurs, Tartuffe, Orgon, et Elmire, déconstruisant par là-même l’exégèse traditionnelle. Notre article démontre surtout que l’ultime imposture ne se trouve pas à l’intérieur du cadre, dans le frontispice mais est le frontispice lui-même. L’image, lue à la lumière du texte linguistique et des indices spectaculaires, n’est pas aussi transparente qu’on pourrait a priori le croire. Afin d’interpréter le message de la gravure, l’instance réceptrice doit considérer son double support, iconique et linguistique.
Pennsylvania State University
OUVRAGES CITÉS
Adrien, Philippe. « La vérité de l’hypocrite. » Le Discours psychanalytique (déc. 1983) : 44–47.
Alberti, Battista.De Pictura, in Jean-Claude Vuillemin, « Réflexions sur la réflexivité théâtrale », p. 7.
Barthes, Roland. « Rhétorique de l’image. » Communications 4 (1964) : 40–51.
Biet, Christian. « « C’est un scélérat qui parle » : Lire, Ecrire, Publier, Représenter, Interpréter le Théâtre au XVIIe siècle. » Du Spectateur au lecteur : Imprimer la scène aux XVIe et XVIIe siècles. Ed. Larry F. Norman, Philippe Desan et Richard Strier. Paris : Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2002 : 55–83.
Chartier, Roger. « « Coppied onely by the eare » : Le texte de théâtre entre la scène et la page au XVIIe siècle. » Du Spectateur au lecteur : Imprimer la scène aux XVIe et XVIIe siècles. Ed. Larry F. Norman, Philippe Desan et Richard Strier. Paris : Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2002 : 30–53.
Forestier, Georges. « Du spectacle au texte: les pratiques d’impression du texte de théâtre au XVIIe siècle. »Du Spectateur au lecteur : Imprimer la scène aux XVIe et XVIIe siècles. Ed. Larry F. Norman, Philippe Desan et Richard Strier. Paris : Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2002 : 85–110.
Foucault, Michel. Ceci n’est pas une pipe. Montpellier : Fata Morgana, 1973.
Hawcroft, Michael. « Le théâtre français du XVIIe siècle et le livre illustré. » Du Spectateur au lecteur : Imprimer la scène aux XVIe et XVIIe siècles. Ed. Larry F. Norman, Philippe Desan et Richard Strier. Paris : Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2002 : 317–348.
Herzel, Roger. « The Decor of Moliere’s Stage: The Testimony of Brissart and Chauveau. » PMLA, 93, 5 (Oct. 1978) : 925–954.
Hutcheon, Linda. A Theory of Adaptation. New York : Routledge, 2006.
Jackson, Donald. « Les frontispices des éditions de Molière parues au XVIIe siècle. Stéréotypes et expressivité. » Papers in French Seventeenth Century Literature, 26 (1987) : 37–59.
Siguret, Françoise. « Analyses des gravures illustrant l’édition des œuvres de Pierre Corneille. » Pierre Corneille, Actes du Colloque. Paris : Presses universitaires de France (1985) : 679-687.
———. « L’image ou l’imposture : analyse d’une gravure illustrant Le Tartuffe. » Revue d’Histoire du théâtre 36 (1984) : 362–369.
Spielmann, Guy. « Problématique de l’iconographie des spectacles sous l’ancien régime : le cas des frontispices du Théâtre de la foire (1721–37). » Revue d’Histoire du Théâtre 237 (2008) : 77–86.
Vuillemin, Jean-Claude. « En finir avec Boileau… quelques réflexions sur l’enseignement du théâtre classique. »Revue d’Histoire du Théâtre 209 (2001) : 125–146.
———. « Réflexions sur la réflexivité théâtrale. »L'Annuaire théâtral 45 (2010) :119–35.
Zanger, Abby. « On the threshold of print and performance: how prints mattered to body of/at work in Molière’s published corpus. » Word & Image, 17, 1-2, (2001) : 25–41.