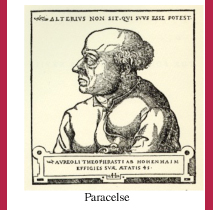Dans les premiers Temps modernes (XVIe– XVIIIe siècles), la philosophie informe a priori la médecine dans un très grand nombre de cas et pour un très grand nombre de médecins, en particulier ceux de la faculté de Paris, qui sont pour la plupart mécanistes, c’est-à-dire disciples de Descartes (infra). Dans la cinquième partie du Discours de la méthode (1637), le philosophe qui, sans être médecin, avait pourtant de bonnes notions de cette science, a énoncé les principes fondamentaux du mécanisme :
Ce qui[1]ne semblera nullement étrange à ceux qui, sachant combien de divers automates, ou machines mouvantes, l’industrie des hommes peut faire sans y employer que fort peu de pièces, à comparaison de la grande multitude des os, des artères, des veines, et de toutes les autres parties qui sont dans le corps de chaque animal, considéreront ce corps une machine qui, ayant été faite des mains de Dieu, est incomparablement mieux ordonnée, et a en soi des mouvements plus admirables qu’aucune de celles qui peuvent être inventées par les hommes (Discours de la méthode 78–79).
Il réitérera sa position dans une lettre à Mersenne, datée du 20 février 1639 :
La multitude et l’ordre des nerfs, des veines, des os et des autres parties d’un animal ne montre point que la nature n’est pas suffisante pour les former, pourvu qu’on suppose que cette nature agit en tout suivant les lois exactes des mécaniques, et que c’est Dieu qui lui a imposé ces lois. […] [J]e n’y[2] ai trouvé aucune chose dont je ne pense pouvoir expliquer la formation par des causes naturelles […] (Œuvres 1050).[3]
Qui dit médecine mécaniste, dit diagnostic et traitement mécanistes. Mais qu’est-ce que le iatromécanisme ? C’est un terme qui apparaît en fait au XVIIIe siècle (bien que les pratiques médicales fondées sur le mécanisme de Descartes datent de bien plus tôt) et qui dérive lui-même du terme mécanisme, défini en 1701 dans la deuxième édition du Dictionnaire Universel de Furetière (1re édition 1690) en ces termes : « ‘[S]tructure d’un organisme naturel ou artificiel et action combinée de ses parties’. Très vite le terme mécanisme revêt un sens philosophique plus large selon lequel le mécanisme est l’opinion qui admet que tout dans la nature est produit par les propriétés mécaniques de la matière »[4]. On peut donc dire que le iatromécanisme est une doctrine médicale et physiologique qui enseigne que la matière vivante fonctionne selon les lois de la mécanique. Parmi les premiers iatromécanistes formels ont été l’Italien Giorgio Baglivi[5](1668–1707), l’Écossais Archibald Pitcairne (1652–1713) et le Français Philippe Hecquet (1661–1737).
Semblablement, les iatrochimistes traiteront leurs patients en conséquence de leurs engagements idéologiques. Le iatrochimisme a été conçu par le Suisse Paracelse (1493–1541)[6], qui redécouvre les philosophies néoplatonicienne, hermétique et atomiste de la nature (Brockliss & Jones 119). Le système échafaudé par Paracelse, fondé sur l’observation directe plutôt que sur l’autorité des Anciens, est mis en forme selon un système cohérent par le célèbre anatomiste et physiologiste néerlandais François de Le Boë, dit Sylvius (1614–1672). Ce dernier suppose un corps subtil mais matériel qui règle et dirige les réactions chimiques dans l’organisme humain, dont les fermentations, les effervescences et autres phénomènes sont la manifestation. Selon lui, la maladie est due à un déséquilibre entre l’acidité et l’alcalinité des humeurs, lequel déséquilibre doit être corrigé chimiquement. En conséquence, les remèdes chimiques visent à rétablir l’harmonie entre l’acide et l’alcalin. On en présentera en exemple la « corne de cerf préparée philosophiquement ». Voici comment se fait cette préparation : « on prend des morceaux de corne de cerf ; on les arrange dans le chapiteau d’un alembic, où l’on fait distiller quelque herbe, & après avoir remis le chapiteau, on laisse ainsi ces morceaux de corne à la vapeur de l’alembic, laquelle les ramollit considérablement[7]. »
La source primaire dont je me sers dans cette étude consiste en les cinquante premières années du Journal Des Sçavans, c’est-à-dire les numéros sortis durant le règne de Louis XIV, depuis le début de parution en 1665 jusqu’en 1715, date la mort du Roi-Soleil. Adoptant une approche thématique, je poserai la question suivante : de quelles maladies souffrait-on au XVIIe siècle et comment est-ce qu’on les traitait ? La réponse à la première partie ne comporte pas de difficultés particulières : celles qui retiennent en premier l’attention des médecins ainsi que des chroniqueurs et mémorialistes sont les épidémies, l’épidémie de peste qui ravage la France en 1628–1629 et de nouveau en 1634[8], puis qui frappe l’Angleterre en 1665[9](la Grande Peste de Londres), ensuite celle d’Autriche et de Bohême en 1679, dite peste d’Allemagne, dont je parlerai plus bas. Si elles causaient d’immenses ravages dans les populations européennes aux XVIIe et XVIIIe siècles, elles n’y existent plus de nos jours, du moins sous cette forme[10]. Par ailleurs, les maladies individuelles, chroniques ou non, étaient sans doute à peu près les mêmes qu’aujourd’hui (à part peut-être le Sida, mais certainement, depuis au moins le XVIe siècle, la syphilis et autres maladies sexuellement transmissibles), encore que les possibilités de diagnostic dont étaient capables les praticiens du XVIIe siècle fussent sérieusement réduites par rapport à celles dont on dispose de nos jours. On peut citer en exemple les causes de décès dans la commune de Plougonver[11]entre 1640 et 1660 (Brockliss & Jones 51)[12]. Les plus fréquentes, par ordre d’importance, sont dues à des maladies respiratoires. Viennent ensuite diverses fièvres, puis la vieillesse, les troubles digestifs (l’hydropisie y est comprise), les traumatismes, la dysenterie, la variole, diverses infirmités, apoplexies et morts subites, le paludisme, les cancers, enfin diverses causes non identifiées. A part les maladies infectieuses dues à des conditions d’hygiène douteuses comme la dysenterie, largement éliminées aujourd’hui en Europe, on peut voir que les gens souffraient plus ou moins de ce dont ils continuent à souffrir aujourd’hui.
Pour en revenir au Journal Des Sçavans, je mentionnerai des affections les plus communément rapportées par les médecins de l’époque dans cette publication. Il semble bien que les tumeurs attirassent l’attention par leur « visibilité », si l’on peut dire. Je relève au moins cinq articles sur ce sujet, dont le plus détaillé est rapporté dans le numéro du 6 août 1691[13]. Il s’agit d’une étude par le médecin Jean-Adrien Helvétius[14] : celui-ci est un praticien hollandais qui pense que l’origine du cancer est « une petite coagulation de quelque goutte d’humeur dans une glande, & que cette coagulation se peut faire ou par la seule disposition de deux humeurs qui se rencontrent, ou par quelque accident exterieur. » (345). L’article du Journal Des Sçavans implique qu’il est moderne (« ...une idée des Cancers bien différente de celle des anciens, & beaucoup plus propre à nous satisfaire. ») En dépit de l’erreur (en 1691 on ne connaît pas encore la nature cellulaire des tissus, malgré l’existence de microscopes capables d’identifier les cellules), il note que beaucoup de cancers sont dus à un traumatisme. Il reconnaît également que plus tôt le cancer est identifié, plus il est traitable. Il reconnaît également la métastase du cancer, qu’il appelle le « levain ».
Méthodes de traitement:
Si l’humeur n’est pas encore durcie, la dissoudre ou la consumer par quelque remède caustique.
Si l’humeur est complètement durcie, il faut se garder d’appliquer quelque remède que ce soit, de peur d’en disperser le levain (danger de métastase); il faut extirper la tumeur.
La mastectomie radicale n’est pas inconnue, mais il reconnaît que si le cancer s’est communiqué aux ganglions lymphatiques du thorax, la guérison n’est plus possible. L’article mentionne également l’opération du cancer sur une Anglaise à Paris, sans dire au juste de quel cancer il s’agit, mais il est possible que ce soit celui du sein[15]. Le chirurgien choisi pour l’opération est La Vergne, premier chirurgien de Mademoiselle[16]. L’opération a lieu en public et consiste en l’extirpation de la tumeur, qui ne semble pas s’être métastasée. Après l’opération la plaie est pansée et la totale guérison semble s’en être suivie. Helvétius a même inventé une pince spéciale pour opérer les tissus cancéreux.
Les affections urologiques, principalement la pierre (calculs de la vessie) préoccupent aussi beaucoup la Faculté : je relève au moins huit articles traitant de cette affliction, avec des détails sur les opérations (opération de la taille) effectuées pour soulager le (ou la) malade, le plus détaillé étant celui qui apparaît dans le numéro du 1er février 1700[17]. Il rapporte une opération ayant eu lieu des années auparavant. Le Journal Des Sçavans décrit ainsi l’opération pratiquée à Bordeaux : le 24 juillet 1663, un dénommé Raoux se présente pour faire l’opération. Il fait placer le malade sur les genoux d’un valet, sur le « petit appareil »[18]. Il introduit l’index et le médius gauches dans l’anus du patient et pousse le col de la vessie avec le pouce vers la gauche. De la main droite, il effectue une incision au périnée avec le bistouri, ouvrant le col de la vessie avec les tissus du périnée. Poussant la pierre avec les doigts, il la fait sortir. Relâchant le col de la vessie, cette dernière reprend sa place normale. Les deux incisions du col de la vessie et du périnée ne coïncidant plus, il n’y a pas de danger que le patient rende l’urine par l’incision de la vessie, les incisions se refermant d’ailleurs très facilement.
On notera que, pour les cas de cancer comme ceux de la pierre, le traitement est chirurgical plutôt que médical. Longtemps tenues par les facultés de médecine pour inférieures à la médecine proprement dite[19], la chirurgie, l’obstétrique sont moins dépendantes des dogmatismes, plus empiriques, donc plus reconnaissables dans leur pratique, pour nous autres contemporains.
Il est évident, en l’absence d’antibiotiques ou même d’antiseptiques efficaces, que les difficultés et les sérieuses complications ne manquaient pas en médecine comme en chirurgie, à une époque où la pharmacologie et la thérapeutique étaient primitives, toxiques, dogmatiques. Qui plus est, le traitement médical est informé, au moins dans la Faculté de Paris, par une idéologie souvent intransigeante, régissant la perspective iatromécaniste, qui s’oppose, comme on l’a dit plus haut, à la perspective iatrochimiste, laquelle a hérité de Paracelse une attitude relativement plus pragmatique.
Une autre maladie qui revient dans le Journal Des Sçavans au moins à quatre reprises est la goutte. Inconscient en apparence des contradictions qu’il publie, le journal énumère les causes et traitements de cette affection, aussi diverses les unes que les autres. Fait assez rare, le premier en date des articles sur le sujet (numéro du 2 août 1677) représente l’opinion propre du journal : la goutte serait causée par une inflammation du périoste due à une vapeur maligne, froide ou sèche. Le traitement doit être la moxibustion[20]d’une herbe (non identifiée) utilisée depuis toujours en Chine et au Japon. D’autres articles (1683, 1689, 1708) en évoquent les causes comme un tempérament froid et humide, l’envahissement des articulations par la pituite[21]qui coule en excès du cerveau, un défaut du sang artériel ou encore l’hérédité. Les traitements sont eux aussi hétérogènes, consistant surtout en absorption de lait de chèvre, de vache ou d’eau.
En plus des maladies ordinaires, comme la goutte, le Journal Des Sçavans rapporte fréquemment des états exceptionnels, voire monstrueux. On en mentionnera trois, rapportés par les praticiens de l’époque. Bien que sans relation véritable l’un avec l’autre, les exemples suivants illustrent le penchant du Journal à mettre en relief les cas spéciaux, voire ceux qui défient la science médicale (telle qu’on la comprenait et la pratiquait à l’époque) ou même la vraisemblance (infra).
On relève dans le numéro du 11 novembre 1688[22]l’extrait d’une lettre de M. Courtial, médecin de Toulouse, sur un « trou trouvé au ventricule[23]d’une personne de la même ville », et dont voici le résumé succinct : une jeune dame, tourmentée de douleurs d’estomac depuis son enfance, meurt des suites d’une fièvre continue. On s’aperçoit, à l’autopsie, qu’elle a dans l’estomac un trou ovale. Suit une description minutieuse du trou avec remarque qu’il était bouché par un des lobes du foie, qui y adhérait très fortement.
La lettre rapporte un certain nombre de réflexions sur ce qui a pu causer ce trou et surtout ce qui l’a empêché à la fois de se refermer et de s’étendre. Courtial conclut que l’ulcère initial a dû se former dans l’enfance du sujet et se perforer, mais que le lobe du foie (ou la membrane qui l’enveloppe) s’est collé exactement dessus, l’empêchant de s’étendre ou de provoquer un épanchement dans la cavité abdominale[24], ce qui a permis à la jeune fille de survivre jusque-là. Toulousain, Courtial devait avoir effectué ses études médicales soit dans sa ville natale, soit à la faculté de Montpellier, la grande rivale de Paris, résolument moderne et iatrochimiste. Ici, nul dogmatisme mécaniste, mais une constatation de fait. Ce que la lettre du médecin Courtial ne mentionne pas, c’est pourquoi ou comment le lobe du foie bouchant le trou n’a pas été corrodé par l’acide stomacal. Il n’est pas clair, toutefois qu’on ait eu à cette époque une connaissance exacte de cette substance[25].
L’autre cas, dont la description défie plus nettement l’imagination –et la crédulité– et fait douter du sens critique tant de son auteur que de celui du Journal Des Sçavans, est une lettre écrite de Beaune à un certain M. Perron, docteur en droit. En fait, cette lettre reprend un mémoire en latin intitulé Historia admirandæ cujusdam suppresionis alvi, &c., imprimé à Paris chez Jean de La Caille. Pour ce qui est de l’authenticité des faits, elle semble plus que douteuse. Voici en tout cas l’histoire, celle d’une constipation incroyablement rebelle : un gentilhomme de Beaune est pris, vers l’âge de 14 ans, de fortes douleurs au ventre, suivies d’une fièvre qui dure quatorze jours. S’ensuit une constipation totale qui dure trois ans. Il continue cependant à manger et boit force tisanes. La lettre déclare que les remèdes et les aliments se consument entièrement dans son corps sans aucune évacuation. Sa constipation est accompagnée d’urination normale et d’asudation, sauf quand il prenait des purges. Il ne manifeste nul symptôme ou incommodité : ni douleur, ni oppression, ni lassitude, ni dégoût, ni insomnie.
Un jour, en revenant à cheval de Sainte-Claire-de-Seure (à 16 km de Beaune), il est pris d’une fièvre soudaine qui le tient 9 à 10 jours. Au bout de ce temps, il est saigné et purgé. Sa fièvre alors cesse ainsi que la constipation et il retourne à son état normal. Depuis, il jouit d’une parfaite santé.
Diagnostic : le médecin qui l’a traité (saignée et purgation sont les traitements mécanistes par excellence) juge que ses douleurs venaient de « sucs bilieux mêlés de flegmes et d’humeurs crues causées par une trop grande quantité de fruits et de légumes ». Si d’autres médecins trouvent des causes plus probables, dit-il, il sera bien aise de profiter de leurs lumières. Aucun commentaire éditorial du Journal Des Sçavans, qui n’émet pas d’habitude de jugements sur les articles qu’il imprime ou rapporte, sauf rares exceptions. Il s’en remet, de toute évidence, au jugement du lecteur…
Voici maintenant un cas plus surprenant, qui décrit ce qui semble bien être une dépression clinique: c’est le seul cas de maladie psychosomatique que j’ai pu recenser parmi 564 articles traitant de médecine ou de ses domaines annexes, comme l’anatomie, la pharmacologie, etc, entre 1665 et 1715. L’« Extrait d’une lettre hollandoise, qui contient l’histoire d’une létargie extraordinaire »[26]rapporte un cas de dépression chronique, survenu à un jeune Hollandais. Dirkclaas Bakker, de Stolvik (entre Gouda et Rotterdam), est atteint vers le 15 janvier 1706 de ce qui semble bien être une dépression clinique aiguë lorsqu’il apprend, à la mort de son père, que sa part d’héritage ne répond pas à ses espérances. Il en est si fortement frappé qu’il en devient reclus, se cachant toute la journée dans les champs et fuyant la compagnie des gens, y compris des membres de sa famille ou alors il passe des journées entières au lit, ne s’alimentant presque pas. À partir du 18 juin de la même année il devient si faible qu’il tombe dans une léthargie (profond sommeil) dont il ne se réveille qu’épisodiquement. Les soins qu’il reçoit (saignée, purgation, vésicatoires) ne lui apportent qu’un soulagement temporaire. Le 29 juin, on lui fait avaler un vomitif qui lui fait rendre une grande quantité d’« humeurs glaireuses », le réveillant tout à fait, mais il se rendort bientôt. Depuis le 29 juin, il a rendu peu à peu l’eau qu’il avait bue et ne prend que très peu de nourriture, avec les excréments à proportion. Le 13 juillet, il se réveille en sursaut et demande à boire. Il avale 5 grandes tasses d’eau et se rendort immédiatement après sans avoir rouvert les yeux. Il se rendort et reste endormi sans interruption jusqu’au 11 janvier 1707. Ce jour-là-là il se réveille et se met à parler avec bon sens. Le lendemain il retombe dans son premier état, qui continue jusqu’au moment où la lettre est écrite (14 mars 1707). Il est d’une si grande maigreur que son ventre paraît collé à sa colonne vertébrale[27].
Il faut noter le traitement mécaniste, à base de saignées, de purgations et d’émétique. Thérapeutique brutale et certainement sans effet. Sans vouloir surimposer des concepts contemporains sur les méthodes et attitudes de l’époque, on observe, dans cette description sèchement clinique, que rien n’indique que les médecins ou ses parents proches aient songé à conseiller ou à mettre en effet une modification de l’héritage en sa faveur, chose qui aurait pu produire un effet de soulagement...
Ni le Bourguignon constipé ni le Hollandais dépressif, cependant, n’approchent en intérêt spectaculaire les grandes maladies infectieuses, dont la plus redoutable est l’épidémie de peste, qui frappe deux fois durant le règne de Louis XIV entre 1665 et 1715 (supra). Le médecin anglais Nathan Hodges décrit la grande peste de Londres en 1665 dans son livre δοιμολοτια Sive Pestis Nuperæ Londinis Grassantis Narratio Historica, Auctore Nathan Hodges, M. D., &c[28]. Son livre est divisé en 8 sections.
1. Origine et progrès de la peste.
2. Opinion touchant la cause de la contagion. C’est un esprit nitreux et très subtil qui s’exhale de la terre et s’insuffle dans les corps, passant de l’un à l’autre. C’est pourquoi, dit-il, il est très malsain de manger de la chair d’animaux morts de la peste (!)
3. Principal sujet où réside la contagion : dans les esprits, qui la font passer dans les viscères. Le Journal Des Sçavans ne précise pas s’il s’agit des esprits animaux, chers à Descartes, ou d’une autre forme d’esprits.
4. Hodges constate une affinité de la peste et du scorbut, sans doute basée sur une observation empirique, les scorbutiques ayant le système immunitaire compromis. Mais il attribue aux deux maladies un principe « salin ». Il note que les goutteux frappés de la peste et qui en réchappent sont aussi guéris de la goutte.
5. Symptômes de la peste : fièvre, tachycardie, bubons, charbons (taches noires sur la peau). Les bubons viennent du mélange des humeurs salées et des humeurs acides. Nouvelle analogie (vraisemblablement mécaniste) de la réaction de l’esprit de vitriol (acide sulfurique) et du sel de tartre (carbonate de potassium). Il parle des charbons en termes contradictoires : d’une part il cite le cas d’une femme avec un charbon pesteux sur le sein, qui continuait d’allaiter son enfant, et qui est guérie sans contaminer son enfant. D’autre part, il dit que les charbons sont des signes certains de mort.
6. Pronostics : transformation des états chroniques en états aigus avec symptômes violents. Hémorragie, diarrhée, dysenterie sont des présages de mort. La peste pneumonique est invariablement fatale (ce qui demeure largement vrai jusqu’aujourd’hui).
7. Moyens de guérir : il est intéressant de noter qu’il tient compte des facteurs psychologiques. Il faut faire prendre courage au malade. Il préconise des remèdes puissants, mais ni saignée, ni émétique, ni purgation. Antidotes : gingembre en poudre ou confit pour faire suer et servir d’antiseptique. Il favorise le bézoard minéral[29], mais pas le bézoard animal[30]ni la corne de licorne. Il recommande l’esprit de corne de cerf (supra).
8. Prophylaxie pour le moins bizarre : s’exposer au vent du nord, tirer des coups de canon de gros calibre soir et matin, s’exposer aussi à la fumée âcre de bois résineux (peut-être pour purifier l’air ?).
Le nombre de morts de la peste se monte selon le Journal Des Sçavans à 68.596. Comme on voit, aucune observation clinique sur la présence de rats et autres vecteurs de la peste, ni corrélation entre conditions de vie peu hygiéniques et occurrences de peste.
Le numéro du 27 mai 1680 fait voir que des progrès certains se sont accomplis dans la compréhension et le traitement de ce fléau. Un rapport intitulé Histoire de la peste d’Allemagne; son origine, son progrès, les ravages qu’elle a causez &c. 1680[31]raconte les événements lors de la peste noire de Vienne (1679), qui frappe également Prague. L’épidémie est attribuée à la garnison turque envoyée à Neuhäusel[32]. Le Journal Des Sçavans rapporte 52.000 morts. Les estimations modernes portent à 100.000 le nombre de victimes.
Le médecin de la cour de l’impératrice douairière[33], un certain Jean-Baptiste Alprun, imagine un moyen de soigner la peste en analysant le « venin ». Il extrait du pus d’un bubon, le met dans une cornue hermétiquement scellée et le distille, constatant la déposition d’un sel volatil sur les parties supérieures de la cornue. A l’ouverture de la cornue, une telle puanteur se dégage que le Dr. Alprun en est tout ébranlé. Il goûte ce sel et en note l’extrême âcreté, à laquelle il attribue la virulence de la maladie.
Alprun préconise comme meilleurs remèdes contre la peste les sudorifiques, notant que ceux qu’on fait suer abondamment ont survécu à la peste, alors que les autres ont tous péri. Intéressante intersection de la thérapeutique et de la hiérarchie des classes : médecin de cour, il en prépare de compositions différentes pour les riches et les pauvres, de même pour les potions cordiales (On en trouvera des exemples avec un commentaire dans l’appendice)[34]. Il décrit aussi comment il se préserva lui-même de la peste. Comment ? Raisonnant que le « venin » de la peste est transporté dans le courant sanguin jusqu’aux aines et aisselles où il forme les bubons, il lui vient l’idée de se faire (ainsi qu’à 2 de ses amis) une légère incision à chaque aine, où il introduit ensuite un petit tampon pour éviter que la plaie ne se referme et laisse ainsi s’écouler le « venin ».
Suivent des gloses et commentaires sur l’expérience de J.-B. Alprun sur la distillation de la matière extraite d’un bubon pesteux[35]. Le doyen de la faculté de médecine de l’université de Heidelberg critique Alprun sur les risques qu’il a pris dans cette expérience.
Jusqu’ici pas de mesures préventives de masse. Il faut attendre l’année 1715 pour le traité du médecin danois Johann Gottlib Botticher, lequel sort à Copenhague[36]. Tout en étant mécaniste, Botticher fait preuve de pragmatisme dans le 2e chapitre, qui traite de la prévention ; il préconise de brûler des substances aromatiques, de se tenir à l’écart des pestiférés, d’éviter le contact avec les ordures et les lieux où elles se trouvent : égouts, boucheries, hôpitaux. Il faut également éviter les passions violentes, consommer du jus de citron, du vinaigre et de l’ail. Pour ce qui est du traitement, il est empirique. Le Dr. Botticher préconise la saignée prompte et déconseille la purgation. Il est partisan de la sudation abondante.
A part ces épidémies, le Journal Des Sçavans rapporte des découvertes récentes dans le domaine pharmaceutique, dont une des plus notables est le quinquina. Connu en Europe depuis 1650, il est reconnu dès 1679 pour guérir les fièvres (considérées à l’époque comme des maladies plutôt que des symptômes) et non les suspendre seulement. Du point de vue mécaniste, la fièvre est attribuée à un bouillonnement ou fermentation du sang, causée par un « levain » qui tient de l’aigre et de l’âcre et perturbe la circulation. L’action présumée du quinquina est de dissoudre ce levain et de dégager les passages. En médecine mécaniste, saignée et purgation doivent obligatoirement précéder tout traitement quel qu’il soit.
Le nationalisme, voire le chauvinisme, interviennent même dans ce qui est censé être une pure matière scientifique. Le Journal Des Sçavans recense dans son numéro du 8 juin 1682[37]un ouvrage identifié par les seules initiales de l’auteur –N. de B– publié à compte d’auteur, sur « le remède anglois » c’est-à-dire le quinquina. L’article adopte un ton fortement politique (et polémique !) concernant l’usage du quinquina par l’apothicaire anglais Sir Robert Talbot (1642–1681 ; aussi épelé Talbor ou Tabor)[38]. Ce dernier a laissé des traces dans la littérature française : dans sa lettre du 8 novembre 1680 à sa fille, Mme de Grignan (1646–1705), la marquise de Sévigné (1626–1696) fait mention de lui :
L’Anglois a promis au Roi sur sa tête, et si positivement, de guérir Monseigneur dans quatre jours, et de la fièvre, et du dévoiement[39], que s’il n’y réussit, je crois qu’on le jettera par les fenêtres ; mais si ses prophéties sont aussi véritables qu’elles l’ont été pour tous les malades qu’il a traités, je dirai qu’il lui faut un temple, comme à Esculape (128).
La lettre continue en mettant en relief l’impuissance d’Antoine d’Aquin[40], archiatre[41]du roi, devant la fièvre, bien que le Mercure de France[42]déclare que ce dernier lui aussi se servait du quinquina.
Après avoir abondamment loué la générosité de Louis XIV pour Talbot, l’article du Journal Des Sçavans passe en revue les prétendues erreurs et imperfections de ce dernier dans la préparation et l’administration du quinquina, soit qu’il ait introduit des ingrédients inutiles pour déguiser la formule correcte, soit qu’il ait prescrit un cours de traitement imprudent. C’est tout juste s’il ne le traite pas de charlatan[43] ! Il ne tarit pas d’éloges, par contre, à l’endroit de d’Aquin, qu’il dit avoir rectifié et corrigé les erreurs et malversations de Talbot.
Nous constatons là une claire intervention politique dans l’intégrité scientifique du Journal Des Sçavans : en fait d’Aquin était contre le quinquina ; le peuple se moquait de lui et le comparait désavantageusement à Talbot, chose peu surprenante ; trois ans plus tard, d’Aquin s’était opposé (en 1683, donc) à ce que le chirurgien royal Pierre Dionis[44]opère la reine Marie-Thérèse d’un abcès à l’aisselle gauche, avec le résultat que l’abcès avait crevé dans la poitrine de la reine, entraînant la mort de celle-ci par septicémie. C’est sans doute en réaction contre le praticien d’outre-Manche et pour se faire valoir que d’Aquin adopte l’usage du quinquina. L’année suivante sort un livre de recettes pour la préparation de ce remède avec, là encore, deux niveaux : l’un pour les riches, l’autre pour les pauvres. De 1679 à 1706, nous recensons 12 articles rapportant des ouvrages où il se traite, peu ou prou, de ce produit-miracle. La Fontaine lui donne ses lettres de noblesse en 1682 avec le Poème du quinquina[45].
Mais revenons aux cas de maladie individuels. Nous rapporterons à présent trois histoires, assez peu spectaculaires ou exceptionnelles au demeurant, encore que pitoyables. La première porte sur la gynécologie, les deux autres sur la cardiologie. Le Journal Des Sçavans recense dans le numéro du 1er mai 1702[46]l’histoire de Marguerite Malaure[47], qui eut son heure de célébrité à l’époque et qui illustre autant l’incompétence des médecins que la cruauté des lois de l’époque.
Orpheline toulousaine née en 1665, Marguerite Malaure est élevée par le curé de Pourdiac (diocèse de Toulouse). Affectée depuis l’enfance d’un prolapsus utérin extériorisé ou hystérocèle, elle est à 21 ans, en 1686, en service chez une dame, lorsqu’elle tombe malade. Elle est portée à l’Hôtel-Dieu de Toulouse, où l’on s’aperçoit par hasard de son infirmité. L’ignorance du médecin lui fait prendre la jeune fille pour un hermaphrodite ; en conséquence, lui est imposée l’obligation, après consultation des vicaires généraux, de mettre un habit d’homme. Mécontente, Marguerite s’en va à Bordeaux, où elle reprend l’habit de fille et se met au service d’une autre dame. En 1691, elle est reconnue par quelqu’un qui la fait renvoyer de sa place, la forçant à retourner à Toulouse, où elle est emprisonnée pour avoir mis des habits de fille. Les capitouls[48]rendent contre elle une ordonnance le 21 juillet 1691, dans laquelle ils décrètent qu’elle se nommerait désormais Arnauld Malaure, avec défense de prendre le nom et l’habit de femme à peine de punition corporelle. Incapable de gagner sa vie comme servante, elle est obligée d’errer de ville en ville en mendiant, ne sachant aucun métier convenant aux hommes.
Tout en concédant qu’il existe des cas d’ambiguïté sexuelle si bizarres qu’il est difficile de se faire une opinion, le Journal Des Sçavans exprime ici sa désapprobation d’un traitement aussi rigoureux, prenant nettement parti pour la jeune fille, dont la malformation ne pouvait ni ne devait en aucun cas être prise pour de l’hermaphrodisme. Il se montre dur envers l’aveuglement des médecins, qui ont négligé toutes ses caractéristiques féminines (y compris les règles) pour ne voir dans sa descente de matrice qu’un sexe masculin.
Venue en octobre 1693 à Paris, elle est examinée par Saviard[49], qui la fait soigner et l’opère, remettant l’utérus en place « en moins d’un demi-quart d’heure » (281). En conclusion, l’article évoque les très nombreux médecins et chirurgiens qui, après le succès de l’opération, avaient prétendu connaître l’état de la patiente et lui avoir recommandé cette même opération. En fait, Marguerite Malaure a déclaré après sa guérison qu’une seule personne lui avait conseillé l’opération pratiquée par Saviard.
Passons maintenant aux cas d’insuffisance cardiaque : en 1672, Louis XIV nomme Dionis professeur d’anatomie « selon la circulation du sang », encore contestée par la Faculté de Paris quarante-quatre ans après la parution de l’ouvrage de William Harvey (1578–1657) Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus (1628). Dionis pratique des dissections en public au Jardin du Roi (aujourd’hui Jardin des Plantes)[50]. Il pratique aussi des autopsies sur les individus de l’entourage de Louis XIV qui meurent d’insuffisance cardiaque. Nous retiendrons en premier celle d’un personnage important de la Cour, le sieur Besnier, chef du gobelet du Roi[51]. La description de la cardiopathie de Besnier est très claire et d’une grande précision clinique. Il meurt subitement le 2 novembre 1703 en servant le duc de Bourgogne[52]. Dionis trouve les poumons remplis de sang coagulé et d’une consistance plus « parenchymateuse » (comme le foie ou la rate) que spongieuse, avec cardiomégalie[53]. Il semble bien que Besnier soit mort d’une congestion due à une insuffisance cardiaque, le cœur n’ayant plus la force de propulser le sang hors des poumons. L’article ajoute (citant sans doute Dionis) que Besnier était souvent à bout de souffle et forcé de s’arrêter lorsqu’il marchait ou parlait. Dionis attribue la mort à une circulation déficitaire, ce qui est évident pour nous autres contemporains.
Un autre cas cité par le Journal Des Sçavans : le 24 février 1704, le sieur Guillain, valet de pied du roi, meurt subitement. Voulant savoir la cause de la mort avant de partir pour Marly, le roi ordonne une autopsie immédiate. L’autopsie révèle que le poumon gauche est trois fois plus gros que le droit, qui adhère à la plèvre ; il est aussi plein de sang coagulé. Le cœur, très gros, est presque vide de sang. Dionis a pratiqué d’autres autopsies de morts subites et à chaque fois il constate la même chose : poumons remplis de sang coagulé, cœur très grossi et presque vide de sang. Il conclut que les morts subites sont dues à la cessation de la circulation. Curieusement, ni Dionis ni le Journal Des Sçavans ne commentent la cardiomégalie et l’incapacité du cœur à pomper efficacement. Impuissance à lier la cause et l’effet ? Cela semble pour le moins difficile à croire. Il faudrait penser plutôt que pour le chirurgien comme pour le journal (et les lecteurs), la relation est évidente, même si les causes demeurent mystérieuses.
Mais comment la clientèle ordinaire réagissait-elle en gros aux médecins et à leurs pratiques ? Brockliss et Jones rapportent —avec précaution— qu’en dépit des limitations de la médecine à l’époque, le public conservait une certaine estime pour le cops médical. Vu ce qui précède dans le cas de Marguerite Malaure et d’autres, on serait tenté de croire que les médecins et la médecine étaient tenus en mépris. Or, il semble bien que non. Dans un passage intitulé « Rereading Molière », les auteurs déclarent que
On the one hand, the obvious limitations of secular medicine and the pain and discomfort of interventionist therapeutics did not bring the art of healing into disrepute, for the sick were perennial optimists. They recognized that in the final analysis the restoration of health was a divine gift, but they accepted too that disease was normally a natural phenomenen (however caused) and that God had given man the natural means of curbing its ravages (336).
Cette position est soutenue par des recherches que les auteurs ont effectuées dans les manuels de médecine de l’époque[54]. Mais cela ne veut pas dire que la caricature que trace Molière, dans Le Malade imaginaire (1673) en particulier, soit entièrement fausse. Mes lectures sur la médecine telle que la présentent les cinquante premières années du Journal Des Sçavans m’ont amené à conclure que, lorsqu’il s’agit de thérapeutique (en particulier la saignée, la purgation et l’administration de substances toxiques telles que le mercure et l’antimoine), Molière exagère à peine, en fait.
Il existe dans le Journal Des Sçavans de bien plus nombreuses descriptions de la souffrance humaine au XVIIe siècle qu’un texte de longueur raisonnable ne permet de décrire ici. On peut cependant constater à la lecture des articles et recensions, de 1665 à 1715, que la médecine apporte relativement peu de soulagement à cette souffrance. Ce n’est pas que les médecins ne se soucient pas de leurs malades, mais il existe deux obstacles intellectuels majeurs à une pratique efficace de l’art de guérir : le premier est la dépendance d’un engagement idéologique : influence — encore très forte — des Anciens (Hippocrate, Galien)[55], philosophie mécaniste, alchimie de Paracelse, voire la concurrence acharnée entre Paris et Montpellier. Le deuxième est historique et scientifique : c’est l’absence d’une médecine authentiquement expérimentale. Celle-ci ne verra vraiment le jour qu’au XIXe siècle, avec Claude Bernard[56].
Il existe cependant des figures admirables parmi les praticiens de l’époque, spécialement les chirurgiens (Dionis, Saviard) et les médecins accoucheurs (Mauriceau[57]), mais les prétendues guérisons rapides après saignées et purgations que rapporte le Journal Des Sçavans demeurent pour le moins douteuses. L’intersection de la médecine et des lois, tant laïques qu’ecclésiastiques, comme dans le cas de Marguerite Malaure, ou celle de la médecine et des intérêts financiers, comme dans le cas du Hollandais Dirkclaas Bakker, fait voir à quel point le corps souffrant est laissé à lui-même. Les grands n’y échappent pas plus que les humbles.
Il semble approprié de conclure sur le malade le plus illustre du Grand Siècle, c’est-à-dire Louis XIV lui-même. On sait qu’il a été tourmenté toute sa vie par de nombreuses maladies et dérangements ; nous nous arrêterons sur trois « étapes » majeures de sa morbidité : la célèbre opération de la fistule anale, en 1686, l’opération de l’autre fistule, naso-palatale, l’année précédente et une brève description de ses derniers jours, à partir d’août 1715[58].
Ézéchiel Spanheim (1629–1710) est un diplomate et savant allemand qui passa neuf ans à partir de 1680[59]comme ambassadeur du Grand Électeur de Brandebourg[60]à Versailles et à Paris. De l’année 1690, il a laissé un important mémoire[61]. Ce long récit commence, justement, par une description de l’opération de la fistule anale du roi, qu’il subit sans anesthésie et avec un courage exemplaire. Voyons plutôt ce qu’en dit Spanheim :
En 1686, il [Louis XIV] fut atteint d’une fâcheuse fistule au fondement, dont il fut guéri par une opération qu’il souffrit avec beaucoup de courage. L’opération se fit le matin, et, le soir, on tint conseil devant son lit, de même que les jours suivants, jusques à ce qu’il fût guéri. Il a eu depuis des atteintes de goutte et des accès de fièvre intermittente, dont il se guérit par le quinquina préparé par un médecin anglois[62]. Quoique remis de ces maux, il ne laissa point de paroître de temps à autre des abattements qui se répandent dans son air, dans son visage, et même dans son humeur. (1–2)
Ce qu’il ne rapporte pas, c’est la succession d’opérations sur la fistule palatale de Louis XIV l’année précédente, en 1685. Une extraction dentaire mal faite laisse un trou dans le palais, qui le fait communiquer sur le côté gauche avec la cavité nasale, ce qui faisait couler les liquides par le nez chaque fois que le roi buvait ou se gargarisait. Dans son ouvrage (q.v.), Stanis Perez a laissé une saisissante description de l’opération, qui consistait en une série de cautérisations au fer rouge[63]que Louis XIV avait dû subir pour éviter le pourrissement de sa bouche (73–76). Perez décrit également en grand détail l’opération de la fistule anale du roi (78–87), qui eut lieu le 18 novembre 1686, après des mois de souffrance.
Les derniers jours de Louis XIV sont consignés dans le journal des frères Antoine, garçons de chambre et porte-arquebuses du roi, lequel journal le montre aux prises avec une gangrène d’origine diabétique qui lui pourrit inexorablement le côté gauche du corps, alors que Fagon[64]et les trente-neuf autres médecins du roi prescrivent des remèdes aussi bizarres qu’inefficaces, comme les bains de lait d’ânesse, chose que rapportent en détail les auteurs :
 La nuit suivante du 24 du mois [d’août] et 15. de la maladie le Roy fut attaqué de vapeurs qui l’incomoderent fort et obligerent M. Fagon a faire assembler toute la medecine tant de la Ville que de la Cour pour consulter sur le nouvel accident.
La nuit suivante du 24 du mois [d’août] et 15. de la maladie le Roy fut attaqué de vapeurs qui l’incomoderent fort et obligerent M. Fagon a faire assembler toute la medecine tant de la Ville que de la Cour pour consulter sur le nouvel accident.
Dans la consultation quils firent après avoir touché le poulx du malade en céremonie comme ils avoient fait cy devant, ils accuserent l’anesse de ce malheur et la disgracierent sous pretexte que son lait n’avoit pas plus de vertu que leurs raisonnements.
Mais qu’ordonnerent ils à la place du remede qu’ils rejettoient ? Rien du tout ; ils visiterent seulement la jambe affligée et y observerent une noirceur au dessous de la jarretiere : cétoit une marque de mauvaise augure qui menaçoit de la gangrene ou plutôt qui l’indiquoit, et ils l’enveloperent de linges trampés dans de l’eau de vie canfrée pour y rappeller la chaleur naturelle (41).
Ce passage n’est qu’un parmi de nombreux autres qui laissent transparaître l’indignation et la rage impuissante des auteurs à voir leur maître bien-aimé s’en aller sans aucun vrai secours de la part des médecins. Mareschal[65], premier chirurgien, préconisait que pour sauver le roi il fallait amputer la jambe, mais Louis XIV s’y opposait sur les conseils de Fagon, protégé de Mme de Maintenon.
 Peut-on dire que ces récits de maladies, de difformités et autres misères physiologiques ou pathologiques constituent « l’envers du Grand Siècle ? » Dans la mesure où la maladie et la souffrance affectaient universellement la population, sans égard au rang ou à la fortune, où les morts étaient plus la norme que les guérisons, il faudrait penser plutôt que l’envers du Grand Siècle, ce sont les fastes de Versailles, l’enjouement de la marquise de Sévigné, le génie de Molière, de Corneille, de Racine, la grâce de Poussin, la splendeur de Lully. Le véritable endroit du Grand Siècle, dont nous n’avons le plus souvent qu’une image imprécise, est bien moins agréable à contempler…
Peut-on dire que ces récits de maladies, de difformités et autres misères physiologiques ou pathologiques constituent « l’envers du Grand Siècle ? » Dans la mesure où la maladie et la souffrance affectaient universellement la population, sans égard au rang ou à la fortune, où les morts étaient plus la norme que les guérisons, il faudrait penser plutôt que l’envers du Grand Siècle, ce sont les fastes de Versailles, l’enjouement de la marquise de Sévigné, le génie de Molière, de Corneille, de Racine, la grâce de Poussin, la splendeur de Lully. Le véritable endroit du Grand Siècle, dont nous n’avons le plus souvent qu’une image imprécise, est bien moins agréable à contempler…
University of Georgia
APPENDICE
On présente ci-dessous deux exemples de préparations pharmaceutiques qui démontrent nettement le lien entre soins médicaux et statut socio-économique. Les remèdes pour les riches contiennent plus d’ingrédients et des ingrédients coûteux (pierres précieuses, en particulier). Le Journal Des Sçavans ne donne aucune indication quant à leur efficacité respective, mais on peut supposer que les patients nantis étaient persuadés que l’abondance et le prix des ingrédients garantissaient un résultat bénéfique. Ces préparations sont l’œuvre de J.-B. Alprun, médecin de l’impératrice douairière de l’empire autrichien.
Sudorifique pour les riches
Prenez poudre Diambra[66]& Damoschi[67]de chacune deux dragmes[68], Licorne marine[69]et pierre de bézoard pulvérisées de chacune une dragme, sels volatils de vipères, de corne de cerf, de succinum[70]et de nacre de perles de chacun quinze grains, de l’extrait de contrayerva[71]et des confections préservatives décrites dans la pharmacopée augustine de chacune demi-dragme, et des sirops de scordium[72]et de coraux de chacun deux onces. Dissolvez ces choses dans une pinte des eaux cordiales de scorsonère[73]et de chardon bénit[74]parfumées avec le musc, et donnez trois onces de ce mélange de huit en huit heures observant incontinent après de bien couvrir le malade (15 ingrédients). Noter la présence de la nacre, de l’ambre, de l’ambre gris et du musc, substances précieuses.
Sudorifique pour les pauvres
Prenez poudres Diamargaritum[75]& de Diarodon[76]de chacune trois dragmes, électuaire[77]de chacun une once, antimoine diphtérique et bézoard minéral de chacun deux dragmes et ajoutez à ces choses les syrops et eaux marquées dans le sudorifique précédent pour en faire le même usage (6 ingrédients). La proportion de perles dans le diamargaritum est bien plus faible que dans la potion pour les riches.
Potions cordiales pour les riches
Prenez confections d’hyacinthes et alkermès[78]de chacune demi-once, magistère de perles et des grenats de chacun une dragme, le tout dans un demi-setier[79]de l’eau cordiale d’Hercule Saxon, pareille quantité de celle d’Angelus Salo, et chopine de toutes les parties du citron pour en faire dix doses qui seront prises à une heure près l’une de l’autre (7 ingrédients). On notera la présence de pierres précieuses (perles et grenats) dans la préparation.
Potions cordiales pour les pauvres
Prenez corail rouge préparé deux dragmes, confection d’alkermès incomplète deux onces, et thériaque de Venise trois onces, que vous dissoudrez dans une chopine d’eau de tormentille[80]et pareille quantité de celle de chardon bénit pour vous en servir en la manière prescrite pour la précédente (5 ingrédients).
Ouvrages cités ou consultés
Antoine, Jean et François. Journal de la maladie et de la mort de Louis XIV (Drumont, Édouard, éd.) Paris : A. Quantin, 1880.
Bluche, François, Dictionnaire du Grand Siècle. Paris : Fayard, 1990.
Brockliss, Laurence & Colin Jones. The Medical World of Early Modern France. Oxford : Clarendon Press, 1997.
Descartes, René. Discours de la méthode. Paris : Garnier-Flammarion, 1966.
_____. Œuvres, lettres. Textes présentés par André Bridoux. Paris : Gallimard (Pléiade), 1970.
Journal Des Sçavans. Paris : divers éditeurs, 1665–1715.
Letouzey et Anet. Biographie universelle. Paris: Delagrave, 1870.
Perez, Stanis. La Santé de Louis XIV : une biohistoire du Roi-Soleil. Paris : Champ Vallon, 2007.
Richardt, Aimé. Les Médecins du Grand Siècle. Paris : François-Xavier Guibert, 2005.
Rivière, Patrick & J. L. Garillon. La Spagyrie ou la médecine de Paracelse (http://www.miroir.com/spagyrie/main3.html).
Sévigné, Marie de Rabutin-Chantal, marquise de. Lettres de Madame de Sévigné, de sa famille et de ses amis , recueillies et annotées par M. Monmerqué. Tome VII. Paris : Librairie de L. Hachette et Cie, 1862 (source : gallica.bnf.fr).
Siegel, Rudolph E. & F. N. L. Poynter. « Robert Talbor, Charles II, and Cinchona: a Contemporary Document ». Med Hist. 1962 January; 6(1): 81–85.
Spanheim, Ezéchiel. Relation de la Cour de France en 1690. Société de l’histoire de France, Publications. N° 209. Paris : Librairie Renouard, 1882.
[1]Ce qui précède dans le paragraphe : « J’avais expliqué assez particulièrement…» (Discours de la méthode)
[2]Il parle de ses expériences de dissection des animaux.
[3]Les italiques sont de moi.
[4]http://www.univ-paris-diderot.fr/diderot/travaux/revseance4.htm. Interrogé le 29 décembre 2009.
[5]D’origine arménienne.
[6]Philipp Aureolus Theophrastus Bombast ab Hohenheim (1493–1541). Voir Rivière, Patrick & J. L. Garillon. La Spagyrie ou la médecine de Paracelse (http://www.miroir.com/spagyrie/main3.html) Interrogé le 30 décembre 2009.
[7]Détail de ce que M. Rosinius Lentilius, docteur en médecine, a fait de plus considérable par rapport à l’exercice de son art, chaque jour de l’année 1709. (Stuttgart, s.d.) Recensé dans le nº du 25 mai 1711, pp. 322–334. La corne de cerf râpée est encore aujourd’hui considérée par certains comme un contrepoison et une panacée. La corne de cerf contient beaucoup de gélatine et de phosphate de calcium. La chaleur humide avait sans doute l’effet de ramollir la partie gélatineuse.
[8]Le Journal Des Sçavans ne rapporte évidemment pas ces épidémies, qui ont eu lieu trois décennies avant sa première publication. Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Grand-Pressigny. Interrogé le 29 décembre 2009. Quant à l’épidémie de peste de Marseille en 1720-1722, elle se situe hors de la fourchette des dates examinées. Voir à ce sujet http://fr.wikipedia.org/wiki/Peste_de_Marseille. Interrogé le 8 janvier 2010.
[9]Le Journal Des Sçavans ne la rapporte pas. La coïncidence des dates est sans doute trop proche.
[10]Encore que la peste bubonique existe encore à l’état endémique dans plusieurs parties du monde, notamment dans le sud-ouest des Etats-Unis.
[11]Aujourd’hui dans le département des Côtes-d’Armor (Bretagne).
[12]In A. Croix : La Bretagne aux XVIe et XVIIe siècles : la vie, la mort, la foi(Paris, 1981), p. 227.
[13]Lettre de M. Helvétius, docteur en médecine, à M. Régis, sur la nature et la guérison du cancer. In-4º. Paris: Jean Cusson, 1691. Recensée pp. 345-346.
[14]Adrien Helvétius (ca. 1661-1727): médecin hollandais (sans doute d’origine suisse —Schweizer est latinisé en Helvétius— établi en France. Il devient protégé de Colbert. Premier à employer la racine d’ipécacuanha pour traiter les troubles de l’appareil digestif, notamment la dysenterie. Il était grand-père du philosophe Claude-Adrien Helvétius (1715-1771). 1691: Lettres sur la nature et la guérison du cancer, rééd. 1706. Michaud. Biographie universelle, ancienne et moderne 85-86. Voir également Brockliss & Jones 622.
[15]A noter qu’Anne d’Autriche est morte en 1666 d’un cancer du sein. Il n’est fait nulle part mention de cela dans le Journal Des Sçavans. La revue passe sous le silence le plus complet tout ce qui a trait aux maladies du roi ou de son entourage. Ainsi, pas un mot dans le numéros de 1685 ou de 1686 sur les opérations des fistules du roi.
[16]Anne-Marie-Louise d’Orléans, duchesse de Montpensier (1627–1693).
[17]C’est la recension d’un ouvrage intitulé Observations sur la manière de tailler dans les deux sexes, pour l’extraction de la pierre, pratiqué par Frère Jacques. À Paris, chez Jean Boudot, ruë s. Jacques. 1700. Pp . 54–58.
[18]L’opération de la taille (extraction des calculs de la vessie) se faisait au moyen soit du « grand appareil », soit du « petit appareil ». Malgré des recherches poussées, je n’ai pas pu trouver en quoi consistait l’un ou l’autre.
[19]Il faut toutefois reconnaître que le Journal Des Sçavans ne fait pas état de cette distinction. On peut même dire —si l’on s’en tient au ton des articles— qu’il manifeste une certaine bienveillance à l’égard de ces deux disciplines.
[20]La moxibustion est une technique de stimulation par la chaleur de points d'acupuncture. Le moxa est l'objet chauffant qui permet cette stimulation.
[21]L’une des quatre humeurs d’Hippocrate. Les trois autres sont le sang, la bile jaune et la bile noire.
[22]Pp 360–361.
[23]Au XVIIe siècle, ventricule veut dire estomac.
[24]Ce qui aurait causé une péritonite rapidement mortelle.
[25]Je traite de la controverse sur la digestion (trituration mécanique vs. « levains », une dispute en 1710–11 entre d’une part Philippe Hecquet [1661–1737], de la faculté de Paris, et de l’autre les médecins montpelliérains Raymond de Vieussens [1641–1715] et Jean Astruc [1684–1766]) dans l’article suivant: « Digérer au Grand Siècle: une querelle d’idéologies scientifiques. » Nourritures. Actes du 40e congrès de la North American Society for Seventeenth-Century French Literature. (Biblio 17, 186 — 2010): 105-117.
[26]Recensé dans le Journal Des Sçavans du 30 avril 1707, pp. 175–177.
[27]C’est la première fois que nous constatons que le pouls est mesuré par battements/minute. Ordinairement 50 battements /minute, mais si on lui fait sentir un spiritueux, le pouls monte à 80. Lorsque l’effet s’en dissipe, le pouls retombe à 50.
[28]Recensé dans le Journal Des Sçavans du 27 juin 1672, pp. 109–112.
[29]Ancien nom du deutoxyde d’antimoine.
[30]Concrétion qui se forme dans l’appareil digestif de certains animaux et à laquelle on attribuait des vertus antipoison.
[31]Recensé pp. 145–156.
[32]En Autriche, au nord du Danube. A ne pas confondre avec le village du même nom en Allemagne (Rhénanie-Palatinat).
[33]Éléonore de Gonzague-Mantoue (1630–1686), troisième épouse de Ferdinand III (1608-1657), empereur romain germanique.
[34]Je note que les remèdes décrits dans l’appendice sont le fait du seul J.-B. Alprun et ne se rapportent pas à une pharmacopée plus générale. Le fait qu’il était médecin de cour pourrait servir à expliquer pourquoi il prépare deux catégories de remèdes, l’une pour les riches et l’autre pour les pauvres.
[35]Pp. 155–156.
[36]Recensé dans le Journal Des Sçavans du 21 janvier 1715, pp. 33–39.
[37]Pp. 171–176.
[38]Brockliss & Jones ne mentionnent pas ce nom, mais il est fort possible qu’il ait été faussement épelé dans le Journal Des Sçavans. Ils rapportent (292) un certain Sir Robert Tabor ou Talbor, un apothicaire itinérant anglais qui aurait en effet introduit le quinquina à la Cour dans les années 1680 pour soigner la Dauphine d’une fièvre que ses médecins ne pouvaient guérir. Ils font également référence (292, n. 33) à la lettre de Mme de Sévigné à sa fille du 8 novembre 1680 citée plus haut. Robert Talbot (ou Talbor) avait rencontré en 1672 le roi d’Angleterre Charles II (1630 – 1685 AS), à l’occasion de la troisième guerre anglo-hollandaise (guerre de Hollande) qui l’avait nommé médecin royal et lui avait accordé le rang de chevalier pour ses guérisons au quinquina. Voir l’article de Siegel et Poynter, qui épelle le nom « Talbor ».
[39]Désordre de santé.
[40]Antoine d’Aquin (1620 ?–1696). Premier médecin de Louis XIV en 1672. Disgracié en 1693 pour son excès d’ambition. Remplacé par Guy-Crescent Fagon (infra).
[41]Médecin en chef ou premier médecin.
[42]Numéro d’octobre 1680, pp. 272 ss, in Lettres de la marquise de Sévigné pp. 128–129 n. 4
[43]Brockliss & Jones le présentent comme un charlatan ambulant (292), mais il est peut-être plus exact de le voir comme un apothicaire empirique itinérant.
[44]Dionis, Pierre (1643–1718). Voir l’article de François Bluche in Bluche 481.
[45]Dédié à la duchesse de Bouillon (Marie-Anne Mancini, 1649–1714), il paraît simultanément chez Denis Thierry et Claude Barbin. On peut consulter une version électronique de l’édition originale au site suivant : http://www.narbolibris.com/doc689. Interrogé le 4 janvier 2010.
[46]Pp. 279-282.
[47]On peut consulter le site http://www.genealogy.tm.fr/Chronique/chronique9.htm
[48]Sous l’Ancien Régime, les capitouls étaient, depuis le Moyen Âge, les habitants élus par les six quartiers de Toulouse pour constituer le conseil municipal de la ville.
[49]Saviard. Barthélemy (1656–1702). Maître-chirurgien à l'Hôtel-Dieu. Excellent opérateur. Nouveau recueil d'observations chirurgicales (1702). Biographie universelle(T. 38, 119)
[50]Son ouvrage Anatomie de l'homme suivant le circulation du sang et les nouvelles découvertessort pour la première fois en 1690 et connaît de nombreuses éditions et traductions. Dans son numéro du 26 janvier 1705, le Journal Des Sçavans rend compte de la 4e édition.
[51]Encore appelé échansonnerie-bouche, c’était le service de la boisson, partie d’un important département, celui de la bouche du Roi, lui-même partie essentielle de la Maison du Roi. Voir Solnon, Jean-François, « Maison du roi » in Bluche 941.
[52]Louis de France (1682–1712), petit-fils du roi, fils de Monseigneur et de Marie-Anne de Bavière.
[53]Dilatation pathologique du cœur, qui diminue sa capacité de pomper le sang à travers l’organisme.
[54]D’autre part, disent-ils, il n’existait guère de points de friction entre les médecins patentés et les guérisseurs « officieux », empiriques et autres charlatans, vu les clientèles respectives différaient. Le Journal Des Sçavans ne parle pas de ces derniers.
[55]Je relève 14 références à Hippocrate et 12 à Galien dans le Journal Des Sçavans entre 1665 et 1715.
[56]1813–1878. Son ouvrage majeur est l’Introduction à l’étude de la médecine expérimentale (1865).
[57]François Mauriceau (1637–1709). Voir l’article de Jacques Gélis sur les médecins accoucheurs in Bluche 39–40 et
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Mauriceau. Interrogé le 4 janvier 2010.
[58]Rappelons que Louis XIV meurt le 1er septembre 1715, à 8h15 du matin.
[59]Il revient en France en tant qu’ambassadeur de 1697 à 1701.
[60]Frédéric-Guillaume Ier de Brandebourg (1620–1688).
[61]Plus de 440 pages dans l’édition citée (q.v.).
[62]Talbot.
[63]Nommé « feu actuel », par opposition au « feu virtuel » (vitriol et autres acides employés comme agents cautérisants).
[64]Fagon, Guy-Crescent (1638–1718). Médecin et botaniste français. Il devient premier médecin de Louis XIV en 1693 après le renvoi d’Antoine d’Aquin. Voir l’article de Bruno Pons in Bluche 573-574.
[65]Mareschal, Georges (1658–1736). Voir l’article de Bruno Pons in Bluche 968.
[66]Préparation à base d’ambre gris, de musc et d’autres épices.
[67]Le diamoschum est une poudre de musc dulcifiée au sucre.
[68]5,1 grammes.
[69]Vraisemblablement de la défense de narval, recherchée depuis le moyen âge et sans doute réputée avoir des propriétés curatives.
[70]Ambre.
[71]Racine et rhizome d’une plante sud-américaine, ayant un effet tonique doux.
[72]Plante européenne ayant des propriétés anti-inflammatoires.
[73]Salsifis noir, réputé contrepoison.
[74]Plante de la famille des chardons, réputée avoir de nombreuses propriétés médicinales.
[75]Tablettes de sucre rosat, dans la composition desquelles on fait entrer, sur chaque livre, une demi-once de perles dissoutes. http://web2.bium.univ-paris5.fr/livanc/?cote=61157&p=227&do=page. Interrogé le 3 janvier 2010.
[76]Poudre tonique et excitante, où entrent des roses rouges. Voir note précédente pour la référence.
[77]Préparation complexe contre l’indigestion et les vents.
[78]Soit teinture de cochenille soit oxysulfure d’antimoine.
[79]Pour les liquides, le mot « setier » servait parfois à désigner la chopine de Paris, valant un peu moins d’un demi-litre. http://fr.wikipedia.org/wiki/Setier. Interrogé le 4 janvier 2010.
[80]Plante de la famille des rosacées.