Colloque CAHSA
Appel à communications
Colloque interdisciplinaire
Religion et plaisir (XVI-XVIIIe siècles) / Religion and Pleasure (16th-18th century)
11-13 décembre 2025
Université de Fribourg (Suisse)
Le Collectif d’Anthropologie et d’Histoire du Spirituel et des Affects (CAHSA), en collaboration avec l’Institut fribourgeois pour l’étude de la Renaissance et de l’époque moderne, sollicite des propositions pour un colloque interdisciplinaire sur le thème « Religion et plaisir (XVI-XVIIIe siècles)». Le colloque se tiendra du 11 au 13 décembre 2025 à l’Université de Fribourg (Suisse).
La peur, la culpabilité, l'ascétisme, la retraite, l’anéantissement, le sacrifice apparaissent souvent comme les lieux communs de l’expérience religieuse à l’époque moderne, étroitement associée à la « haine de la chair » pour reprendre l’expression de J. Delumeau (Delumeau ; 1983). Les plaisirs du corps, encadrés, combattus, parfois interdits, entrent en effet dans une « ère du soupçon », volontiers accusés de faire obstacle à la vérité et au salut.
À observer de plus près les traces de la culture chrétienne du XVIe au XVIIIe siècles, conservées dans les textes, mais aussi dans les objets, l’architecture, l’iconographie ou encore dans la musique, on constate néanmoins que la religion entretient un rapport plus complexe et nuancé avec le plaisir. La relecture des Pères de l’Église, et de saint Augustin notamment, amène ecclésiastiques, théologiens, mais aussi mondains et mondaines de l’époque moderne, à repenser le plaisir sous l’angle de son ambiguïté. Irréductible à sa seule signification négative, qui en ferait un pur signe de concupiscence, le plaisir est perçu a minima comme un auxiliaire utile pour toucher les cœurs et conduire les chrétiens à se tourner vers des plaisirs plus grands et plus véritables. Il est parfois même considéré, par des penseurs aussi différents que Lorenzo Valla, Marsile Ficin, Érasme, Gassendi, Angelus Silesius ou Pascal, comme un « moteur » de l’expérience spirituelle, individuelle ou collective, expérience qui s’exprime aussi bien dans les visions extatiques – dont l’expression repose parfois sur un lexique de la volupté qui joue avec celui de l’érotisme – que dans la douceur des amitiés spirituelles ou, dans le cadre de la liturgie, dans l’attente de l’eucharistie, la prière collective, l’écoute d’un sermon, etc. Le plaisir, qui oscille entre l’impression esthétique et la sensation proprement physique, parfois violente, peut être ainsi considéré comme une partie intégrante de l’expression et de l’expérience du religieux, jusqu’à devenir une caractéristique intrinsèque, et majeure, de la grâce divine, pensée et exprimée dans des termes tels que “douceur, délectation, délices, ravissement, joie, volupté céleste, flamme” (Sellier ; 1995 [1970]).
Toutefois, l’ambiguïté du plaisir – à la fois chemin vers le divin et source de la tentation – en fait une entité suspecte pour de nombreux courants spirituels. L’exemple de la Réforme est emblématique, qui rompt avec l’esthétique ostentatoire du catholicisme au nom d’un retour à une foi intérieure et épurée de tout excès sensoriel, l’image et la musique étant alors soupçonnées d’entretenir l'idolâtrie davantage que la foi des fidèles. La religion agit en outre de l’extérieur contre les formes déviantes du plaisir : du côté catholique comme du côté protestant, les plaisirs du monde – jeu, danse, promenade et théâtre surtout – font l’objet d’un nombre croissant de réquisitoires (Thirouin ; 2007; Diekmann et Wild, 2011), lesquels non seulement révèlent l’importance de la question du plaisir dans la religion au regard des débats qu’elle suscite durant toute l’époque moderne, mais rappellent par ailleurs le statut complexe, à certains égards problématique et ambivalent du plaisir sur un plan éthique ou moral (Religion and the Senses in Early Modern Europe ; 2012). Voie d’accès à la connaissance divine, le plaisir est, à l’inverse, source de corruption lorsqu’il est centré sur des objets terrestres et renforce l’attachement de la créature au monde. Ces tensions soulignent ainsi les multiples modalités de régulation du plaisir dans les pratiques religieuses, oscillant entre valorisation mystique et rejet moral, entre extase divine et rigueur ascétique. Elles illustrent en outre les divergences et les lignes de fracture confessionnelles pour ce qui concerne la place du corps, des sens et de l’imaginaire dans l’expérience religieuse.
Dans le cadre de sa prochaine édition en présentiel, le colloque du CAHSA voudrait proposer une réflexion sur les rapports complexes qui unissent plaisir et religion à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles). À cet effet, le comité organisateur sollicite des propositions de communications qui pourront porter aussi bien sur le discours théologique ou philosophique consacré à l’interaction – volontiers ambiguë voire polémique – de la culture religieuse et du plaisir, que sur les représentations de cette interaction rencontrées dans la littérature ou les beaux-arts de cette période. Les problématiques à explorer pour l’époque considérée pourront aborder, de manière non limitative, les pistes suivantes :
- Définition et théorie du plaisir spirituel dans les doctrines théologiques (par exemple, la délectation victorieuse à Port-Royal ou le “panhédonisme” que Jacques Le Brun repère chez Bossuet)
- Opposition ou complémentarité entre plaisir spirituel et plaisir charnel (dans le contexte de la mystique chrétienne notamment, mais pas seulement)
- Articulation, dans le discours religieux, du plaisir et de la douleur
- Affect à combattre ou à favoriser ? Les rôles et fonctions du plaisir dans l’édification morale
- Le plaisir « contre » la religion (cf. certains courants philosophiques comme le matérialisme ou l’épicurisme)
- Les voies du plaisir spirituel : utilisation et rendement des figures de rhétorique, de certains motifs picturaux ou musicaux
- Lexique et notions saisis dans une perspective synchronique ou diachronique : délectation, concupiscence, douceur, suavité, satisfaction
- Expression du plaisir et grammaire des affects (en français, mais aussi dans d’autres langues ; cf. l’importance du néologisme chez les mystiques, chez les piétistes allemands)
- Le plaisir religieux peut-il être traduit ? Comment transposer la grammaire des affects dans une autre langue ?
- Le plaisir dans les actes de dévotion (liturgie, prière, processions, cérémonies, etc.) à travers ses représentations dans le discours d’époque.
- Approches confessionnelles du plaisir (particularités, différences entre catholicisme et protestantisme, mais aussi et plus largement entre le christianisme et d’autres religions)
Les propositions d’environ 350-500 mots devront être accompagnées d’un CV actualisé. Ces documents sont à envoyer avant le 11 juillet 2025 aux adresses ci-dessous. Ils peuvent être rédigés en anglais ou en français.
- Groupe CAHSA : groupecahsa@gmail.com
- Arnaud Wydler (Université de Fribourg) : arnaud.wydler@unifr.ch
- Joy Palacios (University of Calgary) : joy.palacios@ucalgary.ca
Les candidat-e-s recevront une réponse de la part des organisateurs-trices avant le 15 septembre 2025. Pour les participant-e-s, les frais d’inscription au colloque s’élèveront respectivement à 50 CHF ($80 CAD) pour les professeur-e-s et maîtres de conférences et à 15 CHF ($25 CAD) pour les doctorant-e-s, ATER et chercheurs-euses indépendant-e-s.
Comité d’organisation :
Arnaud Wydler, Université de Fribourg
Anne Régent-Susini, Université Sorbonne Nouvelle
Corinne Bayerl, Université d’Oregon
Joy Palacios, University of Calgary
********************************************************************************************
CAHSA Conference
Call for Papers
Interdisciplinary Conference
Religion et plaisir (XVI-XVIIIe siècles) / Religion and Pleasure (16th-18th century)
December 11-13, 2025
Université de Fribourg (Switzerland)
The Collectif d’Anthropologie et d’Histoire du Spirituel et des Affects (CAHSA), in collaboration with the Fribourg Institute for Renaissance and Early Modern Studies, invites proposals for an interdisciplinary conference on the topic “Religion and Pleasure (16th-18th century).” The conference will be held December 11-13, 2025 in Fribourg (Switzerland).
Fear, guilt, asceticism, retreat, self-emptying or self-annihilation, and sacrifice often seem to be central to religious experience in modernity, closely linked to what Jean Delumeau called “the hatred of the flesh” (Delumeau, 1983). Bodily pleasures, whether regulated, contested, or forbidden, are readily posited as an obstacle to truth and redemption in an “age of suspicion.”
However, it becomes clear that religion entertains a more complex and nuanced relationship to pleasure when we look more closely at the traces of Christian culture from the 16th to the 18th centuries as preserved not only in texts but also in material objects, architecture, iconography or music. Rereading the Church Fathers, and Saint Augustine in particular, presents an opportunity not only for clergymen and theologians, but also for laymen and laywomen to reconsider pleasure in its nuance and complexity. Irreducible to a merely negative signifier as a sign of concupiscence, pleasure is at least considered as a useful tool to reach the hearts of Christians and to bring them to greater and truer pleasures. A group of thinkers as diverse as Lorenzo Valla, Marsile Ficin, Érasme, Gassendi, Angelus Silesius ou Pascal even consider pleasure as a ‘motor’ of individual or collective spiritual experience that may find expression in ecstatic visions cast in semi-erotic language. Or else, these thinkers consider pleasure as it manifests itself in the tenderness of spiritual friendships, or, in liturgical contexts, when waiting for the eucharist, praying in community, listening to a sermon etc. Pleasure can even become an intrinsic and major aspect of divine grace reflected in terms such as “douceur, délectation, délices, ravissement, joie, volupté céleste, flamme” (Sellier ; 1995 [1970]). Thus pleasure, oscillating between aesthetic impression and bodily (and at times violent) sensation, may be considered a key component of religious experience and expression
Nonetheless, the ambiguity of pleasure – a path to the divine and source of temptation all at once – makes it a suspect entity for numerous spiritual movements. In this respect, the example of the Reformation is emblematic because it breaks with the ostentatious esthetic of Catholicism in the name of a return to an inner faith that is purged of any sensuous excess, since images and music were suspected to further idol worshipping more than strengthening the faith of believers. Religion also forestalls forms of pleasure deemed deviant: both on the Catholic and the Protestant sides, worldly pleasures – game, dance, strolls, and above all theatre – become increasingly indicted and condemned. (Thirouin, 2007; Diekmann and Wild, 2011). These condemnations illustrate the extent to which the status of pleasure in regard to religion was a matter of debate throughout the Modern era. They also serve as a reminder that the status of pleasure turned out to be complex, often problematic and ambiguous from an ethical or moral point of view (Religion and the Senses in Early Modern Europe, 2012). These tensions motivated various ways of regulating pleasure in religious practices, oscillating between mystical valorization and moral rejection, between divine ecstasy and ascetic rigor. In addition, they illustrate confessional distinctiveness and points of conflict with regard to the role of the body, the senses, and the imaginary in religious experience.
As part of its next in-person event, the CAHSA colloquium proposes to engage in a reflection about the complex relationship between pleasure and religion in the Sixteenth, Seventeenth, and Eighteenth centuries. For this purpose, the organizing committee invites proposals for papers that may address the theological or philosophical discourse about the interaction – often ambiguous, sometimes even polemical – between religious culture and pleasure, and literary and visual representations of this encounter. Suggested areas of focus include, but are not limited to, the following:
- Definition and theory of spiritual pleasure in theological doctrines (such as Port-Royal’s “délectation victorieuse” or the “panhédonsime” that Jacques Le Brun sees in Bossuet’s works)
- Opposition and complementarity between pleasure of the spirit and of the flesh (for example in the context of Christian mysticism)
- The articulation of pleasure and pain in religious discourse
- Pleasure as an affect to either fight off or to nurture; the role and purpose of pleasure in moral edification
- Pleasure opposed to religion (cf. in certain philosophical traditions such as materialism and epicurism)
- The forms of spiritual pleasure: shape and use of rhetorical figures, visual or musical themes
- Terminology, either with a synchronic or diachronic approach: for example, for the French context, notions such as “délectation,” “concupiscence,” “douceur,” “suavité,” “satisfaction”
- Ways of expressing pleasure and the grammar of emotions (in French, but also in other languages; cf. the importance of neologisms among mystical writers or German pietists)
- Ways of translating religious pleasure: How to transpose the grammar of emotions into another language
- Pleasure in devotional acts (liturgy, prayer, processions, ceremonies, etc.) as represented in the discourse of a given era
- Confessional approaches to pleasure (specificity; differences between Catholicism and Protestantism, but also more broadly between Christianity and other religions)
Please submit a 350-500-word proposal (written in French or English), accompanied by a current CV, to the addresses below by July 11, 2025.
- Groupe CAHSA : groupecahsa@gmail.com
- Arnaud Wydler (Université de Fribourg) : arnaud.wydler@unifr.ch
- Joy Palacios (University of Calgary) : joy.palacios@ucalgary.ca
The organizing committee will notify candidates of their acceptance by September 15, 2025. For those who present papers, there will be a registration fee of 50 CHF ($80 CAD) for full-time faculty and 15 CHF ($25 CAD) for graduate students, part-time faculty, and independent researchers.
Organizing committee :
Arnaud Wydler, Université de Fribourg
Anne Régent-Susini, Université Sorbonne Nouvelle
Corinne Bayerl, Université d’Oregon
Joy Palacios, University of Calgary
Bibliographie sélective / Selected bibliography :
Boulègue, Laurence, et Lévy, Carlos (éd.), Hédonismes. Penser et dire le plaisir de l’Antiquité à la Renaissance, Presses universitaires du Septentrion, 2007
Cuchet, Guillaume, « Jean Delumeau, historien de la peur et du péché », Historiographie, religion et société dans le dernier tiers du 20e siècle, n° 107(3), p. 145-155.
Cyranka, Daniel, Ruhland, Thomas, Soboth, Christian et Stengel, Friedemann (dir.), Gefühl und Norm: Religion und Gefühlskulturen im 18. Jahrhundert. Beiträge zum V. Internationalen Kongress für Pietismusforschung 2018, Halle, Verlag der Franckeschen Stiftungen zu Halle, 2021.
Darmon, Jean-Charles, « Le gassendisme “frivole” de Saint-Évremond », Gassendi et l’Europe (1592-1792), éd. Sylvia Murr, Vrin, 1997, p. 57-69.
Darmon, Jean-Charles, Philosophie épicurienne et littérature au XVIIe siècle. Études sur Gassendi, Cyrano de Bergerac, La Fontaine, Saint-Evremond, Paris, Presses Universitaires de France, 1998.
Darmon, Jean-Charles, Philosophies du divertissement, le jardin imparfait des modernes, Paris, Desjonquères, 2009.
De Franceschi, Sylvio « Le concept de délectation victorieuse comme outil du coup de force polémique antijanséniste de Fénelon », Études théologiques et religieuses, t. 94, 2019/1.
-, « La controverse théologique par l’instruction pastorale. Délectation victorieuse et prémotion physique selon Fénelon : à propos de la Théologie de Châlons de Louis Habert (1711) », in J.-P. Gay et Ch.-O. Stiker-Métral (éd.), Les métamorphoses de la théologie. Théologie, littérature, discours religieux au XVIIe siècle, Paris, Honoré Champion, coll. « Colloques, congrès et conférences sur le Classicisme », 2012, p. 147-171.
-, « Le parti moliniste face à l’impossible mise en système de la doctrine janséniste. Le rôle de la notion théologique de délectation victorieuse dans la genèse de l’antijansénisme fénelonien », in L. Devillairs, A. Frigo et P. Touboul (éd.), Fénelon et Port-Royal, Actes de la journée d’études du 2 mars 2015, Paris, Classiques Garnier, coll. « Univers Port-Royal 28 », 2017, p. 11-36.
Dekoninck, Ralph, Ad Imaginem. Statuts, fonctions et usages de l'image dans la littérature spirituelle jésuite du XVIIe siècle, Genève, Droz, 2005.
Delumeau, Jean, Le Péché et la peur. La culpabilisation en Occident, XIIIe-XVIIIe siècles, Paris, Fayard, 1983.
Delumeau, Jean, Une histoire du paradis, t. 1 « Le jardin des délices » (1992), t. 2 « Mille ans de bonheur » (1995) et t. 3 « Que reste-t-il du paradis ? » (2000), Paris, Fayard, 1992-2000.
Deneys-Tunney, Anne et Moreau, Pierre-François (dir.), « L'épicurisme des Lumières », Dix-huitième Siècle, n°35, 2003.
Devillairs, Laurence, « Le plaisir en théologie : Port-Royal et ses adversaires », in S. De Franceschi et R. Mathis (éd.), Ruine et survie de Port-Royal (1679- 1713). Actes du colloque international organisé par la Société des Amis de Port-Royal, Paris, Port-Royal des Champs, 22-23 septembre 2011, Chroniques de Port-Royal, n°62, 2012, p. 149-166.
Diekmann, Stefanie et Wild, Christopher (dir.), Theaterfeinlichkeit und Antitheatralität, Munich, Fink, 2011
Dompnier, Bernard (dir.), Les Cérémonies extraordinaires du catholicisme baroque, Clermont-Ferrand, PU Blaise-Pascal, 2009.
Febvre, Lucien, « Comment reconstituer la vie affective d’autrefois ? La sensibilité et l’histoire », Combats pour l’histoire, Paris, Colin, 1952, p. 221-238.
Frevert, Ute (dir.) Emotional Lexicons. Continuity and Change in the Vocabulary of Feeling 1700-2000 (orig. Gefühlswissen, Frankfurt, Campus, 2011). New York et Oxford, Oxford University Press, 2014.
Gay, Jean-Pascal, Morales en conflit. Théologie et polémique au Grand Siècle (1640-1700), Paris, Éditions du Cerf, coll. « Histoire », 2011.
Gay, Jean-Pascal, « Sexualité et régime de normativité à l’âge confessionnel. Jalons et hypothèses pour une histoire de la focalisation religieuse sur la sexualité en catholicisme », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, vol. 147, 2020, p. 33-52.
Gimaret, Antoinette, Extraordinaire et ordinaire des Croix. Les représentations du corps souffrant, 1580-1650, Paris, Honoré Champion, 2011.
Gleixner, Ulrike (dir.), Religiöse Emotionspraktiken in Selbstzeugnissen: autobiographisches Schreiben vom 16. bis zum 20. Jahrhundert, Wiesbaden, Harrassowitz, 2024.
- (dir.), Dingliche Gottesliebe : die Materialität religiöser Emotionen in Christentum, Judentum und Islam, Wiesbaden, Harrasowitz, 2024.
Glucklich, Ariel, The Joy of Religion. Exploring the Nature of Pleasure in Spiritual Life, Cambridge, Cambridge University Press, 2020.
Hallett, Nicky, The Senses in Religious Communities, 1600-1800 Early Modern 'Convents of Pleasure', Londres-New-York, Routledge, 2013.
Harrison, Carol, « Delectatio victrix : gracia y libertad en San Agustín », Augustinus : Revista trimestrial publicada por los padres agustinos recoletos, 40, 1995, p. 105-110.
Karant-Nunn, Susan, The Reformation of Feeling. Shaping the Religious Emotions in Early Modern Germany, Oxford, Oxford University Press, 2010.
Lachaume, Agnès, Le langage du désir chez Bossuet : chercher quelque ombre d’infinité, Paris, Honoré Champion, 2017.
Le Brun, Jacques, « Une doctrine de la délectation », La Spiritualité de Bossuet prédicateur, Paris, Klincksieck, 1972, p. 339-351.
Macdonald, Robin, Murphy, Emilie et Swann, Elisabeth (dir.), Sensing the Sacred in Medieval and Early Modern Culture, London, Routledge, 2018
Moshenska, Joe, Feeling Pleasures: The Sense of Touch in Renaissance England, Oxford, Oxford University Press, 2014.
Nagy, Piroska, Le don des larmes au Moyen Âge. Un instrument en quête d’institution (Xe-XIIIe siècle), Paris, Albin Michel, 2000.
Piergiacomi, Enrico, Amicus Lucretius. Gassendi, il De rerum natura e l’edonismo cristiano, Berlin-Boston, De Gruyter, 2022.
Promey, Sally M. (dir.), Sensational Religion: Sensory Cultures in Material Practice, New Haven et Londres, 2014.
Quantin, Jean-Louis, Le Rigorisme chrétien, Paris, Éditions du Cerf, 2001.
Quantin, Jean-Louis, « Augustinisme, sexualité et direction de conscience : Port-Royal devant les tentations du duc de Luynes », Revue de l’histoire des Religions, 220, n°2, 2003, p. 167-207.
Religion and the Senses in Early Modern Europe, W. de Boer et Ch. Göttler (dir.), Leyde, Brill, 2012.
Roßbach, Nikola, Lust und Nutz: historische, geistlichem mathematische und poetische Erquickstunden in der Frühen Neuzeit, Bielefeld, Aisthesis Verlag, 2015.
Schieder, Martin, Au-delà des Lumières. La peinture religieuse à la fin de l’Ancien Régime, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2016.
Sellier, Philippe, « Les deux délectations », Pascal et saint Augustin, Paris, Albin Michel, coll. « Bibliothèque de l’Évolution de l’Humanité », 1995 [1970], p. 329-335.
Steinberg, Sylvie, « De la Renaissance aux Lumières », Une histoire des sexualités, partie 3, Paris, PUF, 2018, p. 171-264.
Steintrager, James, The Autonomy of Pleasure. Libertines, License, and Sexual Revolution, New York, Columbia University Press, 2016.
Taussig, Sylvie, « D’Épicure à Gassendi, plaisir et douleur, les passions critère du bien-vivre », Les Passions antiques et médiévales : Théories et critiques des passions, B. Besnier, P. Moreau et L. Renault éd., Paris, Presses Universitaires de France, 2003, p. 111-129.
Thirouin, Laurent, L’Aveuglement salutaire. Le réquisitoire contre le théâtre dans la France classique, Paris, Champion, 2007.
Trémolières, François, « La délectation », Fénelon et le sublime. Littérature, anthropologie, spiritualité, Paris, Honoré Champion, coll. « Lumière classique », 2009, p. 221-235.
Tsakiropoulou-Summers, Tatiana, « Tantum Potuit Suadere Libido : Religion and Pleasure in Polignac's Anti-Lucretius », Eighteenth-Century Thought, 2, 2004, p. 165-205.
Wels, Volkhard, « Brockes als galanter Dichter. Zur stilgeschichtlichen Verortung des Irdischen Vergnügens in Gott », Brockes-Lektüren. Ästhetik – Religion – Politik. Dir. Mark-Georg Dehrmann et Friederike Felicitas Günther, Bern, Peter Lang, 2019, 103-121.
Wiesner-Hanks, Merry E., Christianity and Sexuality in the Early Modern World. Regulating Desire, Reforming Practice, Londres-New York, Routledge, 2000.
Yamamoto-Wilson, John R., Pain, Pleasure and Perversity. Discourses of Suffering in Seventeenth-Century England, London, Routledge, 20




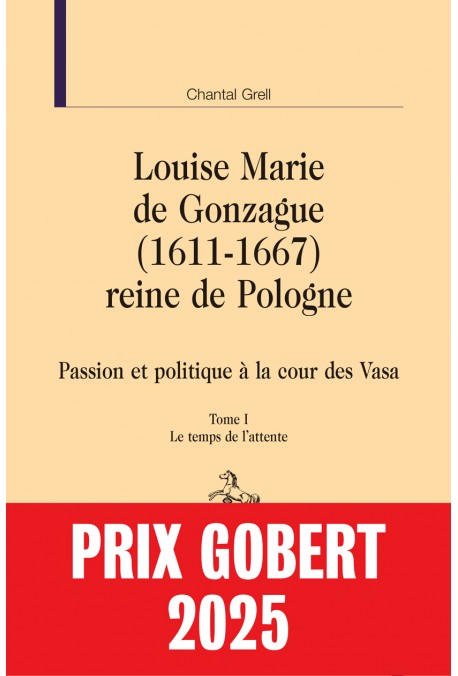 Chantal Grell, LOUISE MARIE DE GONZAGUE (1611-1667) REINE DE POLOGNE Passion et politique à la cour des Vasa. Tome I : Le temps de l'attente. Tome II : Le temps de l'action, Paris, H. Champion, 2024.
Chantal Grell, LOUISE MARIE DE GONZAGUE (1611-1667) REINE DE POLOGNE Passion et politique à la cour des Vasa. Tome I : Le temps de l'attente. Tome II : Le temps de l'action, Paris, H. Champion, 2024.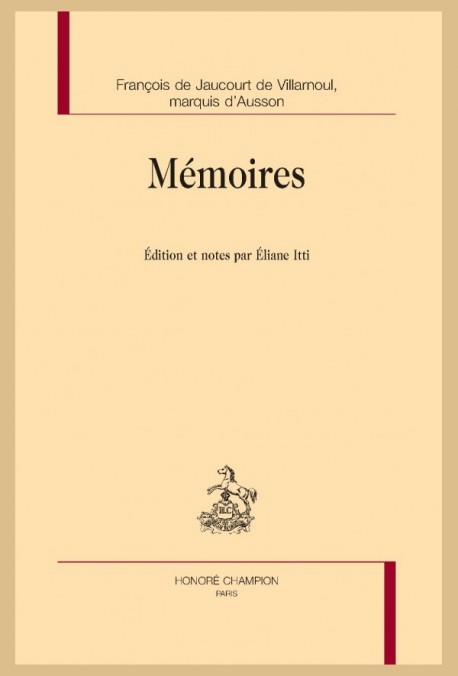 FRANÇOIS DE JAUCOURT DE VILLARNOUL, MARQUIS D'AUSSON, Mémoires, éd. Éliane Itti, Paris, H. Champion, 2025.
FRANÇOIS DE JAUCOURT DE VILLARNOUL, MARQUIS D'AUSSON, Mémoires, éd. Éliane Itti, Paris, H. Champion, 2025.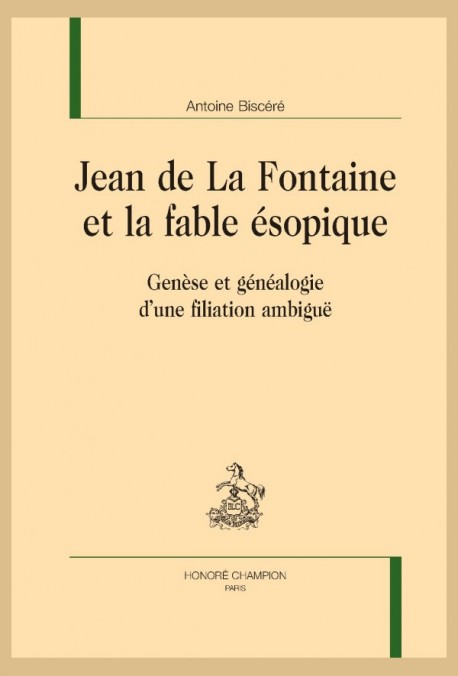 Antoine Biscéré, JEAN DE LA FONTAINE ET LA FABLE ÉSOPIQUE Genèse et généalogie d'un filiation ambiguë, Paris, H. Champion, 2025.
Antoine Biscéré, JEAN DE LA FONTAINE ET LA FABLE ÉSOPIQUE Genèse et généalogie d'un filiation ambiguë, Paris, H. Champion, 2025.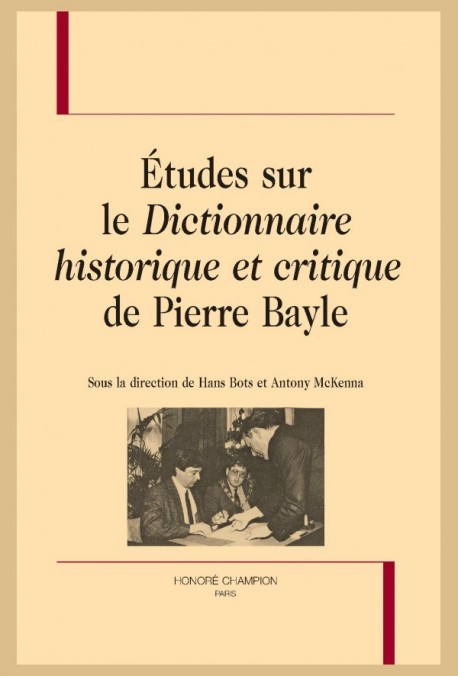 ÉTUDES SUR LE "DICTIONNAIRE HISTORIQUE ET CRITIQUE" DE PIERRE BAYLE
ÉTUDES SUR LE "DICTIONNAIRE HISTORIQUE ET CRITIQUE" DE PIERRE BAYLE