Pour son prochain numéro (2/3), Les Cahiers Linguatek, la revue biannuelle du Centre de Langues Modernes Appliquées et Communication « LINGUATEK » de l’Université « Gheorghe Asachi » de Iaşi, Roumanie, lance un appel à contributions sur le thème de l’AMBIGUÏTÉ.
Qu’elle soit lexicale, syntaxique ou contextuelle, involontaire ou volontaire, source de malentendus ou effort d’exprimer l’inexprimable, l’ambiguïté est l’un des thèmes de recherche les plus généreux et les plus fertiles. Voisinant avec toute une série de termes dont l’équivoque, l’incertain, l’ambivalent, le flou, le douteux ou l’amphibol(og)ique, l’ambiguïté nous crée, du coup, des doutes concernant ses enjeux et ses valeurs – est-ce un minus ou un plus ? Est-elle un défaut de clarté ou est-ce plutôt un excès de sens, par sa générosité interprétative ? Est-ce un mouvement concave ou convexe, dans la linéarité du discours ?
Notre publication est ouverte, comme nous l’avons déjà mentionné depuis ses débuts, aux chercheurs s’intéressant à la linguistique, psycholinguistique, littérature, didactique des langues, aussi bien qu’à la publicité, au cinéma & théâtre, aux arts du spectacle etc. Une section « Varia » de la revue est aussi ouverte, ainsi qu’une section réservée aux comptes-rendus des publications les plus récentes dans les domaines susmentionnés. Nous attendons vos propositions d’articles en français, anglais, espagnol, italien, allemand ou roumain jusqu’au 1 mars 2018, sur l’adresse evagrina.dirtu@tuiasi.ro.
Toutes les propositions (d’environ 3000 signes), accompagnés d’une petite fiche biobibliographique, seront évaluées par le comité scientifique et une notification d’acceptation ou de refus sera envoyé avant le 15 mars 2018 ; la date limite des articles in extenso (6-12 pages) des auteurs acceptés sera le 15 juin 2018 ; un template sera indiqué aux auteurs acceptés, en vue d’une rédaction standardisée. La publication en format électronique et papier est prévue pour le mois de novembre 2018 ; la taxe de publication sera de 15 euros (+ frais d’expédition au cas où le volume imprimé est demandé).
***
For its next issue (2/3), Linguatek Notebooks, the biannual journal of the Centre for Applied Modern Languages and Communication “LINGUATEK” of “Gheorghe Asachi” University of Iaşi, Romania, launches a call for papers on the topic of AMBIGUITY.
Whether lexical, syntactical or contextual, voluntary or involuntary, a source of misunderstandings or an effort to utter the unutterable, ambiguity is one of the most generous and fertile topics of research. Related to neighbouring terms such as the equivocal, the uncertain, the ambivalent, the vague, the doubtful or the amphibological, the ambiguity makes us doubt from the very beginning its stakes and its values – is it a minus or a plus? Is this a lack of clarity or rather an excess of sense, due to its interpretative generosity? Is this a concave or a convex movement, in the linearity of discourse?
Our journal is open, as stated from its establishment, to researchers in the fields of linguistics, psycholinguistics, literature, language teachings, as well as advertising, film and drama studies, performing arts studies, etc. A “Varia” section of the journal is also available, as well as a section dedicated to reviews of the latest publications in the abovementioned fields. We are waiting for your paper proposals in French, English, Spanish, Italian, German or Romanian by 1 March 2018, to the email address evagrina.dirtu@tuiasi.ro.
All abstracts (amounting to about 3000 characters), together with a short biobibliographical note, will be evaluated by the scientific committee and a notification of acceptance or refusal will be sent by 15 March 2018; the deadline for the accepted full-text papers (6-12 pages) will be 15 June 2018; a template with guidelines will be indicated to authors subsequently to acceptance. The publication, in electronic and paper format, is intended for the month of November 2018. The publication fees will be 15 Euros (+ shipping charges, in case the print issue is also demanded).
RESPONSABLE : Les Cahiers Linguatek de l'Université « Gheorghe Asachi » de Iasi, Roumanie http://limbistraine.tuiasi.ro/CLM.html
Source: Fabula




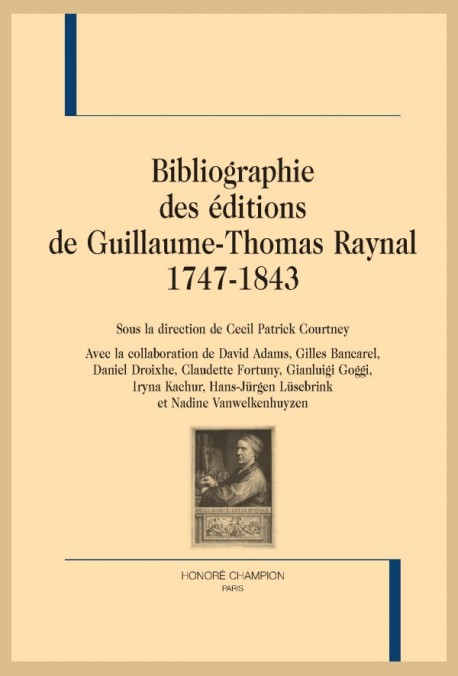 Bibliographie des éditions de Guillaumme-Thomas Raynal, 1747-1843, dir. cecil Patrick Courtney, Paris, H. Champion, 2021.
Bibliographie des éditions de Guillaumme-Thomas Raynal, 1747-1843, dir. cecil Patrick Courtney, Paris, H. Champion, 2021.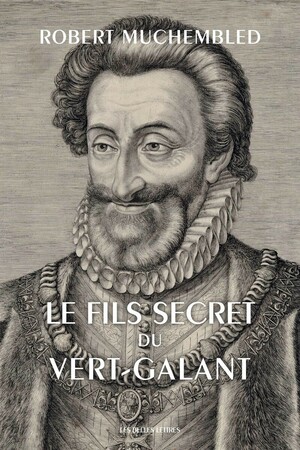 Robert Muchembled, Le Fils secret du Vert-galant, Paris, Belles Lettres, 2021.
Robert Muchembled, Le Fils secret du Vert-galant, Paris, Belles Lettres, 2021.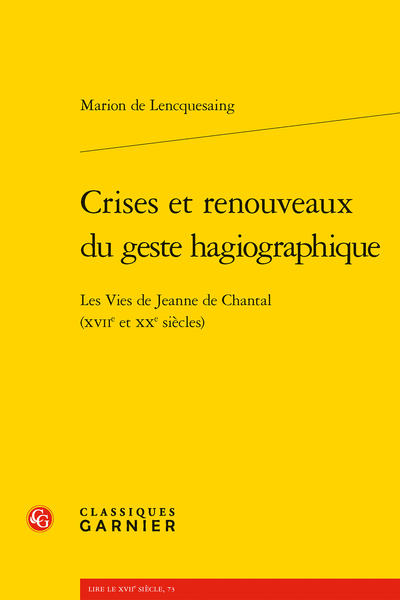 Marion de Lencquesaing, Crises et renouveaux du geste hagiographique. Les Vies de Jeanne de Chantal (xviie et xxe siècles), Paris, Classiques Garnier, 2021.
Marion de Lencquesaing, Crises et renouveaux du geste hagiographique. Les Vies de Jeanne de Chantal (xviie et xxe siècles), Paris, Classiques Garnier, 2021.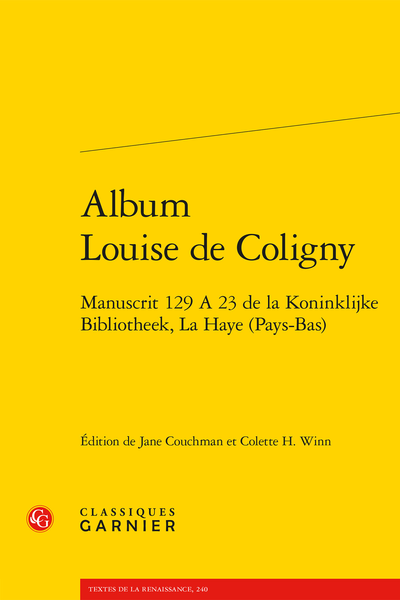 Album Louise de Coligny Manuscrit 129 A 23 de la Koninklijke Bibliotheek, La Haye (Pays-Bas) , éd. Couchman (Jane), Winn (Colette H.), Paris, Classiques Garnier, 2021.
Album Louise de Coligny Manuscrit 129 A 23 de la Koninklijke Bibliotheek, La Haye (Pays-Bas) , éd. Couchman (Jane), Winn (Colette H.), Paris, Classiques Garnier, 2021.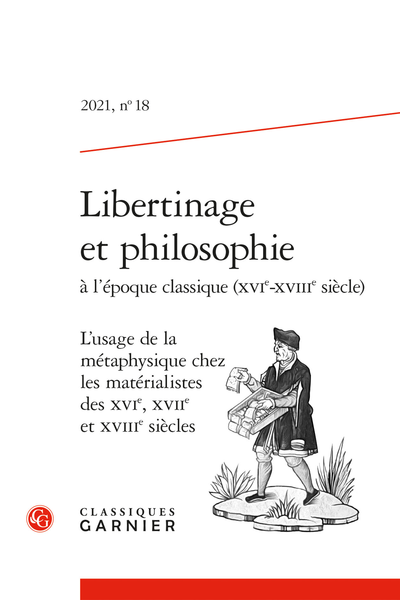 Libertinage et philosophie à l'époque classique (XVIe-XVIIIe siècle), 2021, n° 18 : "L’usage de la métaphysique chez les matérialistes des xvie, xviie et xviiie siècles".
Libertinage et philosophie à l'époque classique (XVIe-XVIIIe siècle), 2021, n° 18 : "L’usage de la métaphysique chez les matérialistes des xvie, xviie et xviiie siècles".