Corps possibles et mondes parallèles:
Que font l’anticipation et la science-fiction aux arts de la scène ?
Vendredi 23 mars 2018
Université Toulouse Jean Jaurès
Organisation : Florence Fix et Flore Garcin-Marrou
LLA CREATIS (Université Toulouse Jean Jaurès)
CEREdI (Université Rouen-Normandie)
En envisageant différentes scènes (théâtre, danse, cirque, performance, marionnette) sans restriction d’aires géographiques ni d’époque, ce projet entend appréhender ce que l’anticipation et la science-fiction font aux arts de la scène, à la représentation des corps et à la dramaturgie.
D’une part, des corps fictionnels hybrides, augmentés (en capacités) ou soustraits (à l’espace social, aux identités genrées), des corps-machines, dupliqués, sans mémoire ou au contraire matriciels et porteurs de mémoire vive forment les mythologies de leur transformation, de leur devenir, de leur exploitation ou de leur augmentation voire de leur dépassement. D’autre part, ces corps porteurs de mondes possibles appellent la construction de récits au présent ou au futur, alternatifs, utopiques/dystopiques, uchroniques, technologiques, prospectifs, interplanétaires, post-apocalyptiques, eschatologiques… impliquant un autre rapport à l’espace et au temps : c’est à partir du futur – et non plus seulement des histoires passées – que notre présent peut être mis à distance et transformé.
Force est de constater que c’est au théâtre et par le théâtre que s’est fait connaître le récit science-fictionnel, par les adaptations, mais surtout par cette volonté des artistes, à l’orée du XXe siècle, d’inventer un nouveau corps et un nouveau théâtre, qui ne regarderait plus vers le passé pour composer des personnages et des situations exemplaires, mais bien vers un futur dont on ne sait rien et dont on a tout à imaginer. Les différentes hypothèses de « théâtre de l’avenir » (Wagner), de « théâtre du futur[1] » (Meyerhold) vont dans le sens d’un théâtre de recherche, dont le propre est de dépasser les limites spatio-temporelles de la scène et les limites physiques de l’acteur, en remplaçant ce dernier par la machine (Marinetti), des marionnettes (Craig 1905, Maeterlinck) ou par le robot (Karel Capek, RUR, 1921), poussant à un point extrême la rivalité avec l’androïde et l’anxiété face à la menace de la disparition de l’humanité.
Si les textes de théâtre d’anticipation et science-fictionnels sont rapidement supplantés par les récits filmiques, les séries télévisées et leurs codes spécifiques de représentation, ils demeurent un champ divers et peu étudié, dont il faut toutefois remarquer qu’il est aujourd’hui très vivace.
Sur fond d’emballement d’une post-modernité engagée dans une course technologique et sécuritaire, se font en effet plus aigües les questions de survie à la menace nucléaire (Edward Bond, Le Crime du XXIe siècle, 2001 ; Harald Müller, Le Radeau des morts, 2010), aux guerres bactériologiques (Pauline Sales, La Bosse, 2000), à la catastrophe écologique (conférence performée WOW ! de Frédéric Ferrer sur nos possibilités de vivre ailleurs, 2015). En abordant l’éternelle jeunesse grâce à la machine à remonter le temps (Jean-Pierre Sarrazac, Vieillir m’amuse !, 1996), la vie débarrassée de la maladie ou de la dégénérescence biologique, congédiant le deuil de l’autre (France-fantôme de Tiphaine Raffier, 2017), l’avènement d’une nouvelle forme de conscience et l’expérimentation médicale à des fins militaires (Gildas Milin, Anthropozoo, 2003) ou la coexistence fraternelle entre l’humain et le robot pris dans le vertige de l’ennui et du refus de sa servitude (Hataraku Watashi - Moi, travailleur d’Oriza Hirata, 2008), ce théâtre se constitue comme herméneutique du social et du politique, abordant les dérives scientifiques, les dilemmes éthiques, l’aliénation au travail, l’exigence de perfection, la performance transhumaniste, le contrôle du ventre des femmes… À quelles réalités augmentées font appel ces représentations ?
Or, si ces fictions sont ouvertement pessimistes quant à l’avenir de l’humain, le théâtre science-fictionnel peut aussi être farcesque et hallucinatoire (comme dans le « drame spatial » d’Hervé Blutsch, Gzion, 2010) ou adopter le comique de l’absurde dans Corps diplomatique d’Halory Goerger, produit par l’Amicale de production, où des artistes sont envoyés dans l’espace pour produire une œuvre universelle dans un mouvement créatif continu, arpentant le champ de l’art à l’infini, dans un module spatial baptisé Jean Vilar.
Mais le recours du théâtre au genre science-fictionnel ne saurait se limiter aux thématiques science-fictionnelles, le théâtre affirmant alors une ambition de précéder et d’accompagner les grands changements de société. Conjuguer le théâtre au futur vise à consacrer la scène en tant que laboratoire de nouveaux modes d’existence, en tant que lieu de tous les possibles, dans une confiance renouvelée accordée à la fiction et à ses lectures, qu’elle soit proprement humaine et convoitée par les intelligences extra-terrestres en 5.000 après JC (Rafael Spregelbrud, La Paranoïa, 2009), queer et féministe (Donna Haraway), potentielle (Aliocha Imhoff, Kantuta Quiros, Camille de Toledo, Les Potentiels du temps, Manuella éditions, 2016), réparatrice (Emilie Notéris, La Fiction réparatrice, Les Presses du réel, 2017), accélérationniste (Nick Smicek et Alex Williams, « Manifeste accélérationniste », revue Multitudes, n° 56, 20014/2), compensatoire, indécidable, jubilatoire…
Ce projet entend donc, sans exhaustivité, interroger dans leur rapport aux arts de la scène :
Corps augmentés ou diminués, identités queer, hybridations biologie-machine
Deuil, déploration, absence, mémoire des corps, catastrophe
Dramaturgies inter-espèces, interstellaires, quantiques
Fictions, contre-fictions, adaptations, narrations spéculatives
Théâtres prospectifs, d’anticipation, du futur, à venir
Écriture et lecture du futur, portraits de l’artiste en cyborg…
Fictions et récits hybridés de discours scientifique
Une journée d’études, organisée avec Aline Wiame (ERRAPHIS, UT2J), le 23 mars 2018 à l’Université Toulouse Jean Jaurès ouvrira les débats, en rapport avec la pièce PRLMNT 1 de Camille de Toledo, mise en scène par Christophe Bergon, programmée du 22 au 28 mars 2018 au Théâtre National de Toulouse.
http://www.tnt-cite.com/content/fr/spectacle/215/PRLMNT---Episode-I
Les chercheurs et auteurs intéressés par le projet collectif peuvent le rejoindre sans avoir participé à la journée d’études.
Les propositions d’interventions et/ou d’articles (1/2 page) accompagnées de quelques lignes de bio-bibliographie seront adressées à Florence Fix (florence.fix[@]gmail.com) et Flore Garcin-Marrou (flore.gm[@]gmail.com) le 1er mars 2018 au plus tard. Les articles, après acceptation du comité de lecture, seront à remettre le 1er juillet 2018.
[1] Meyerhold, Écrits sur le théâtre, T. 1, Lausanne, L’Age d’homme, [1973], 2001, p. 124.
Source: Fabula




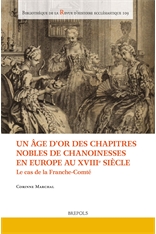 Corinne Marchal, Un âge d'or des chapitres nobles de chanoinesses en Europe au XVIIIe siècle. Le cas de la Franche-Comté, Turnhout, Brepols, 2021.
Corinne Marchal, Un âge d'or des chapitres nobles de chanoinesses en Europe au XVIIIe siècle. Le cas de la Franche-Comté, Turnhout, Brepols, 2021.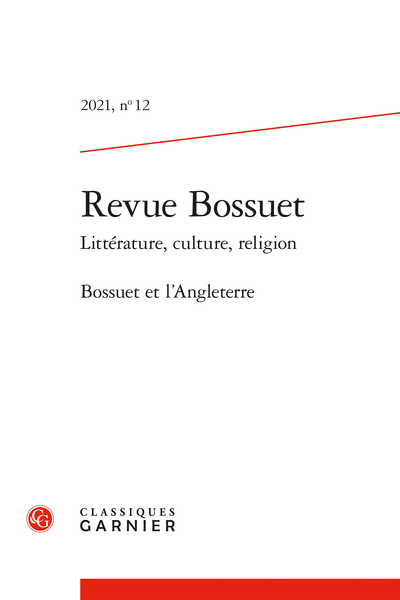 Revue Bossuet. Littérature, culture, religion, 2021, n° 12 : "Bossuet et l’Angleterre".
Revue Bossuet. Littérature, culture, religion, 2021, n° 12 : "Bossuet et l’Angleterre".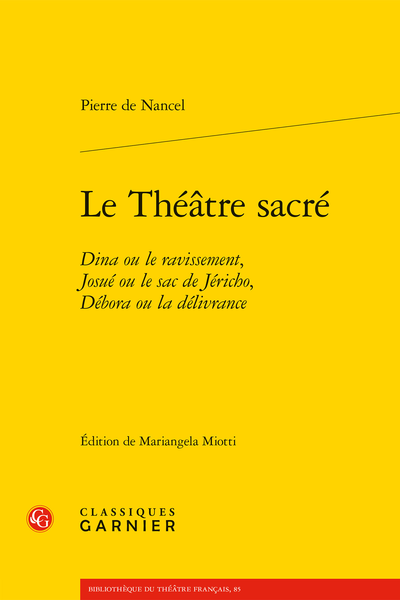 Pierre de Nancel, Le Théâtre sacré. Dina ou le ravissement, Josué ou le sac de Jéricho, Débora ou la délivrance, éd. Mariangela Miotti, Paris, Classiques Garnier, 2021.
Pierre de Nancel, Le Théâtre sacré. Dina ou le ravissement, Josué ou le sac de Jéricho, Débora ou la délivrance, éd. Mariangela Miotti, Paris, Classiques Garnier, 2021.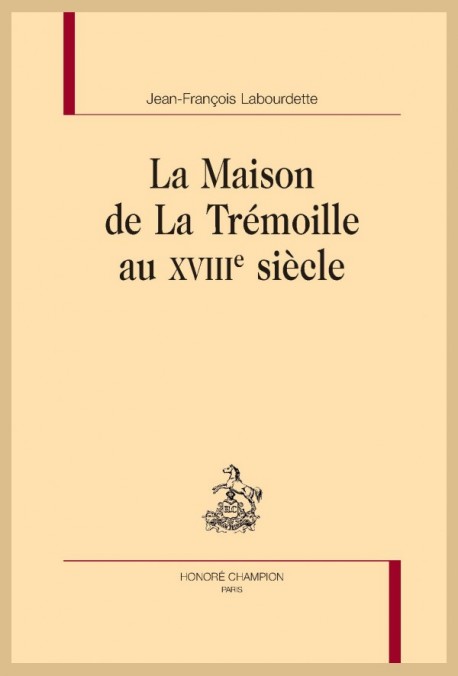 Jean-François Labourdette, La Maison de La Trémoille au XVIIIe siècle, Paris, H. Champion, 2021.
Jean-François Labourdette, La Maison de La Trémoille au XVIIIe siècle, Paris, H. Champion, 2021.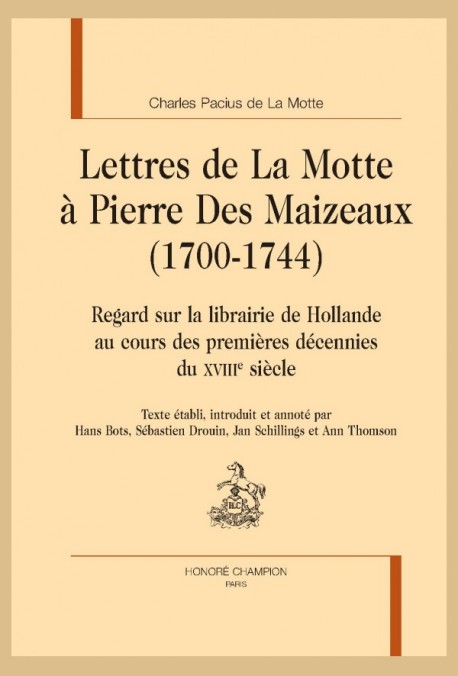 Lettres de La Motte à Pierre des Maizeaux (1700-1744), éd. Hans Bots, S. Drouin, J. Schillings et A. Thomson, Paris, H. Champion, 2021.
Lettres de La Motte à Pierre des Maizeaux (1700-1744), éd. Hans Bots, S. Drouin, J. Schillings et A. Thomson, Paris, H. Champion, 2021.