République tunisienne
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Université de Kairouan
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Kairouan
L’École doctorale « Nouveaux horizons en langues, en lettres, en arts et en humanités » de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Kairouan organise un colloque international portant sur :
Le discours préfaciel
Du 16 au 18 avril 2018
L’œuvre, considérée comme la finalité de la création littéraire, a toujours été au centre de l’entreprise critique. De la sociologie à l’anthropologie en passant par la psychologie, la linguistique et la philosophie, l’œuvre a fait l’objet des approches les plus diverses. L’étude des textes traditionnellement considérés comme secondaires, tels que la préface, l’avant-propos ou le prologue est, en revanche, un phénomène relativement récent. Dans Seuils, un des ouvrages de référence sur la question, Gérard Genette étudie les rapports qui relient le texte à sa périphérie, composée des textes parallèles, ou « paratextes », que sont le titre, le sous-titre, l’avant-propos, la dédicace, la postface, etc. Dans le prolongement de Palimpsestes ou la littérature au second degré, où avaient été abordées les différentes relations qu’un texte peut avoir avec d’autres textes (la transtextualité), Seuils montre, notamment, le rôle déterminant du discours préfaciel, qui peut aussi bien « assurer au texte une bonne lecture » que mettre en œuvre une véritable stratégie de réception. En effet, la préface occupe une place privilégiée parmi les paratextes recensés par Genette. S’efforçant de repérer ses différents types, l’auteur de Seuils en a établi une classification précise, qui distingue des préfaces« auctoriale »,« ultérieure »,« tardive »,« actoriale »ou encore « allographe ». Ainsi, considérée sous toutes ses coutures, la préface devient un objet d’étude en soi.
Le discours préfaciel n’est pas seulement en rapport avec le texte qu’il introduit, il est aussi intimement lié aux autres « paratextes » (tels que le titre, l’épigraphe, les entretiens ou le témoignage), permettant de déceler leurs structures et leur rapport à l’énonciation.Henri Mitterand l’a bien vu lorsqu’il a considéré, dans son Discours du roman, que la préface était le lieu qui indiquait les fondements du discours, mais aussi les lois de la communication linguistique considérées dans leurs rapports au contexte et à la situation d’énonciation avec ses différentes composantes : le destinateur et le destinataire, le jeu des pronoms, les déictiques, les structures linguistiques, etc. De fait, le texte introductif n’est pas simplement un texte en marge du texte ; si, en apparence, il a le statut d’un texte de circonstance, il joue un rôle déterminant dans la réception de l’œuvre en lui conférant, d’entrée de jeu, une identité spécifique. Ainsi, ce « seuil du texte » peut attirer le lecteur dans les filets de l’œuvre, le parer contre d’éventuelles méprises du sens, lui fournir les outils nécessaires à la compréhension des circonstances qui ont suscité la naissance du texte, et même attester l’évolution socioculturelle de toute une vision du monde, en indiquant les structures mentales, symboliques et idéologiques de la société.
Certes, le discours préfaciel a suscité, à ce jour, des études nombreuses et variées. Portant sur des œuvres littéraires, plastiques, et même scientifiques, celui-ci a donné lieu à des réflexions dans divers domaines, tels que la linguistique, la philosophie ou l’esthétique. En témoignent les travaux d’Henri Mitterand, mais aussi ceux de Jacques Derrida, de Philippe Lejeune, de Claude Duchet, de John Herman, de Philippe Lane, d’Elisabeth Zawisza, d’Anne Cayuela et de bien d’autres, qui ont interrogé le discours préfaciel en essayant de comprendre son fonctionnement, mais aussi ses fonctions et ses effets sur les autres discours. Cependant, ces études elles-mêmes nous invitent à mener la réflexion plus loin, en approfondissant les questions que suscite encore le discours préfaciel, notamment à la lumière de l’analyse du discours. Cette réflexion peut porter sur les questions suivantes :
Quels sont les différents rapports entre le discours préfaciel et le texte ?Peut être interrogée, dans ce sens, la dialectique entre le texte et sa périphérie, entre l’imaginaire et le réel, entre le langage et le métalangage.
Comment appréhender la spécificité du discours préfaciel dans les divers genres ?Et peut-on considérer ce type de discours comme un genre ?
Quel lien peut-il y avoir entre le discours préfaciel et le discours et le manifeste?
Quelle relation peut-on dégager entre le discours préfaciel et l’appareil péritextuel (titres, épigraphes, notes…) ?
Peut-on parler d’une typologie des préfaces ? Et quels seraient les rapports entre ces éventuels types?
Dans quelle mesure les préfaces allographes ont-elles contribué à faire connaître les œuvres et à renforcer leur diffusion, comme cela a été le cas dans les préfaces de Taoufik Baccar ?
Comment lire les préfaces des traducteurs et quelle peut être leur importance dans la diffusion du savoir ?
Dans quelle mesure l’éditeur peut-il influer sur la réception de l’œuvre par l’intermédiaire du préfacier?
Comment peut-on lire le discours préfaciel à travers la pluralité des approches, telles que l’approche sémiotique, cognitive, herméneutique ou encore celle de l’analyse du discours ?
Le discours préfaciel peut-il « obscurcir » le texte au lieu de l’éclairer ?
Modalités de participation :
Les propositions (une page au maximum, en indiquant les mots-clés) sont à envoyer à l’adresse ecoldoc@gmail.com avant le 10 mars 2018.
Celles-ci peuvent être en arabe, en français ou en anglais.
Les propositions acceptées seront fixées au plus tard le 19 Mars.
Les textes des communications sont à envoyer au plus tard le 10 avril.
Les textes retenus par le comité de lecture devront répondre aux normes de mise en page suivantes :
Police Times New Roman, corps 12 dans le texte et 10 dans les notes de bas de page.
Les numéros des notes doivent êtres réinitialisés à chaque page.
La note, dans la première occurrence, doit être indiquée comme suit :
Nom de l’auteur, titre, lieu d’édition, éditeur, volume, date, page.
Indiquer la bibliographie à la fin du texte.
L’École doctorale de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Kairouan se charge du déplacement à l’intérieur du territoire et du séjour des communicants pendant la durée du colloque, ainsi que de la publication ultérieure des travaux acceptés par le comité.
Pour tout contact, veuillez utiliser l’adresse électronique ecoldoc@gmail.com.
Comité scientifique :
Professeurs : Ridha Ben Hamid, Mohamed Atallah, Abderrazak Majbri, Belgacem Tabbabi, Abdelaziz Chebil, Lahdhili Yahya, Hamadi Sammoud, Mohamed-Slaheddine Cherif, Mohamed Chaouch, Monjia Mensiya, Mabrouk Manaï, Jalila Triter, Mohamed Khbou, Khaled Ghribi, Mohamed-Moncef Louhaibi, Nacer Ladjimi, Bechir Oueslati, Taoufiq Aloui, Abdelaziz Messaoudi, Machhour Mustafa, Houcine Hammouda, Amna Belaala, Taher Rouayniya, Mohamed Khatabi, Saïd Yaktine, Khaled Belgacem.
Comité d’organisation :
Ridha Ben Hamid,Mohamed Atallah,Belgacem Tabbabi,Lahdhili Yahya, Hatem Selmi, Abdelmonaem Chiha, Monia Abidi, Ridha Labiyadh, Nidhar Hammami, Hadhami Abdelwahed, Dhahbi Youssef, Modamed-Mehdi Makdoud, Monji Omri, Habib Bouabdallah, Sobha Sassi, Jihen Souki, Nouri Mbarek.
RESPONSABLE : L'École doctorale « Nouveaux horizons en langues, en lettres, en arts et en humanités » de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Kairouan
http://ecoldoc.e-monsite.com
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Kairouan
Source: Fabula




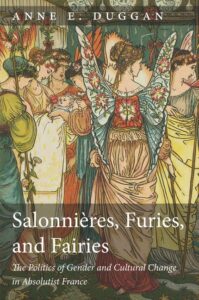 Anne E. Duggan, Salonnières, Furies, and Fairies: The Politics of Gender and Cultural Change in Absolutist France, University of Delaware Press, 2021 (2nd edition).
Anne E. Duggan, Salonnières, Furies, and Fairies: The Politics of Gender and Cultural Change in Absolutist France, University of Delaware Press, 2021 (2nd edition).  Les Textes voyageurs des périodes médiévale et moderne, dir. Isabelle Trivisani-Moreau et Sandra Contamina, Presses universitaires de Rennes, 2021.
Les Textes voyageurs des périodes médiévale et moderne, dir. Isabelle Trivisani-Moreau et Sandra Contamina, Presses universitaires de Rennes, 2021.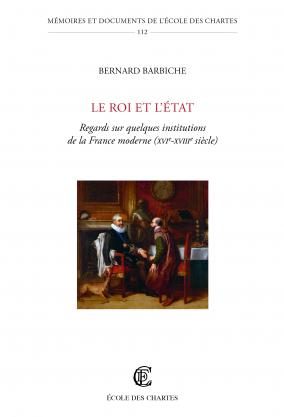 Le Roi et l'État Regards sur quelques institutions de la France moderne (XVIe-XVIIIe siècle), dir. Bernard Barbiche, Paris, Les éditions de l'École des charte, 2021.
Le Roi et l'État Regards sur quelques institutions de la France moderne (XVIe-XVIIIe siècle), dir. Bernard Barbiche, Paris, Les éditions de l'École des charte, 2021.
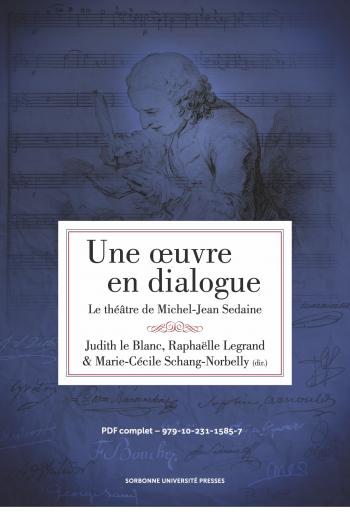 Une oeuvre en dialogue. Le théâtre de Michel-Jean Sedaine, dir. Judith le Blanc, Raphaëlle Legrand et Marie-Cécile Schang-Norbelly, Paris, Sorbonne Université presses, coll. "e-Theatrum Mundi", 2021.
Une oeuvre en dialogue. Le théâtre de Michel-Jean Sedaine, dir. Judith le Blanc, Raphaëlle Legrand et Marie-Cécile Schang-Norbelly, Paris, Sorbonne Université presses, coll. "e-Theatrum Mundi", 2021.