SI CE COLLOQUE VOUS INTÉRESSE, PRIÈRE DE CONTACTER HÉLÈNE CUSSAC AUSSITÔT QUE POSSIBLE POUR APPUYER LA PRÉPARATION DU DOSSIER DE SUBVENTION.
XXXIIIe Colloque international de la SATOR
Université Jean Jaurès - Toulouse - PLH-ELH
17-19 mai 2019
Appel à communication
Sons, voix, bruits, chants : place et sens du sonore dans l'analyse topique des textes narratifs d’Ancien Régime
La SATOR (Société d’analyse des topiques romanesques, http://satorbase.org), sous l’égide dulaboratoire Patrimoine-Littérature-Herméneutique (PLH) et de l’Équipe Littérature Herméneutique (ELH) organise son colloque international annuel de l’année 2019 à l’Université Jean Jaurès de Toulouse. Il s’agira d’examiner non seulement la place et le sens qu’a pu tenir le sens de l’ouïe dans les textes narratifs d’Ancien Régime, mais surtout de se demander en quelle mesure l’objet sonore participerait de la scène topique, voire lui donnerait parfois tout son sens, au point que sons et bruits pourraient peut-être être compris comme des topoï.
1 – Son et topos : prolégomènes théoriques
« Défini comme configuration narrative récurrente, le topos constitue l’unité de base du travail de la SATOR » (« Avant-Propos », Actes du XVIIIe Colloque SATOR, P. U. de Laval, Québec, 2006, p. XI). Cette définition fait que dans un premier temps la présence du son dans un texte ne peut en elle-même être considérée comme une configuration - ou scène - narrative. Pourtant, outre le fait que le son, sur un plan épistémologique et anthropologique, revêt du sens pour un chercheur, la thématique des sons et des bruits dans les textes narratifs d’Ancien Régime (du Moyen Âge à la toute fin du 18e siècle) se prête bien, semble-t-il, à une étude topique. Certes, nous viendront immédiatement à l’esprit des scènes romanesques telles que celles de la leçon de musique, où du fait même de l’inscription d’un instrument, on peut imaginer que le son est présent. Néanmoins, si ce moment narratif est récurrent, du moins dans des romans du 18e siècle, on sait que la leçon est souvent prétexte à un échange d’ordre sentimental ; l’instrument est donc là au service de la narration, il revêt une fonction pragmatique et le son n’est pas ce qui intéresse : il n’en est d’ailleurs parfois pas fait mention. Mais est-ce toujours le cas ? On sait que les Lettres neuchâteloises de madame de Charrière se lisent au son de la basse, du violon, de l’alte, de la harpe, du clavecin et de la flûte, jusqu’à la mort du personnage (Caliste) dont le dernier plaisir est de faire « exécuter des morceaux du Messiah de Haendel, d’un Miserere qu’on lui avait envoyé d’Italie, et du Stabat Mater de Pergolèse » (éd. Trousson, 1996, Lettre 25, p. 474). Trouve-t-on, par exemple, d’autres « morts romanesques » imprégnées de musique et si c’est le cas, ne peut-on entendre le son – bien que n’entrant pas ici en tant que tel dans la langue – comme topos ? Si l’on considère la scène comme représentative de la mort d’un personnage, c’est bien la présence de la musique qui affine la configuration topique. On ne pourrait considérer, dans cet exemple, qu’il y a topique seulement à partir de la mort du personnage ; on ne peut en effet définir la scène topique, à suivre le modèle du thesaurus de la Sator, que de la façon suivante : « mort de personnage avec musique » (sachant, selon la Sator, que l’on peut parler de topique à partir du moment où l’on rencontre au moins trois occurrences de la configuration). Ne pourrait-on par conséquent envisager le morceau de musique et à travers lui le son, dans la situation d’une mort de personnage, comme topos ayant permis de créer la scène topique ? Les démonstrations et discussions lors du colloque auront pour tâche de réfléchir à cette interrogation.
2 – Sensible sonore du Moyen-Âge à 1800 : questionnements
Pensons par exemple encore aux fictions s’ouvrant sur un personnage découvrant un Paris résonnant de bruits de carrosses, de chevaux et de cris des marchands ambulants. Cette scène, dont la dimension sociologique est patente, est récurrente dans des récits du 18e siècle. Ne peut-on parler toutefois de topique dès le Moyen-Âge, cette période vivant sous le régime de « l’oralité mixte » (Zumthor, La lettre et la voix de la « littérature médiévale », 1987) non seulement du point de vue de la configuration (« entrée dans une ville ») mais aussi de la présence sonore qui contribue à l’élaboration de la scène topique (« entrée dans une ville bruyante ») ? Le son est-il alors plus ou moins prégnant ? La langue le prend-elle en charge ? On réfléchira donc non seulement à la topique sur la continuité, mais aussi à la place et au rôle du sonore.
Il semble intéressant en effet d’observer si ce sens singulier qu’est l’ouïe a été intégré dans le narratif. La vue est le sens primordial du Moyen Âge au 18e siècle. L’ouïe fut placée au second rang au Moyen Âge, parfois à égalité avec la vue au 18e siècle. Les penseurs des Lumières, du fait de sa relation avec la voix, comprirent l’importance première de l’ouïe qui permettait le commerce avec autrui. La voix, chantée notamment, perçue comme pure car naturelle, donna ses lettres de noblesse à l’ouïe, et même si le 17e siècle, sous l’influence janséniste, dénonçait le plaisir des sens, notamment celui de l’ouïe, il prisait la grande éloquence chez des ecclésiastiques dont la voix résonnait puissamment à l’oreille de leurs ouailles.
Les textes narratifs – en prose et en vers - prirent-ils en compte l’intérêt des théoriciens qui débattaient des sensations, et si ce fut le cas, qu’en fut-il particulièrement du son ?
Au Moyen Âge, comme l’a montré récemment l’ouvrage collectif dirigé par Florence Bouchet et Anne-Hélène Klinger-Dollé (Garnier 2015), « les cinq sens ont généré abondance de productions artistiques et d'écrits à visée scientifique, spirituelle, morale et littéraire ». Mais si un sens comme celui de la vue est utile le plus souvent au service de la description qui donne son cadre à la scène, celui de l’ouïe revêt un intérêt semble-t-il plus profond : dès le Moyen Âge il représente en effet un « objet de savoir » ainsi que le démontre par exemple le « bestiaire sonore » offert en appendice au grand livre de J.-M. Fritz (Paysages sonores du Moyen Âge..., Champion 2000). Le sonore animal entre-t-il alors dans des scènes narratives médiévales et si c’est le cas, peut-on parler de topique sonore ? Si la sensorialité dans les récits de ce temps a été bien étudiée depuis une vingtaine d’années (voir La cloche et la lyre..., J.-M. Fritz, 2011 ; M. Zink, Nature et poésie au Moyen Âge, Fayard 2006 ; Bruits et sons dans notre histoire..., J.-P. Gutton, 2000 ; etc.), il serait pertinent d’approfondir cette donnée à partir de la notion de topos, et d’observer aussi ce qu’il en est entre Moyen Âge - Renaissance et 17e siècle. Jusqu’à quand perdure par exemple la représentation de la coutume du charivari qui fait son entrée dans les documents dès le début du 14e siècle ? Ces représentations forment-elles une topique sonore ?
Le 16e siècle, se préoccupant lui aussi de la hiérarchie des sens et remarquant que l’oreille n’est « jamais oisive » (Pierre Boaistuau, Bref discours de l’excellence et dignité de l’homme, Droz 1982, p. 52), lui donne toute sa dignité. N’est-elle pas en effet l’organe qui conduit le plus sûrement à la connaissance, comme l’affirme Rabelais ? (« [...] tous jours, toutes nuyctz, continuellement, puissions ouyr : et par ouye perpetuellement apprendre : car c’est le sens sus tous aultres plus apte es disciplines », Tiers Livre, XVI, à propos de la Sibylle de Panzoust). Mais le 16e siècle ne s’en tient pas aux notions théoriques sur le sens de l’ouïe ; il tente de mettre en mots les sons, quitte parfois à en passer par les couleurs ; il essaie de rendre visible par exemple une scène de bataille, scène topique s’il en est, mais dans un tableau qui désormais intégrerait le sonore (cf. l’évolution de Rabelais au cours des rééditions du Quart Livre, dont la poétique cherche à exprimer toujours davantage les bruits du monde). Lié au développement de l’imprimé, il cherche à représenter un monde vivant, une parole vive. Ainsi le narratif ne chercherait-il pas à libérer les « paroles gelées » qu’Alcofribas voulait emporter ? Ne dit-il pas l’ordre – et le désordre - de l’espace sonore ? (voir L. Hublot et L. Vissière, Les paysages sonores du Moyen-âge à la Renaissance, P. U. Rennes, 2016).
Au Grand siècle, hormis du côté des mondains, tel que Théophile de Viau, ou encore Gassendi, les sens, sous l’influence austère du jansénisme ambiant et l’influence des traités de savoir- vivre publiés depuis le 16e siècle jusqu’aux Art[s] de se taire (pour reprendre le titre de l’ouvrage de l’abbé Dinouart, 1771), se trouvent moralement condamnés : « Ne vous étonnez point, s’il ne raisonne pas bien à présent, une mouche bourdonne à son oreille [...] chassez cet animal » (Pascal, Pensées, fr. 8, Classiques Garnier, 1991, p. 180). Même un petit animal devient un divertissement sonore malvenu. Mais le roman ne semble pas épouser cette dénonciation : de quelle façon en effet Mlle. de Chartres est-elle touchée au coeur par M. de Nemours si ce n’est, au moment de la rencontre, d’abord par le grand bruit qui se fait à l’entrée de ce dernier dans la salle de bal puis à sa vue ? Le 17e siècle ne correspond-il pas aussi à cet Âge de l’éloquence, bien étudié par M. Fumaroli (1980) ? Sans oublier qu’à partir de la deuxième moitié du 17e siècle jusqu’à la première moitié du 18e, l’intérêt se porta tout particulièrement sur le rôle des sens — dont celui de l’ouïe — comme critères de jugement du beau.
La présence du son dans le narratif qui fait sans doute le lien avec les préoccupations scientifiques du temps pourrait donc là aussi être interrogée. Nombre de ces textes sont effectivement imprégnés de chant et de musique et si la séquence de la leçon de musique est bien un topos du roman du 18e siècle, comme on l’a évoqué, à partir de quel moment les sonorités vocales et musicales font-elles leur entrée dans les textes narratifs ? Peut-on remarquer une récurrence de certaines scènes ? Le 18e siècle, même s’il montre une prédilection pour les sons naturels et apprécie particulièrement le chant qui ravit l’âme de l’auditeur, d’une certaine manière réhabilite le bruit en tant qu’il témoigne de l’énergie humaine : on pensera à tous les romans de Diderot et à la performance vocale du Neveu de Rameau qui témoigne de ce dynamisme, mais aussi à la fin du siècle au Tableau de Paris de L.-S. Mercier (voir les travaux d’A. Farge). Tout un monde sonore emplit l’espace textuel du roman du 18e siècle et l’écriture cherche à rendre l’expérience sensible (voir les romans et journaux de Marivaux ; de Rousseau ; de Diderot, pour ne citer qu’eux). L’intégration du sonore dans un récit ne se fait donc plus seulement dans un objectif pragmatique au service de la narration, mais le son devient peut-être parfois lui-même un objet narratif.
3 – Axes
Si les points d’entrée du sonore apparaissent donc nombreux, on pensera non seulement à sa récurrence, offrant la possibilité d’identifier une scène topique, mais aussi aux continuités, aux ruptures éventuelles, et aux nouveautés dans la place qui lui est accordée au cours de la longue période envisagée. Le topos est en effet « un objet historique et à ce titre constitue un témoin précieux pour l’historien de la littérature » (M. Weil et P. Rodriguez, 1996, http://satorbase.org/index.php?do=outils); « Un topos naît et meurt » (Jan Hermann, satorbase.org) ; parfois peut-être renaît : les travaux devraient nous permettre d’examiner ce point. On sera attentif aussi à la signification (morale, sociologique, politique, philosophique...) que revêt le son et si celle-ci est la même à chaque occurrence, ou à ce qui crée une modification du sens. On observera encore avec précision le lexique employé pour dire la présence sonore, au point de remarquer si on retrouverait les mêmes phrases et/ou mots dans des scènes d’autres récits, comme le montre le thesaurus de la SATOR (http://satorbase.org/index.php?do=categorie).
Associé dans la tradition rhétorique à l’inventio, « le topos est [en effet] intimement lié à la formation et à l’évolution des genres narratifs », peut-on lire sur le site de la SATOR qui a pris soin de mettre à la portée des intervenants des outils théoriques (http://www.satorbase.org/index.php?do=outils#2.1). Bien que des travaux aient été plus nombreux depuis une dizaine d’années au sujet de notre objet (notamment concernant le Moyen Âge), peu l’ont observé sur la continuité et à partir de la notion topique. Il semble donc que ce colloque sera susceptible de les enrichir.
Le travail de recherche ne s’arrêtera pas au genre romanesque, mais s’élargira à d’autres types de textes narratifs tels que :
- Des récits à l’intérieur de livrets d’opéra
- Des chansons (cris de Paris)
- L’écrit narratif en vers
- Le texte mi-documentaire/mi-fictionnel (exemple du Tableau de Paris, déjà évoqué) Les axes thématiques pourront être définis par :
- Le sonore de la nature humaine (bruit du corps, voix inarticulée)
- La représentation sonore des institutions (Monarchie, Église...)
- Le sonore matériel : bruits d’objets (instruments de musique, cloches, instruments de travail, armes, etc.)
- Le sonore animal
- Le son de la nature végétale, aérienne (tonnerre, etc.)
(NB : si aux 17e et 18e siècles, on a porté la réflexion sur la distinction entre son et bruit, et si cette distinction est intéressante sur le plan esthétique, elle présente moins de pertinence dans l’approche thématique qui est la nôtre, donc nous employons l’un ou l’autre mot indistinctement dans cette présentation).
Hélène Cussac
Les propositions sont à envoyer à Hélène Cussac : elencussac@orange.fr
Date limite : 30 septembre 2018
Mais, en vue du montage du dossier de subvention auprès du Conseil scientifique dès maintenant, il serait bienvenu de signaler le plus rapidement possible votre intention de participer en faisant parvenir les informations suivantes :
- Le sujet envisagé – voire le titre de la communication (même provisoire) –
- votre statut
- votre université et unité de rattachement
Comité scientifique :
Florence Bouchet (Université Jean Jaurès-Toulouse II-ELH-bouchet@univ-tlse2.fr )
Pascale Chiron (Université Jean Jaurès-Toulouse II-ELH- pascale.chiron@univ-tlse2.fr)
Jean-Pierre Dubost (Université Blaise Pascal-Clermont II – ex-Président de la SATOR dubost.jeanpierre@gmail.com)
Jean-Philippe Grosperrin (Université Jean Jaurès- Toulouse II-ELH-grosperr@univ-tlse2.fr) ;
Madeleine Jeay (Université McMaster, Canada) – ex-Présidente de la Sator jeaymad@mcmaster.ca)
Stéphane Lojkine (Université d’Aix-en-Provence - stephane.lojkine@univ-amu.fr )
Catriona Seth (Université d’Oxford – Présidente de la SFEDS - catriona.seth@modlangs.ox.ac.uk)
Yen-Maï Trans-Gervat (Université Paris 3) – Présidente de la Sator - yen-mai.trangervat@ univ-paris3.fr
Comité d’organisation à l’Université Jean Jaurès – Toulouse-PLH/ELH :
Hélène Cussac : elencussac@orange.fr
Pascale Chiron : pascale.chiron@univ-tlse2.fr
Cristina Noacco : cnoacco@yahoo.fr




 Nicolas Morel, De l'encre aux Lumières. La Famille Cramer et la librairie genevoise sous l'Ancien Régime, Genève, Slatkine, 2021.
Nicolas Morel, De l'encre aux Lumières. La Famille Cramer et la librairie genevoise sous l'Ancien Régime, Genève, Slatkine, 2021.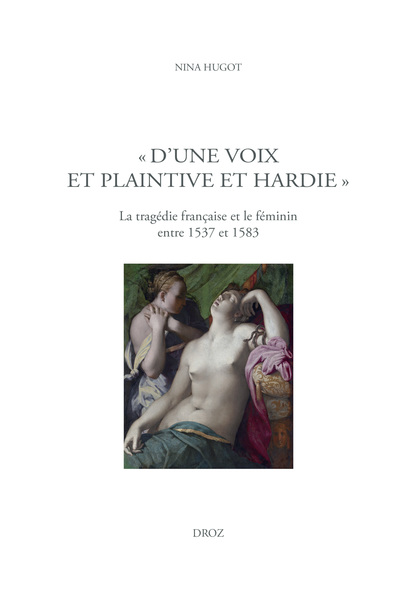 Nina HUGOT, « D'une voix et plaintive et hardie » La tragédie française et le féminin entre 1537 et 1583, Genève, Droz, 2021.
Nina HUGOT, « D'une voix et plaintive et hardie » La tragédie française et le féminin entre 1537 et 1583, Genève, Droz, 2021.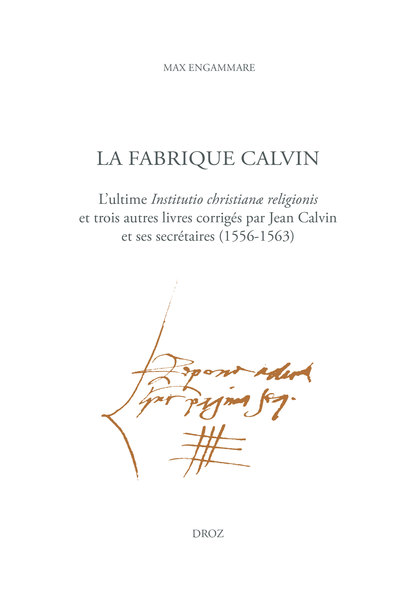 Max Engammare, La Fabrique Calvin. L'ultime Institutio christianæ religionis et trois autres livres corrigés par Jean Calvin et ses secrétaires (1556-1563), Genève, Droz, 2021.
Max Engammare, La Fabrique Calvin. L'ultime Institutio christianæ religionis et trois autres livres corrigés par Jean Calvin et ses secrétaires (1556-1563), Genève, Droz, 2021.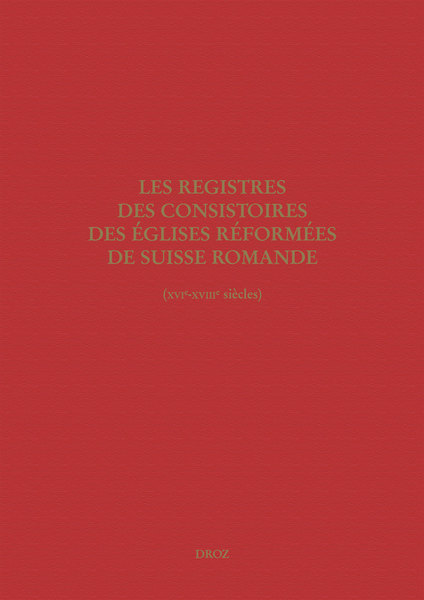 Les Registres des consistoires des Églises réformées de Suisse romande (XVIe-XVIIIe siècles). Un inventaire, éd. Christian GROSSE, Michèle ROBERT, Nicole STAREMBERG, Amélie ISOZ, Salomon RIZZO, Genève, Droz, 2021.
Les Registres des consistoires des Églises réformées de Suisse romande (XVIe-XVIIIe siècles). Un inventaire, éd. Christian GROSSE, Michèle ROBERT, Nicole STAREMBERG, Amélie ISOZ, Salomon RIZZO, Genève, Droz, 2021.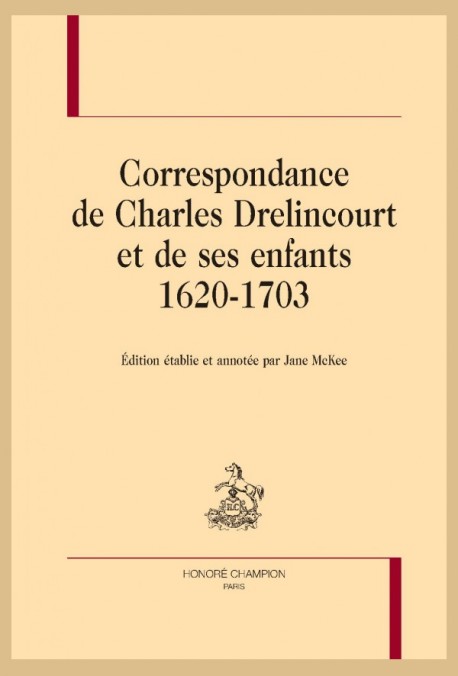 CORRESPONDANCE DE CHARLES DRELINCOURT ET DE SES ENFANTS, 1620-1703, éd. Jane McKee, Paris, H. Champion, 2021.
CORRESPONDANCE DE CHARLES DRELINCOURT ET DE SES ENFANTS, 1620-1703, éd. Jane McKee, Paris, H. Champion, 2021.