Ghent University (Belgium), 20-22 September 2018
CONFIRMED KEYNOTE SPEAKERS:
Liz Prettejohn (University of York)
Mark Vessey (University of British Columbia)
Irene Zwiep (University of Amsterdam)
ADVISORY BOARD: Liz Prettejohn (University of York) – Irene Zwiep (University of Amsterdam) – Anders Cullhed (University of Stockholm) – Elizabeth Tyler (University of York) – Ingela Nilsson (university of uppsala) – Marinus Burcht Pranger (University of Amsterdam) – Bart Van Den Bossche (University of Leuven) – Rita Beyers (University of Antwerp) – Jürgen Pieters (Ghent University) – Marco Formisano (Ghent University)
“Der einzige Weg für uns, groß, ja, wenn
es möglich ist, unnachahmlich zu werden, is
die Nachahmung der Alten.”
Johannes Winckelmann
Classics played a major and fundamental role in the cultural history of Western Europe. Few would call this into question. Since the Carolingian period, notably ‘classical’ literature has served as a constant source and model of creativity and inspiration, by which the literary identity of Europe has been negotiated and (re-)defined. The tendency to return to the classics and resuscitate them remains sensible until today, as classical themes and stories are central to multiple contemporary literary works, both in ‘popular’ and ‘high’ culture. Think for instance of Rick Riordan’s fantastic tales about Percy Jackson or Colm Tóibín’s refined novels retelling the Oresteia.
At the same time, this orientation and fascination towards the classics throughout literary history has often —implicitly or explicitly— gone hand in hand with the cultivation of a certain normativity, regarding aesthetics, content, decency, theory, ... Classical works, and the ideals that were projected on them, have frequently been considered as the standard against which the quality of a literary work should be measured. Whether a text was evaluated as ‘good’ or ‘bad’ depended on the extent to which it could meet the ‘classical’ requirements. Probably the most famous example of someone advocating such a classical norm was the German art critic Johannes Winckelmann (1717-1768), whose death will be commemorated in 2018. His Geschichte der Kunst des Altertums may be considered as the embodiment of the idea that the classics should be the norm for aesthetic or even any evaluation, such as, in Western Europe, it has recurrently cropped up, to a greater or lesser degree, from the Early Middle Ages until modern times.
Almost inevitably, this normativity has implied, shaped and fed prejudices and thoughts of exclusion towards literary features and aesthetic characteristics that seemed to deviate from classical ideals. Throughout literary history, examples occur of literary works, styles and genres that were generally appreciated within their time or context of origin, yet whose quality was retrospectively called into question because they were said not to be in accordance with the classical norm as it prevailed at the moment of judgement. Sometimes, this has even applied to whole periods. The persistence of similar assessments up until today is telling for the impact classical normativity still exercises. Besides, literary texts, though clearly not created to conform to the ‘classical’ standard, have been ‘classicized’ during judgement, being forced by a critic to fit into a classical framework and celebrated for its so-called imitation of antiquity. Even the Classics themselves often had and have to obey to this process of ‘classicization’. Therefore, with a sense for drama, one could say that all these works, literary forms, periods, etc. have seriously ‘suffered’ from the prejudices born from classics-based normativity, being the ‘victims’ of Winckelmann-like ideas concerning ‘classical’ standards.
This conference aims to consider classical normativity with its including prejudices and exclusions as a case-study for cultural self-fashioning by way of European literature. It seeks to explore how the normative status ascribed to the classics and the ensuing prejudices have, from the Early Middle Ages to modern times, influenced and shaped thoughts and views of the literary identity of Western Europe. Therefore, we propose the following questions:
- What are the processes behind this normativity of the Classics? Is it possible to discern a conceptual continuum behind the time and again revival of the Classics as the norm for ‘good’ literature? Or, rather, are there clear conceptual and concrete divergences between succeeding periods of such ‘classical’ normativity?
- What are the links (conceptual, historical, aesthetic, political, …) between the normativity of the Classics and the excluded ones, both in synchronic and diachronic terms? How does literary normativity of the Classics imply literary prejudices and exclusions?
- How has normativity of the Classics with its prejudices and exclusions imposed an identity on European literature (and literary culture)?
- What does this normativity of the Classics with its prejudices and exclusions mean for the conceptualization of European literary history?
Besides these conceptual questions, we also welcome case studies that may illustrate both the concrete impact of classical normativity and concrete examples of prejudice and exclusion as resulting from this normativity. We think of topics such as
- the Classics themselves as victims of retrospective ‘classical’ normativity
- the exclusion of literary periods that are considered non- or even contra-classical (baroque, medieval, …) and the clash with non-European literature
- literary ‘renaissances’ and their implications
- classical normativity and its impact on literatures obedient to political aims (fascism, populism, …)
- literary appeal to the classics as a way of structuring and (re-)formulating society (‘higher’ liberal arts vs. ‘lower’ crafts and proficiencies, literary attitudes towards slavery, …)
- …
We accept papers in English, French, German, Italian and Spanish. Please send an abstract of ca. 300 words and a five line biography to relics@ugent.be by 15 April 2018.
ORGANISATION: Wim Verbaal, Paolo Felice Sacchi and Tim Noens are members of the research group RELICS (Researchers of European Literary Identities, Cosmopolitanism and the Schools). This research group studies historical literatures and the dynamics that shape a common, European literary identity. It sees this literary identity as particularly negotiated through languages that reached a cosmopolitan status due to fixed schooling systems (Latin, Greek and Arabic), and in their interaction with vernacular literatures. From a diachronic perspective, we aim to seek unity within the ever more diverse, literary Europe, from the first to the eighteenth century, i.e. from the beginning of (institutionally organized) education in the cosmopolitan language to the rise of more national oriented education.




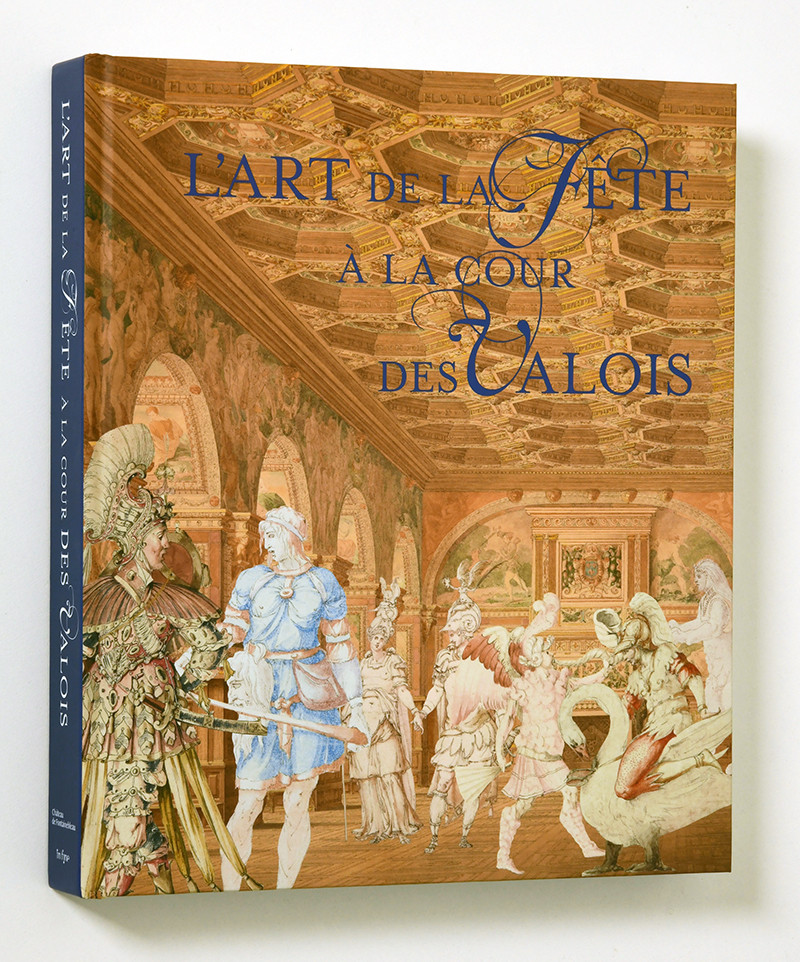 Oriane Beaufils, Vincent Droguet (dir.), L’art de la fête à la cour des Valois, Paris, In Fine éditions d’art, 2021, 320 pages, 260 illustrations, 42 € TTC.
Oriane Beaufils, Vincent Droguet (dir.), L’art de la fête à la cour des Valois, Paris, In Fine éditions d’art, 2021, 320 pages, 260 illustrations, 42 € TTC.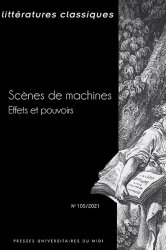 "Scènes de machines. Effets et pouvoirs", dir. Marine Roussillon, Kirsten Dickhaut, Littératures classiques, n° 105, décembre 2021, 222 p.
"Scènes de machines. Effets et pouvoirs", dir. Marine Roussillon, Kirsten Dickhaut, Littératures classiques, n° 105, décembre 2021, 222 p.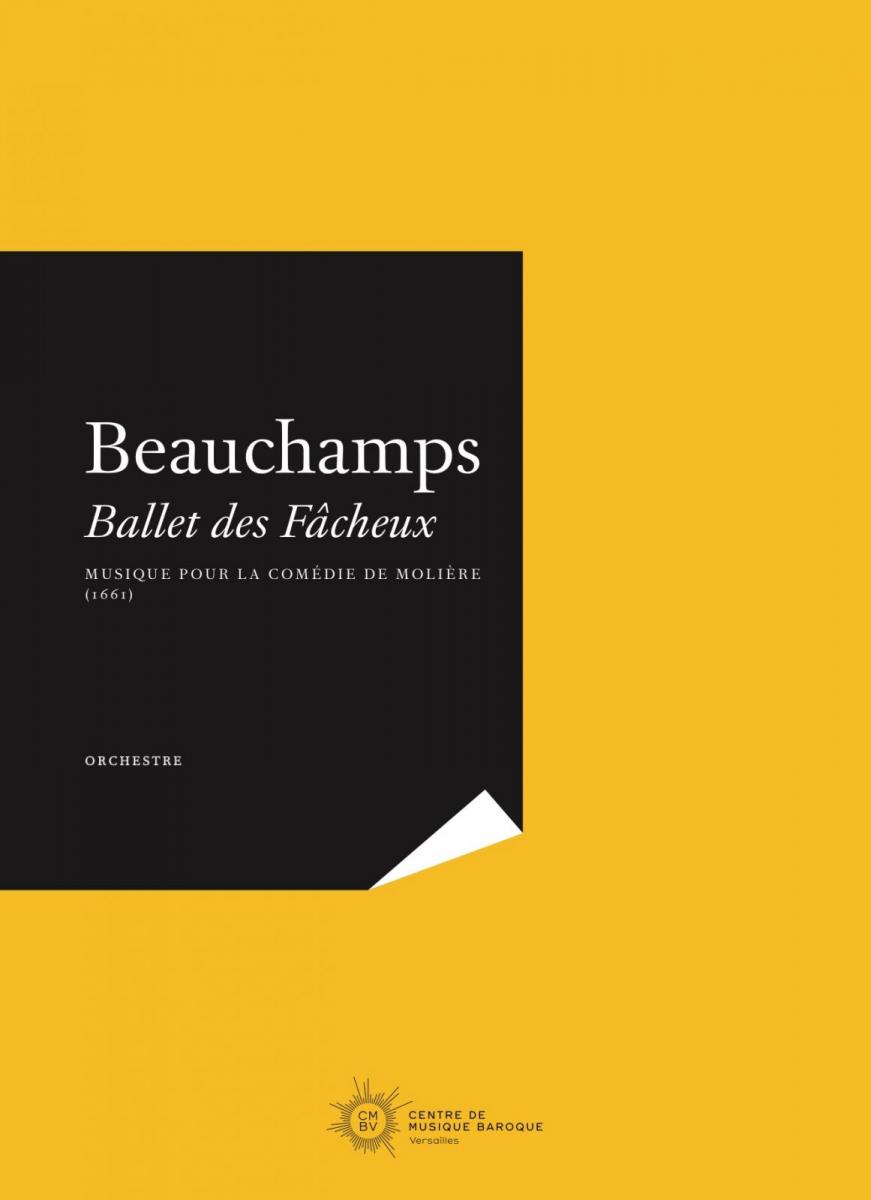 Pierre Beauchamps, Ballet des Fâcheux Musique pour la comédie de Molière (1661), éd. Matthieu Franchin, Versailles, Éditions du Centre de Musique Baroque de Versailles, 2021, 39 p., 30€.
Pierre Beauchamps, Ballet des Fâcheux Musique pour la comédie de Molière (1661), éd. Matthieu Franchin, Versailles, Éditions du Centre de Musique Baroque de Versailles, 2021, 39 p., 30€.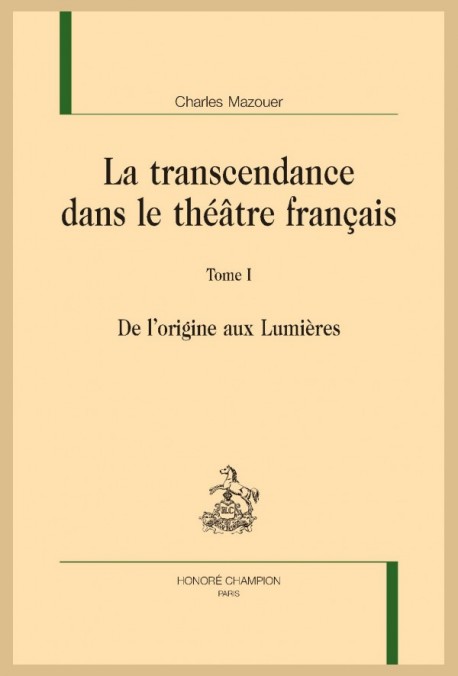 Charles Mazouer, La Transcendance dans le théâtre français. Tome I. De l'origine aux Lumières, Paris, H. Champion, 2021.
Charles Mazouer, La Transcendance dans le théâtre français. Tome I. De l'origine aux Lumières, Paris, H. Champion, 2021.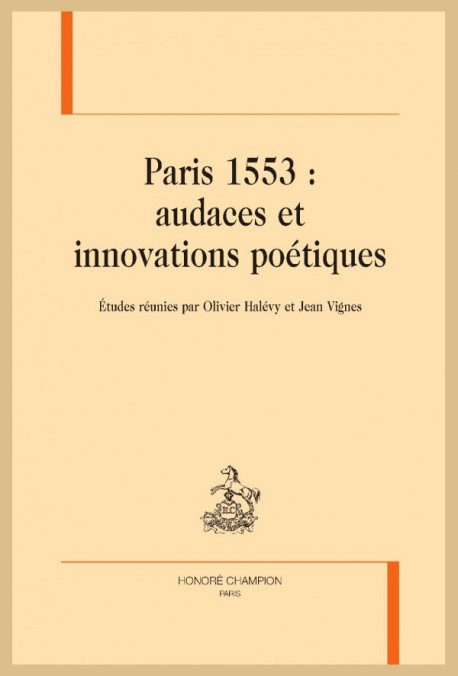 Paris 1553 : audaces et innovations poétiques, dir. Olivier Halévy et Jean Vignes, Paris, H. Champion, 2021.
Paris 1553 : audaces et innovations poétiques, dir. Olivier Halévy et Jean Vignes, Paris, H. Champion, 2021.