Université de Sfax, 25-26-27 octobre 2018
Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax
Colloque International du Département de Français
PRESENTATION
Notre proposition part d’un constat, celui d’un décalage entre, d’une part, la présence considérable de la prison et de ses différents avatars dans la production littéraire et artistique et, d’autre part, le nombre assez limité des études consacrées au sujet. Ce constat en cache un autre, plus précis : la plupart des travaux ayant abordé le motif de la prison, du moins en littérature, l’ont fait généralement de manière thématique, dans le sillage de l’ouvrage fondamental de Victor Brombert, La Prison romantique, centré sur les structures de l’imaginaire et inspiré par les études fondatrices de Gaston Bachelard et de Gilbert Durand.
Il s’agirait, dans le cadre de ce colloque, de traiter, non pas exclusivement le thème littéraire de la prison, mais plutôt la question de la prison. Car la prison pose véritablement question et se révèle un objet d’étude fondamentalement complexe et problématique, situé au carrefour de plusieurs domaines de la pensée (littérature, arts, mais aussi histoire, sociologie et philosophie), et par là même susceptible d’être appréhendé sous plusieurs angles d’attaque.
Une réflexion, prolongeant d’une certaine manière le travail de Victor Brombert, pourrait s’articuler autour des différents modes de représentation de la prison dans le champ littéraire et artistique, et analyser les multiples associations psychiques, imaginaires et existentielles qu’elle est à même de convoquer. Imprégnant souvent la manière dont le monde est perçu, la temporalité pénitentiaire a en effet ceci de particulier qu’elle situe le personnage en dehors du temps cyclique habituel, comme le montrent exemplairement La Métamorphose ou La Colonie pénitentiaire de Kafka.
L’état de réclusion peut altérer la perception du temps subjectif, contraindre la communication interpersonnelle, mettre à rude épreuve le corps et l’intimité, menacer l’intégrité morale et physique du sujet, mais il peut aussi, de manière assez paradoxale, favoriser et même déclencher l’acte de création, en confrontant le captif à une solitude à la fois douloureuse et féconde, et en ouvrant chez lui un regard autre, souvent réflexif et lucide, sur lui-même et sur le monde.
Une deuxième approche, portant essentiellement sur la sociopoétique de la prison, pourrait envisager la possibilité et l’intérêt d’une périodisation qui, tout en interrogeant la prégnance du paradigme de la prison au fil des siècles, essaierait, dans le sillage ouvert par les travaux de Michel Foucault et de Gilles Deleuze, d’avancer des hypothèses sur des liens significatifs entre les « aléas » de cette présence – son essor tout comme son déclin ou son éclipse périodiques – et l’existence d’une réalité historique, d’un discours idéologique ou d’une logique sociale de l’enfermement.
Serait aussi examinée complémentairement, sous cet angle, l’évolution de la perception de la prison, de la vision souvent romantique du XIXe siècle (que l’on pense à Hugo, Stendhal, Nerval ou encore Baudelaire) à la vision désenchantée ou, parfois, révoltée des productions contemporaines.
La prison, à travers ses nombreuses manifestations, pourra également être appréhendée dans une optique proprement métapoétique. L’analyse de la fonction symbolique et métaphorique des lieux de l’incarcération et de la claustration (le cachot, la geôle, la cellule, le bagne, le couvent, l’école, l’usine, la caserne, la maison close, l’asile, la résidence surveillée, le ghetto, les lieux de l’exil…) conduira nécessairement à l’exploration minutieuse de leur potentiel métapoétique.
Saisi ainsi dans une perspective de réflexivité ou de mise en abyme textuelle, le lieude l’enfermement pourra tour à tour renvoyer au psychisme du créateur, à la clôture (l’autonomie) de l’œuvre proprement dite, ou encore à la vocation ou à la définition même du créateur.
Sans prétendre à l’exhaustivité, quelques pistes de réflexion peuvent être suggérées. Ces propositions, nullement restrictives, indiquent simplement des directions de recherche. La priorité sera donnée aux sujets originaux et aux questionnements nouveaux et pluridisciplinaires autour de la problématique de la prison :
- Les imaginaires de la prison ou la prison à l’épreuve de l’expression littéraire et artistique : l’écriture et la production carcérales : formes, styles et ethos ; la prison entre « mythe » et réalité ; les distorsions de l’histoire et la fictionnalisation du vécu carcéral ; les postures, stratégies et scénographies auctoriales.
- La prison, le social et le politique : l’institution carcérale, les stratégies de contrôle et les mécanismes du pouvoir et du contre-pouvoir ; la prison et la marginalité ; la prison comme microcosme social, laboratoire d’observations et terrain d’affrontement idéologique.
- La prison et la création : quels rapports ? Créer en prison : contraintes de la réclusion et ingéniosité créatrice ; les « cris gravés » (Apollinaire) ; les supports d’expression picturale en milieu pénitentiaire (dessins, graffiti, tatouages…) ; les formes d’expression spontanées et brutes ; la création verbale : le jargon et l’argot de la prison ; les phénomènes linguistiques de cryptage, de dérivation, d’hybridation.
- La prison, entre hantise, conjuration et devoir de mémoire : le témoignage et ses valeurs (réparatrice, historique et documentaire) ; le pouvoir du texte, de l’image, du dessin ; catharsis et sublimation ; les thérapies artistiques et les ateliers de création en milieu carcéral.
- Les expériences de la prison : prison réelle, prison imaginaire, prison fantasmée ; les récits des camps et des prisonniers politiques ; l’appréhension de la temporalité et de la spatialité pénitentiaires ; le corps, l’intimité, la parole et l’identité en souffrance en milieu carcéral ; les détours et les stratagèmes de la communication carcérale.
- La prison comme métaphore : avatars, figurations et expressions de l’enfermement au fil des siècles ; les nouvelles prisons « modernes » (la société, l’école, l’entreprise, l’administration, Internet, les réseaux sociaux, la télévision…).
COMMUNICATIONS
Les propositions de communications (titre, résumé – une vingtaine de lignes –, 5 mots clés) seront accompagnées d'une courte notice bibliographique et envoyées au plus tard le 10 juin 2018 à l'adresse suivante : prisonentouteslettres@gmail.com
30 juin 2018 : notification de la liste des communications acceptées.
Les textes définitifs devront être envoyés dans le mois suivant le colloque à la même adresse électronique.
COMITE SCIENTIFIQUE
Mohamed BOUATTOUR (Université de Sfax)
Arbi DHIFAOUI (Université de Sfax)
Samia KASSAB CHARFI (Université de Tunis)
Kamel SKANDER (Université de Sfax)
Mustapha TRABELSI (Université de Sfax)
Dominique VIART (Université Paris X)
COMITE D'ORGANISATION
Dorra ABIDA FEKI (Université de Sfax)
Sameh BEN LAKHAL (Université de Sfax)
Hafedh BEN ALI (Université de Sfax)
Ola BOUKADI (Université de Sfax)
Wafa ELLOUMI (Directrice du Département de Français, Université de Sfax)
Fatma FAKHFAKH (Université de Sfax)
Yamen FEKI (Université de Sfax)
Yosra FRIKHA (Université de Sfax)
Taïeb HAJ SASSI (Université de Sfax)
Makki REBAI et Kamel Skander (Coordinateurs du colloque, Université de Sfax)
BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE :
ARDOUREL CROISY (Marion), « Parler en prison au XIXe siècle : la parole enfermée, un enjeu de pouvoir », in Sarga Moussa (dir.), Le XIXe siècle et ses langues, Actes du Ve Congrès de la Société des Études Romantiques et Dix-neuviémistes, http://etudes-romantiques.ish-lyon.cnrs.fr/wa_files/Langues-Ardourel.pdf
ARMAND (Jean-Michel), L’Argot des prisons, dictionnaire du jargon taulard et maton du bagne à nos jours, Paris, Horay, 2012.
BALANDIER (Franck), Les Prisons d’Apollinaire, Paris, L’Harmattan, 2001.
- Des poètes derrière les barreaux, Paris, L’Harmattan, 2012.
BEGUIN (Albert), L’Âme romantique et le rêve, Paris, Corti, 1939.
- « Les Poètes et la Prison », in Création et destinée, Neuchâtel, A la Baconnière, 1973.
BENJAMIN (Walter), Paris, capitale du XIXe siècle. Le Livre des Passages, en partic. le chapitre « L’intérieur et la trace ».
BERCHTOLD (Jacques), Les Prisons du roman : XVIIe-XVIIIe siècles : lectures plurielles et intertextuelles de Guzman d'Alfarache à Jacques le fataliste », Genève, Droz, 2000.
BESOZZI (Claudio), Les Prisons des écrivains. Enfermement et littérature aux XIXe et XXe siècles, Vevey, Editions de l'Aire, 2015.
BROMBERT (Victor), La Prison romantique. Essai sur l’imaginaire, Paris, Corti, 1976.
CARLETTI (Lorenzo), « Les graffitis des prisonniers politiques à Vicopisano (Pise) : une question de conservation », Fabula / Les colloques, Les éphémères, un patrimoine à construire, URL : http://www.fabula.org/colloques/document2932.php
COMBESSIE (Philippe), Sociologie de la prison, Paris, La Découverte, « Repères », 2009.
CROISY (Marion), La prison dans la littérature française du XIXe siècle. Représentations romanesques et imaginaire social de la modernité carcérale, Thèse de doctorat en littérature française dirigée par Paolo Tortonese et soutenue le 02-12-2016 à Sorbonne Paris Cité,
DEDEYAN (Charles), Stendhal : captivité et captif ou le mythe de la prison, Paris, Didier Erudition, 1998.
DELEUZE (Gilles), Pourparlers, Paris, Les Éditions de Minuit, 1994.
- « Post-scriptum sur les sociétés de contrôle », in Pourparlers 1972-1990, Les Éditions de Minuit, Paris, 1990.
DU CAMP (Maxime), « Les Prisons de Paris », in Revue des Deux Mondes, t. 83, 1869.
Ecriture et prison au début de l'âge moderne, dossier des Cahiers du Centre de Recherches Historiques, 39 | 2007, http://ccrh.revues.org/3345
EL BASRI (Aïcha), L’imaginaire carcéral de Jean Genet, Paris, L’Harmattan, coll. « Espaces littéraires », 1999.
FOUCAULT (Michel), Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975.
GOFFMAN (Erving), Asiles, Paris, Editions de Minuit, 1968.
HIGELIN (Audrey), « Habiter la prison : la question de l’espace carcéral dans l’œuvre
de Berthet One, ancien détenu devenu dessinateur », in https://criminocorpus.hypotheses.org/4438
KALIFA (Dominique), « Prisons à treize sous. Représentations de l’enfermement et imprimés de masse à la fin du XIXe siècle », Revue d’histoire du XIXe siècle, n° 20-21, 2000, p. 203-215.
Lettres d’exil, d’enfermement, de folie, Actes du colloque de Caen, 16-18 juin 1991, Paris, Champion, 1993.
MAYEN GUIMIER (Marthe), Prison vécue – Prisons imaginées au XIXe siècle, Thèse de doctorat, Grenoble III, 1989.
MÉCHOULAN (Eric), ROSELLINI (Michèle) et CAVAILLÉ (Jean-Pierre), dir., Ecrire en prison, écrire la prison (XVIIe-XXe siècles), Les Dossiers du Groupe de Recherches Interdisciplinaires sur l’Histoire du Littéraire, 01 | 2011, http://dossiersgrihl.revues.org/4874
MORAND (Bernadette), Les Écrits des prisonniers politiques, Paris, PUF, coll. « Sup. Section Littératures modernes », 1976.
PERROT (Michelle) (dir.), L’impossible prison. Recherches sur le système pénitentiaire français, Paris, Seuil, 1980.
- « Écrire en prison au XIXe siècle », in Les Ombres de l’histoire, Paris, Flammarion, 2001.
PETIT (Jean-Guy), « Les historiens de la prison et M. Foucault », in Sociétés et Représentations, n° 3, novembre 1996.
PETRESCU (Maria), L’image de la prison dans la littérature française et québécoise du XXe siècle, 2013,
https://uwspace.uwaterloo.ca/bitstream/handle/10012/7454/PETRESCU_MARIA....
POULET (Georges), « Piranèse et les poètes romantiques français », NRF, n° 160-161, avril-mai 1966, p. 660-671 et p. 849-862.
« PRIGIONI », numéro spécial de Lectures, V, 12, juin 1983.
« PRISONS », Romantisme, revue du XIX e siècle, n° 126, Paris, Armand Colin, 2004.
STAROBINSKI (Jean), L’Invention de la liberté, Genève, Skira, 1964.
- « Préface » à La Colonie pénitentiaire de Kafka, Fribourg, Librairie de l’Université de Fribourg, Paris, Egloff, 1945.
STEINMETZ (Jean-Luc), « Les Malheurs du récit », postface à Madame Putifar de Pétrus Borel, éd. Régine Deforges, 1972.
VARAUT (Jean-Marc), Poètes en prison, de Charles d’Orléans à Jean Genet, Paris, Perrin, 1989.
YOURCENAR (Marguerite), « Les prisons imaginaires de Piranèse », NRF, n° 97, janvier 1961, p. 63-78.
VARAUT (Jean-Marc), Poètes en prison, Paris, Perrin, 1992.
VIMONT (Jean-Claude), « Graffiti en péril », in Sociétés & représentations, n° 25, 2008, Éditions de la Sorbonne, p. 193-202 [en ligne : https://www.cairn.info/revue-societes-et-representations-2008-1-page-193...
- « Le caricaturiste enfermé. L’histoire de la justice en France et les représentations iconographiques » in Pascal Dupuy (dir.), Histoire, images, imaginaire, Pise, Edizioni Plus, 2002, p. 147-163.




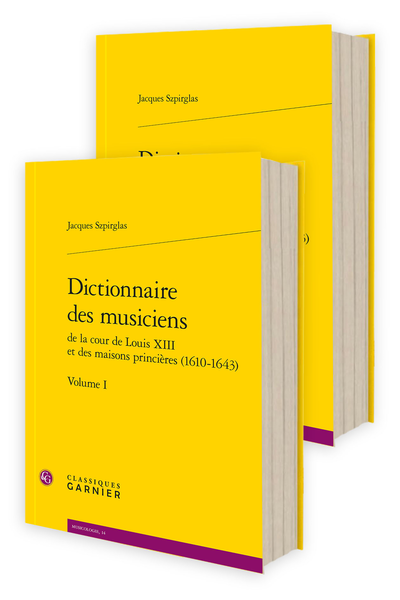 Jacques Szpirglas, Dictionnaire des musiciens de la cour de Louis XIII et des maisons princières (1610-1643), Paris, Classiques Garnier, 2021.
Jacques Szpirglas, Dictionnaire des musiciens de la cour de Louis XIII et des maisons princières (1610-1643), Paris, Classiques Garnier, 2021.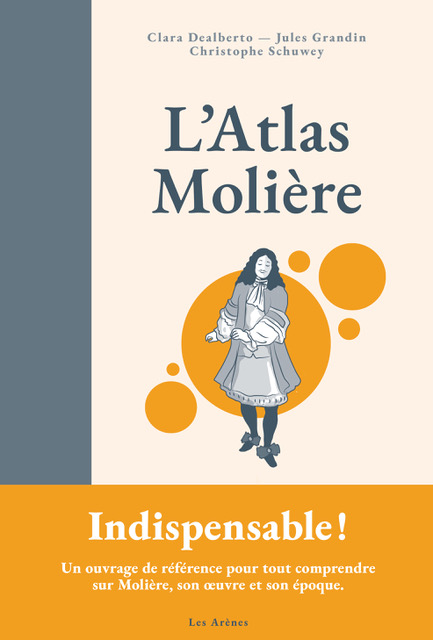 Clara Dealberto et Jules Grandin, Christophe Schuwey, L’Atlas Molière, Paris, Les arènes, 2022.
Clara Dealberto et Jules Grandin, Christophe Schuwey, L’Atlas Molière, Paris, Les arènes, 2022.