15, 16 et 17 novembre 2018
Organisé par l'UR CERES et l'Institut Catholique de Toulouse
Propositions: le 15 juin 2018
PRESENTATION
L’Equipe de Recherche Culture, Herméneutique et Transmission, équipe de recherche dépendant de l’UR CERES (Culture, Ethique, Religion et Société) de l’Institut Catholique de Toulouse organise les 15, 16 et 17 novembre 2018 un colloque international et interdisciplinaire, dans la lignée des deux précédents (« Chemin, cheminement », en 2012 ; « Histoire de l’Ecriture et Ecriture de l’H(h)istoire », en 2014), même si les communications sont pour la plupart centrées sur l’histoire, la littérature, religieuse et profane, et les arts.
La problématique reposera donc sur la notion de paysage et son évolution au cours des siècles, sur l’interprétation des paysages, le sens qu’on leur accorde, la transformation qu’ils subissent ou leur résistance à se révéler. Nous n’oublierons pas de traiter du paysage dans l’art, notamment en peinture, cinéma et musique, et de la façon dont il sert à révéler le processus de création de l’artiste.
Paysages anthropomorphisés qui évoluent au fil du temps et renvoient l’image d’un peuple posant ses marques dans des espaces autrefois vierges, ou demeurés en l’état qu’ils en deviennent fragiles et nécessitent une protection, sont autant de pistes de réflexion dont les supports peuvent relever de disciplines diverses.
« Un paysage est le fond du tableau de la vie humaine » Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814)
Quoi de plus naturel, quand on s’intéresse au paysage, que de convoquer l’un des grands écrivains de la 2e moitié du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, à la fois ingénieur, botaniste, grand explorateur et fin connaisseur des îles et territoires français du bout du monde ?
Si l’on s’en tient à l’étymologie latine, le « paysage » désigne un « canton rural », le pagus, et pagere veut dire « ficher une borne en terre », donc par extension délimiter un territoire et ensuite, le panorama que le regard peut embrasser. Bien entendu, cette signification tout empreinte du pragmatisme romain nous entraîne loin, et dans le temps et dans l’espace, des évocations élégiaques et poétiques du paysage que l’on peut lire dans Paul et Virginie, paru en 1788, plus grand succès de l’auteur cité plus haut.
D’ailleurs, l’apparition tardive du mot (1549) correspond à une perception différente de l’espace par l’homme plus citadin, plus sensible aux contrastes entre lieux bâtis et lieux laissés au naturel, tels que l’homme de la Renaissance les perçoit et tente de les comprendre. Des liens se nouent entre l’homme et le monde qui l’entoure, l’invitant à un hommage au Créateur tout d’abord, puis à la représentation plus fidèle (mimesis) dans laquelle l’apparition de la perspective est sans doute la manifestation la plus caractéristique, notamment chez les grands peintres des XVeet XVIe siècles italiens, Masaccio et Piero della Francesca en tête.
Le paysage y devient un thème ou un sous-thème qui fait sens dans le tableau, comme le sentier qui court à l’arrière de La Joconde avant de remplir lui-même l’intégralité de la toile, comme les peintres vénitiens s’évertueront à l’employer. En littérature, les adjectifs qui accompagnent la description appartiennent souvent au vocabulaire émotionnel : on parle d’un paysage apaisant, hostile, désolé[1] et les tableaux paysagers laissent transparaître un état d’âme, une perception révélatrice des intentions qui accompagnent la transmission d’un réel reproduit. Ce phénomène de miroir de l’âme que représente la contemplation ouvre la voie à la quête spirituelle invitant à l’introspection, à la recherche de l’insaisissable ou, à la rêverie, au vagabondage de l’imaginaire.
La littérature et la peinture abondent en représentations qui, le plus souvent, sont porteuses d’une symbolique qui résulte souvent d’une approche religieuse, puis d’un signifiant apte à créer un récit, une fiction voire une atmosphère qui lui accordent quasiment un rôle de personnage.
Le Romantisme est sans doute le moment le plus significatif de la fusion entre homme et espace, du va-et-vient entre l’esprit et l’environnement, l’un en accord avec l’autre, l’un influençant la vision de l’autre. Il faut se souvenir de Rousseau, initiateur des Rêveries ou des « orages désirés » de Chateaubriand mais aussi d’un Lamartine sur les rives du lac du Bourget ou d’un Enfant du siècle égaré dans la forêt…
Plus près de nous, la photographie capte l’immensité d’un paysage et le cinéma le redécouvre et souvent l’attache à définir un genre : que serait le western sans les étendues poussiéreuses des vastes plaines du Colorado et les rochers de Monument Valley ? Différemment, les paysages infinis et mélancoliques d’Antonioni parlent de la solitude et de l’aporie des relations humaines, tandis que la caméra de l’intime de Bergman caresse les visages des actrices pour les métamorphoser en paysage intérieur…
Mais si le paysage est l’ensemble des éléments d’un pays comme le laisse entendre son suffixe, il est aussi pour celui qui regarde la possibilité de saisir un espace et de le qualifier. Les variations en fonction des époques sont étonnantes : le paysage montagnard redouté durant de longues périodes, devient au XVIIIe siècle lieu d’élévation de l’âme ; le désert, espace hostile pour les autochtones, se fait fascinant pour les Occidentaux comme en témoignent les récits de voyage laissés par les « explorateurs ».
Plus secret, le jardin concentre un micro paysage, une réduction ordonnée de la nature, tantôt clairement structurée, comme à Vaux-le-Vicomte, tantôt esthétiquement désordonnée, à l’anglaise, puis chargée de symboles, au Généralife, à Kyoto ou évanescent et impressionniste, à Giverny, onirique et paradisiaque dans le Paradou d’Emile Zola.
Attaché en premier lieu à la nature, à un site particulièrement représentatif, le terme évolue et s’étend au milieu « urbain », désignant un environnement construit par l’homme dans lequel il tente de trouver sa place, dépassé par sa propre création au fil des siècles.
Si la littérature policière, la science-fiction, la bande dessinée accordent aujourd’hui au paysage une place éminente, il faut néanmoins remarquer qu’il est souvent plus torturé, plus poisseux, plus étrange, voire étranger à l’homme dont le rapport au paysage, sorte d’introduction à la Nature, se construit dorénavant en termes de protection, d’environnement, d’écologie.
La notion de paysage peut, en outre, être envisagée à travers un prisme pédagogique ou didactique. Au sens premier du terme, le paysage est un objet d’étude, une porte d’entrée vers la science géographique ; il est également un outil d’apprentissage au service notamment de la pédagogie par projet ou de l’école hors les murs (sorties, classes vertes).
Dans ses acceptions figurées, il peut faire référence à la classe en tant que groupe d’individus aux profils divers (fonctionnement cognitif, différenciation pédagogique), théâtres d’enjeux sociaux et sociétaux (question du genre, autorité, gestion de classe), pour lequel les choix de l’enseignant sont déterminants (innovation pédagogique).
On le voit, le paysage est lié aux avancées intellectuelles et physiques de l’humain, à son bagage sensible, aux découvertes comme aux événements, si l’on songe au soin apporté par les stratèges quant à la configuration des lieux pour préparer un combat, mais aussi aux études des sociologues et des géographes sur les effets du paysage sur les comportements sociétaux.
Mais il est aussi des paysages invisibles, intérieurs, si personnels que nul hormis celui qui les porte ne peut en saisir la dimension, les paysages du souvenir, ceux dessinés par le poète sans souci d’une ressemblance avec un réel perceptible mais chargé d’une symbolique qui recrée un monde.
Il en est d’autres, évanescents, suggérés par l’envol des notes dans l’espace restituant l’immensité marine ou les fracas d’une ville moderne ; d’autres encore, si chargés d’histoire que le passé a plongé ses racines dans la moindre parcelle témoignant d’un moment si important qu’ils ont été figés, conservés pour éviter l’oubli, comme le sont les insulas pompéiennes, ou ces sinistres alignements de bâtisses couvrant le camp d’Auschwitz, ou espaces redécouverts sous la pioche de l’archéologue faisant resurgir pierres et traces d’une civilisation disparue, enfouie sous la terre.
CONTRIBUTIONS
Les contributions prendront la forme de communications en français de 20 minutes maximum.
Les propositions constituées d’un résumé (avec titre) de 500 mots environ et d’une brève notice biographique doivent être adressées à : Philippe DAZET-BRUN (philippe.dazet-brun@ict-toulouse.fr), Christophe BALAGNA (christophe.balagna@ict-toulouse.fr), Gérard DASTUGUE (gérard.dastugue@ict-toulouse.fr) et Karine WILTORD (karine.wiltord@ict-toulouse.fr).
Date limite de soumission des propositions : 15 juin 2018.
Réponse du comité scientifique : au plus tard le 30 juin 2018.
Comité scientifique :
Václava Bakešová (MCF HDR, Université Masaryk, Brno, République tchèque)
Christophe BALAGNA (MCF, ICT)
Sophie CASSAGNE (MCF, Université Toulouse-Jean Jaurès)
Gérard DASTUGUE (MCF, ICT)
Philippe DAZET-BRUN (PR, ICT)
Bernadette ESCAFFRE (MCF, ICT)
Philippe GONIN (MCF, Université de Bourgogne)
Bernadette MIMOSO-RUIZ (PR, ICT)
Karine WILTORD (MCF, ICT)
Frais de participation : 30 euros.
Les frais de transport et d’hébergement sont à la charge des intervenants.
Les déjeuners des jeudi et vendredi ainsi que le dîner du jeudi sont pris en charge par l’ICT.
NOTES
[1] « Il n’y a rien de plus difficile à consoler qu’un paysage désolé » (Pierre Dac).
Source: Fabula




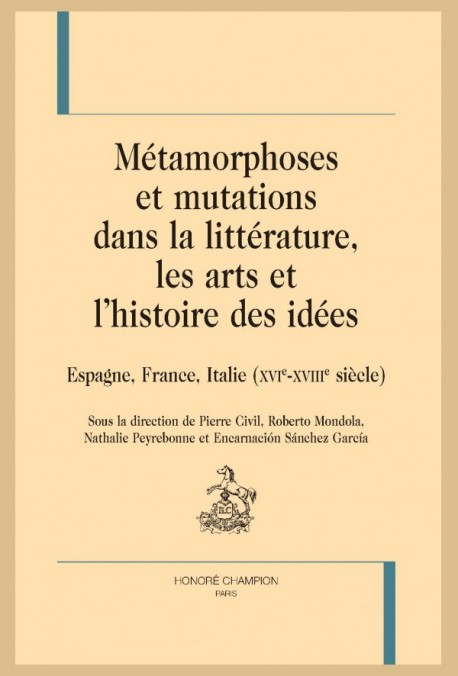 Métamorphoses et mutations dans la littérature, les arts et l'histoire des idées. Espagne, France, Italie (XVIe-XVIIIe siècle), dir. P. Civil, R. Mondola, N. Peyrebonne et E. Sánchez García, Paris, H. Champion, 2022.
Métamorphoses et mutations dans la littérature, les arts et l'histoire des idées. Espagne, France, Italie (XVIe-XVIIIe siècle), dir. P. Civil, R. Mondola, N. Peyrebonne et E. Sánchez García, Paris, H. Champion, 2022.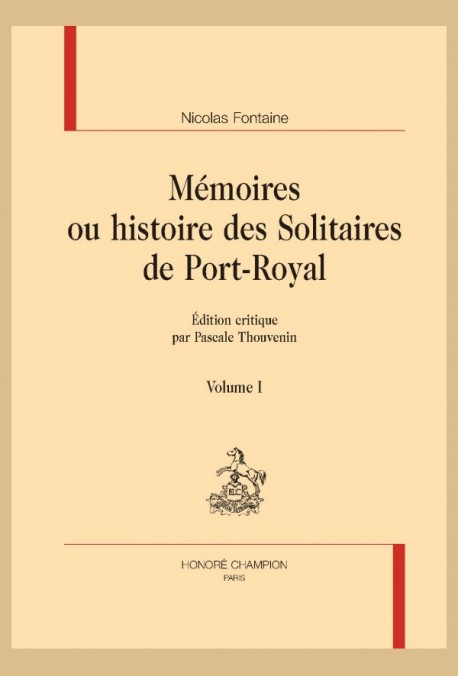 Nicolas Fontaine, Mémoires ou histoire des Solitaires de Port-Royal, éd. Pascale Thouvenin, Paris, H. Champion, 2022 (
Nicolas Fontaine, Mémoires ou histoire des Solitaires de Port-Royal, éd. Pascale Thouvenin, Paris, H. Champion, 2022 (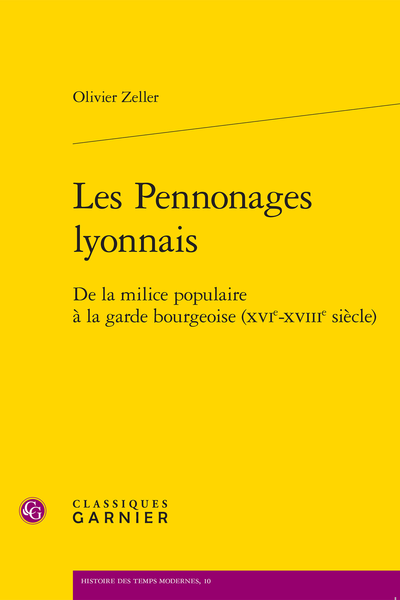 Olivier Zeller, Les Pennonages lyonnais. De la milice populaire à la garde bourgeoise (xvie-xviiie siècle), Paris, Classiques Garnier, 2022.
Olivier Zeller, Les Pennonages lyonnais. De la milice populaire à la garde bourgeoise (xvie-xviiie siècle), Paris, Classiques Garnier, 2022.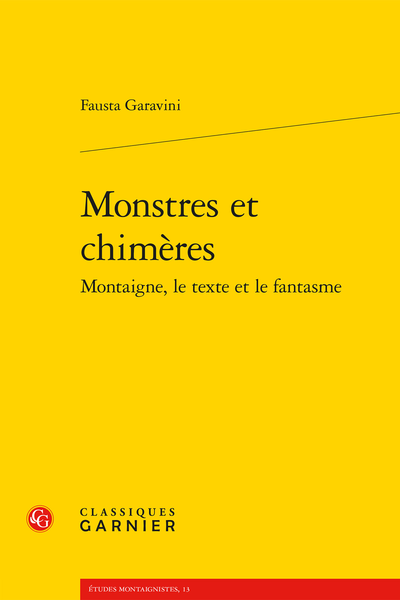 Fausta Garavini, Monstres et chimères. Montaigne, le texte et le fantasme, Paris, Classiques Garnier, 2021.
Fausta Garavini, Monstres et chimères. Montaigne, le texte et le fantasme, Paris, Classiques Garnier, 2021.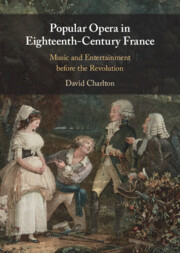 David Charlton, Popular Opera in Eighteenth-Century France. Music and Entertainment before the Revolution, Cambridge University Press, 2021.
David Charlton, Popular Opera in Eighteenth-Century France. Music and Entertainment before the Revolution, Cambridge University Press, 2021.