Colloque international organisé par l’Université de Rouen-Normandie et le CÉRÉdI avec le soutien de CLARE (Université Bordeaux Montaigne) de l’ICD (Interactions culturelles et discursives, Université François Rabelais Tours) et de l’IRET (Institut de Recherche en Études Théâtrales de la Sorbonne Nouvelle)
Campus Mont-Saint-Aignan Maison de l’Université Salle des conférences
COMITE D’ORGANISATION
Ariane FERRY, Sylvie HUMBERT-MOUGIN, Judith LE BLANC, Gwénaëlle LE GRAS et Sandra PROVINI COMITE SCIENTIFIQUE DU PROJET « LA FORCE DES FEMMES » Éric AVOCAT (Université d’Osaka, Japon), Anna BELLAVITIS (Université de Rouen-Normandie), Anne DEBROSSE (SIEFAR), Diane DESROSIERS (Université McGill, Canada), Myriam DUFOUR-MAITRE (Université de Rouen-Normandie), Marie FRANCO (Université de la Sorbonne Nouvelle), Véronique GELY (Université de la Sorbonne), Nathalie GRANDE (Université de Nantes, SIEFAR), Claudine POULOUIN (Université de Rouen-Normandie), Jean-Marie ROULIN (Université Jean Monnet, SaintÉtienne). COMITE SCIENTIFIQUE DU COLLOQUE Adrienne BOUTANG (Université d’Amiens), Noël BURCH (Université Lille 3), Gille DECLERCQ (Université de la Sorbonne Nouvelle), Florence FIX (Université de Rouen-Normandie), Loic GUYON (Mary Immaculate College, Université de Limerick, Irlande), Claire LECHEVALIER (Université de Caen), Sylvain LEDDA (Université de Rouen-Normandie), Raphaëlle LEGRAND, (Université Paris Sorbonne), Raphaëlle MOINE (Université de la Sorbonne Nouvelle), Sarah NANCY (Université de la Sorbonne Nouvelle), Geneviève SELLIER (Université Bordeaux Montaigne), Stella SPRIET (Université de Saskatchewan, Canada), Ginette VINCENDEAU (King’s College).
APPEL A COMMUNICATION
Ce colloque, programmé pour novembre 2018 par l’Université de Rouen-Normandie et le CÉRÉdI, avec le soutien du CLARE de l’Université Bordeaux Montaigne et de l’ICD de l’Université François Rabelais de Tours, sera le deuxième volet d’un projet intitulé La Force des femmes, hier et aujourd’hui, qui est piloté par le CÉRÉdI et marrainé par la SIEFAR (Société Internationale pour l’Étude des Femmes de l’Ancien Régime).
Ce projet consiste en une enquête collective sur les représentations littéraires, théâtrales et cinématographiques de la force féminine – envisagée à travers ses actualisations violentes et inquiétantes (le meurtre, le combat, la torture, l’action terroriste, etc.) et ses actualisations admirables (le courage, la résistance, la ténacité) – et les présupposés idéologiques qui les ont accompagnées à travers les siècles. Le texte cadre du projet est consultable sur le Carnet Hypothèses « Force des femmes » : http://forcedesf.hypotheses.org/41
Les deux premiers colloques s’interrogent sur la femme criminelle, appelée parfois déviante, dans les genres littéraires et les arts qui lui ont fait la part belle. Ils ont pour titres : Figures et personnages de criminelles, des histoires tragiques au roman policier (juin 2017) et Le Spectacle du crime féminin sur la scène et dans le cinéma européens (novembre 2018).
Après avoir exploré la représentation des criminelles dans le mode narratif et des genres divers, nous proposons une enquête diachronique portant sur la représentation de la violence criminelle féminine sur la scène (théâtre et opéra) et à l’écran essentiellement en Europe (XVIe-XXIe siècles).
Nous avons choisi de prendre en compte une définition large de la « criminelle » : femme meurtrière au premier chef, mais aussi infanticide et avorteuse, suicidée, adultère, femme criminalisée – cette criminalisation variant au cours de l’histoire et du contexte religieux, social et culturel. L’objectif de ce second colloque sera donc d’examiner comment les personnages de criminelles sont constitués en objets de spectacle ou font spectacle, à la scène comme à l’écran, mais aussi d’interroger les objectifs propres à ces représentations visuelles et spectaculaires du crime féminin sur un plan moral, politique, esthétique. S’agit-il de provoquer chez le récepteur un sentiment d’horreur et d’obtenir sa condamnation morale ? S’agit-il au contraire de mettre en valeur la façon dont telle ou telle société ou communauté va criminaliser la femme adultère, la jeune mère infanticide, pour affirmer ses propres valeurs, et faire entendre la voix de celle qui est ainsi désignée coupable, par exemple dans des scènes de procès ? La coupable désignée apparaît alors comme la victime d’un système social qui la pousserait à mettre fin à ses jours ou à ceux de son enfant pour ne pas subir le déshonneur et l’exclusion. La femme meurtrière présente des visages plus variés peut-être et qui vont de la femme de pouvoir (reine, magicienne) qui fait tuer ou tue à la femme qui assassine pour de l’argent en passant par les femmes qui se vengent ou se débarrassent d’un obstacle.
La particularité de ces arts – théâtre, opéra, cinéma – est de donner aux personnages de criminelles/femmes criminalisées un visage (parfois beau et séduisant, parfois effrayant, parfois ordinaire), une voix (dont le pouvoir de séduction peut être puissant) et un corps en mouvement qui sont créateurs de nouvelles représentations. Comment s’articule la relation entre une actrice / une chanteuse à la voix magnifique et les personnages de criminelles qu’elles construisent et offrent au public selon le double point de vue de la création et de la réception ? Le spectacle du crime féminin dans les arts de la scène et à l’écran semble fasciner autant qu’il révulse ; il contribue aussi à produire sinon des exemples à suivre, au moins des conduites et un rapport à l’existence où se trouvent tantôt valorisées la détermination et l’action féminines, tantôt interrogée sur le mode critique la victimisation des femmes. Entre admiration et empathie, horreur et fascination, ces criminelles incarnées suscitent chez le spectateur des émotions dont il conviendra d’examiner la nature et les manifestations, notamment dans le discours de réception critique, et les enjeux. L’histoire du théâtre est riche en représentations de femmes criminelles et/ou criminalisées. On songe bien sûr au développement extraordinaire de la figure de Médée sur la scène européenne, mais aussi à d’autres personnages mythiques ou bibliques comme Déjanire ou Athalie, à des personnages historicolégendaires comme Cléopâtre, Messaline, Lady Macbeth, Catherine de Médicis, Lucrèce Borgia qui ont connu de nombreux avatars dramatiques. Shakespeare, Corneille, Hugo ou Dumas1 ont construit des personnages de femmes de pouvoir n’hésitant pas à tuer ou à faire tuer. En ce qui concerne les femmes criminalisées, mises en procès et condamnées, on songe aux figures d’Antigone du côté de la Fable, de Jeanne d’Arc ou de Marie Stuart du côté de l’Histoire, mais aussi à la Gretchen de Goethe qui tue involontairement sa mère avec un somnifère, puis son enfant lorsqu’elle est abandonnée, enceinte, par Faust : leur succès sur les scènes européennes a été immense.
Les suicidées de la scène sont aussi légion, qu’elles aient une origine mythique, historique ou fictionnelle2 : Phèdre, Didon, Lucrèce, Cléopâtre encore, mais aussi Hedda Gabler chez Ibsen. Et puis il y a les meurtrières du quotidien, celles qui tuent dans le cadre de leurs activités domestiques ou professionnelles, celles qui viennent du fait divers notamment : on pense aux Bonnes de Genet, au Malentendu de Camus et plus récemment à l’adaptation par Simon Stone de la Médée d’Euripide qui s’inspire également d’un fait divers américain. Les modalités d’action de ces criminelles sont nombreuses : poison, arme blanche, voire « meurtre psychique » pour reprendre la formule de Strindberg. Si la mort de la femme est un topos du genre opératique d’Eurydice à Isolde en passant par Didon et Violetta, l’opéra, considéré comme un hyperthéâtre, est aussi le genre spectaculaire où le crime féminin peut s’épanouir avec le plus de force. Dès la tragédie en musique telle qu’elle est créée par Lully et Quinault, la vengeance est une passion essentiellement féminine qui anime les déesses (Junon, Cybèle) et les magiciennes (Médée, Arcabonne ou Armide) jusqu’à les pousser au passage à l’acte criminel. Ce que la tragédie déclamée cache à la vue du public pour des raisons de bienséance et de vraisemblance, la tragédie en musique va l’exhiber pour le plus grand plaisir des spectateurs3. La Médée de Charpentier, fidèle au modèle sénéquéen, représente sans doute le cas le plus spectaculaire de crime féminin sur la scène de l’Opéra à la fin du XVIIe siècle. Médée est en outre divinisée et s’échappe en gloire, hors de toute condamnation morale. Qu’en est-il de la Médée de Cherubini ou de Mayr ? Les héroïnes criminelles, figures historiques ou bibliques (Juditha triumphans, Vivaldi), sont aussi nombreuses sur la scène des Italiens.
À travers des exemples puisés dans des opéras aussi variés que Jenufa de Janacek, Turandot et Tosca de Puccini, Macbeth de Verdi ou Lulu de Berg, est-il possible d’envisager une typologie des femmes criminelles sur la scène lyrique ? Existe-t-il une tessiture de prédilection pour la femme criminelle ? Quel est le langage musical choisi pour mettre en scène le crime ? Il faudra aussi s’interroger sur ses moyens d’actions : la femme criminelle agit-elle seule ? avec quelle arme ? directement ou par voie détournée ? Existe-t-il des criminelles empêchées ? des criminelles malgré elles ? Quelle est la part de l’érotisme et de la séduction dans le crime féminin ? (cf. Judith ou le « Questo è il bacio di Tosca » chanté par l’héroïne lorsqu’elle tue Scarpia d’un coup de couteau). Dans une perspective diachronique, peut-on relever une évolution dans le traitement du crime féminin par les librettistes et les compositeurs d’opéras ? Comment mettre en scène ce qui frôle parfois l’irreprésentable ? Comment la femme passe-t-elle du statut de victime au statut de criminelle ? Enfin, du côté de la réception, comment le public (masculin ou féminin) accueille-t-il le spectacle du crime féminin ? Afin de dépasser l’approche strictement thématique, plusieurs perspectives – esthétique, dramaturgique, musicologique, historique et idéologique – pourront ainsi être envisagées et croisées. À l’écran, les criminels sont légion dans leur déclinaison masculine. Souvent, ils fascinent par leur génie machiavélique et leur pouvoir, qui, pour un temps, défie les lois. Qu’ils soient imaginaires ou inspirés de faits réels, ils ne cessent d’inspirer les fictions.
Ce colloque se propose d’interroger les femmes criminelles qui peuplent de façon croissante les réalisations cinématographiques et télévisuelles européennes et investissent, à l’égal des hommes, de nouvelles représentations criminelles telles que le viol (Baise-moi, Despentes, Trinh Hi, 2000), l’inceste (My Little Princess, Ionesco, 2011) ou les serial killeuses (La Mante, série, 2017). Parce qu’elles mettent en jeu des pratiques, des motifs, des attributs et des idéaux traditionnellement masculins, ces criminelles problématisent un tabou sociétal des femmes symboles de procréation et du care devenues donneuses de mort, qu’illustrait Renaud avec sa chanson vitriol en 19854.
Lorsque plus rarement les femmes s’invitent dans ce bastion de l’hégémonie masculine cinématographique et audiovisuelle5, elles font souvent débat (Nikita, Besson, 1990 ; Elle, Verhoeven, 2016). Sont-elles perçues comme fascinantes ? Intelligentes ? Boucs émissaires, comme dans le cinéma français d’après-guerre qui chargea certaines héroïnes de la responsabilité d’une masculinité nationale en crise (Quai des Orfèvres, Clouzot, 1947 ; Manèges, Allégret, 1950 ; Le Bon Dieu sans confession, Autant-Lara, 1953)6 ? Sont-elles entièrement autonomes dans la fiction, au cœur ou à la marge de celleci, ou prisonnières d’un regard masculin qui les influence (L’Appât, Tavernier, 1995) ou surplombe le récit (Mortelle Randonnée, Miller, 1983) ? Quittent-elles le terrain de la séduction ou au contraire le surinvestissent-elles en filles d’Ève, comme dans les films hollywoodiens (La Mariée était en noir, Truffaut, 1968 ; L’Été meurtrier, Becker, 1983) ? Car il est rare que les femmes criminelles soient envisagées sous un autre angle que l’articulation entre Éros et Thanatos dans l’imaginaire collectif. Leur criminalité est-elle plus souvent motivée par la vengeance ou par l’agression ? Sont-elles construites comme possédant une conscience, politique ou morale ? Bénéficient-elles d’un peu de compassion lorsqu’elles confortent la construction d’une infériorité genrée, qui plus est si elle s’articule à une condition de classe (comme dans Une affaires de femmes, Chabrol, 1988, basé sur l’histoire de l’avorteuse Marie-Louise Giraud, dernière femme guillotinée en France), ou sont-elles dépeintes comme des créatures folles, « contre-nature » (Répulsion, Polanski, 1965) ou des monstres de perversion (L’Ange noir, Brisseau, 1994), parfois amplifiée par un duo mère-fille (Voici le temps des assassins, Duvivier, 1956) ? Dans quelle sphère (publique ou privée) et dans quel registre criminel (empoisonnement, infanticide, victime justicière, escroquerie, attentat politique, crime violent) sontelles le plus souvent présentes ? Lorsqu’elles passent de victime à coupable, les circonstances atténuantes sont-elles prises en compte ou évacuées, gommées par une virilisation de l’héroïne (Les Diaboliques, Clouzot, 1955 ; Liste noire, Bonnot, 1984) ? Organisent-elles l’action et orientent-elles le point de vue de la fiction ? Qu’en est-il lorsqu’elles interviennent au sein d’un couple criminel (Les Amants diaboliques, Visconti, 1943 ; Les Amants criminels, Ozon, 1999) ? Est-ce que la criminalité offre plus facilement un point de vue à un personnage féminin ? De là, peut-être, un intérêt tout particulier des grandes actrices pour ces rôles, qui parfois ont fait des stars, de Musidora à Isabelle Huppert, en passant par Jeanne Moreau, Isabelle Adjani et bien d’autres tout en marquant des univers (Almodovar, Chabrol, Truffaut, Ozon). Est-ce que l’on suit le point de vue féminin ou le point de vue de l’ordre (masculin) ? Sont-elles jugées uniquement pour leurs crimes ou pour être passées à l’acte en tant que femmes ? L’identification ou bien l’empathie envers ces héroïnes sont-elles favorisées lorsqu’il s’agit de crimes relevant de la sphère publique, comme l’escroquerie (les rôles de Françoise Rosay, Edwige Feuillère, Thérèse Humbert, Bluwal, 1983 ; Rien ne va plus, Chabrol, 1997) ? Au contraire, sont-elles mises à distance lorsqu’il s’agit de crimes constituant une transgression majeure des rôles familiaux (la maltraitance de Vipère au poing, Cardinal, 1971 et de Broca, 2004 ; l’infanticide dans A perdre la raison, Defosse, 2011) ? En d’autres termes, sont-elles les égales des hommes en ce domaine dans les représentations qu’en offrent le cinéma et la télévision ? Les représentations proposées par les femmes scénaristes et réalisatrices apportent-elles un autre regard ? Existe-t-il des tendances fortes entre cinéma d’auteur, au fonctionnement plus marqué culturellement en Europe, et cinéma populaire, entre cinéma et télévision ?
Par leur fort impact auprès du public, les fictions criminelles, bâties sur une dialectique entre répétition et innovation, sont un puissant vecteur de la construction sociale des normes sexuées. C’est pourquoi la prise en compte du contexte socioculturel, articulé avec l’analyse du texte filmique, permet de décrypter les rapports et les identités de sexe construits par les genres, et les enjeux dont ils sont le lieu : l’analyse des avatars de la figure de la femme criminelle dans les fictions européennes éclaire en effet les conflits et les contradictions propres aux sociétés, en ce qui concerne les identités et les rapports de sexe. Cette figure, par sa dimension transgressive et active, va parfois servir à tester, dialectiser et problématiser l’image de la femme moderne par rapport au masculin. De manière différente selon les époques, ces rôles féminins expriment les tiraillements entre l’image de la femme émancipée, autonome et active, et celle de la femme traditionnelle, passive et soumise à l’autorité masculine. Il s’agira de voir comment, dans certains cas, en mettant des personnages féminins criminels aux postes de commande, qui non seulement organisent l’action mais orientent le point de vue, transgressent les rapports de pouvoir et les normes sociales, ces films peuvent échapper au manichéisme traditionnel, et à des discours misogynes. Mais suivant les époques et les films, on observera aussi l’autonomie plus ou moins grande des héroïnes ou leur retour in fine sous la coupe des hommes qui les entourent.
On privilégiera ici l’étude des représentations produites dans l’aire culturelle européenne, en partant du présupposé, qui sera lui aussi à interroger, que ces représentations de femmes criminelles sont tributaires, plus largement, d’une conception occidentale du crime et du féminin.
Plusieurs axes pourront être abordés à travers les communications proposées :
TYPOLOGIE ET MOBILES DES CRIMES FEMININS : QUELLES EVOLUTIONS A LA SCENE ET A L’ECRAN ? Perspective diachronique de cette typologie : évolution des genres / réinvestissement des figures. Mobiles et justifications du crime féminin. De la victime à la tueuse : la prostituée qui tue (Lulu, Wedekind, Pabst, Berg) ; la femme violée qui tue son enfant, son violeur ; la femme trompée qui tue son mari. Représentation du crime féminin et productions de « fables » sur la place des femmes dans les sociétés contemporaines. REECRITURES A LA SCENE ET A L’ECRAN, DE LA SCENE A L’ECRAN : § Le réinvestissement des grandes figures mythiques héritées de l’Antiquité gréco-romaine : Médée, Clytemnestre, les Danaïdes, Phèdre, Électre, Circé, Didon, Déjanire, etc. § La fortune scénique des figures bibliques : Athalie, Judith, Salomé, Dalila. § Les figures littéraires devenues mythiques : Lady Macbeth, Marguerite, Armide, Folcoche, la Marquise de Merteuil, Thérèse Desqueyroux. § Les personnages historiques : Cléopâtre, Catherine de Médicis, Lucrèce Borgia, Marie Stuart, Elizabeth Ière, Charlotte Corday, Mahaut d’Artois. § Les héroïnes de faits divers : empoisonneuses comme Hélène Jégado (Fleur de Tonnerre, 2017), Marie Besnard (L’Affaire Marie Besnard, téléfilm, 1986 ; Marie Besnard, l’empoisonneuse, téléfilm, 2006), La Voisin (La Devineresse, par Thomas Corneille et Donneau de Visée, 1679 ; L’Affaire des poisons, Decoin, 1955 ; La Marquise des ombres, téléfilm, 2009 ; la série Versailles, saison 2, 2017), les sœurs Papin (Les Bonnes, La Cérémonie, Les Blessures assassines), La Brinvilliers (La Marquise des ombres, 2010) ; meurtrières (Camus, Le Malentendu). § Réécritures et renversements axiologiques.
LE SPECTACLE DU CRIME FEMININ : PERSPECTIVES DIACHRONIQUES, GENERIQUES, AXIOLOGIQUES ET POETIQUES
§ Les comédiennes et les grands rôles de criminelles.
§ Du monstre au monstre sacré féminin.
§ Les modalités de la spectacularisation du crime féminin.
§ Criminalité féminine et hyperthéâtre : le spectacle de l’opéra et sa dramaturgie musicale.
§ Femmes et ultra-violence dans le cinéma contemporain.
Les propositions de communication (entre 500 et 1000 signes), accompagnées d’une courte biobibliographie (situation institutionnelle, laboratoire, champs de recherche et publications), devront être envoyées avant le 30 avril 2018 aux cinq organisatrices du colloque :
Ariane FERRY : ariane.ferry@univ-rouen.fr Sylvie HUMBERT-MOUGIN : sylvie.mougin@univ-tours.fr Judith LE BLANC : judith.le-blanc@univ-rouen.fr Gwénaëlle LE GRAS : gwenaelle.le-gras@u-bordeaux-montaigne.fr Sandra PROVINI : sandra.provini@univ-rouen.fr
1 Krakovitch Odile, « Les femmes de pouvoir dans le théâtre de Dumas : de Christine à Messaline », Revue d’histoire littéraire de la France, 2004/4 (Vol.104), p. 811-829, URL : https://www.cairn.info/revue-d-histoirelitteraire-de-la-france-2004-4-pa...
2 Voir : la thèse de Philippe Bousquet soutenue en 2004 à Paris Sorbonne et intitulée Les Lucrèce classiques : suicide et héroïsme féminin au Grand Siècle ; Claire Bouchet,
« Le Meurtre de soi : petite histoire du suicide féminin », Cycnos, Vol. 23, n° 2, 2006,
URL : http://revel.unice.fr/cycnos/index.html?id=704.
3 Voir notamment les ouvrages de Catherine Kintzler : Poétique de l’Opéra français de Corneille à Rousseau, Paris, Minerve, 1991, rééd. 2006 ; Théâtre et opéra à l’âge classique, une familière étrangeté, Paris, Fayard, 2004. Voir aussi : Sylvie Bouissou, Crimes, cataclysmes et maléfices dans l’opéra baroque en France, Paris, Minerve, 2011.
4 « Dans cette putain d’humanité / Les assassins sont tous des frères / Pas une femme pour rivaliser / À part peutêtre, Madame Thatcher », Renaud, Miss Maggie,1985.
5 Voir les travaux de Raphaëlle Moine : Les Femmes d’action au cinéma, Paris, Armand Colin, 2010 ; Les Genres du cinéma, Paris, Armand Colin, 2002 (rééd. 2008 et 2015) et l’ouvrage collectif Policiers et criminels : un genre européen sur grand et petit écran, Brigitte Rollet, Raphaëlle Moine et Geneviève Sellier (dir.), Paris, L’Harmattan, Champs Visuels, 2009.
6 Voir les travaux de Noël Burch, Geneviève Sellier : La Drôle de guerre des sexes du cinéma français, 19301956, Paris, Armand Colin, 1996 (rééd. 2005) ; et Thomas Pillard : Le Film noir français face aux bouleversements de la France d’après-guerre (1946-1960), éditions Joseph K, 2014.




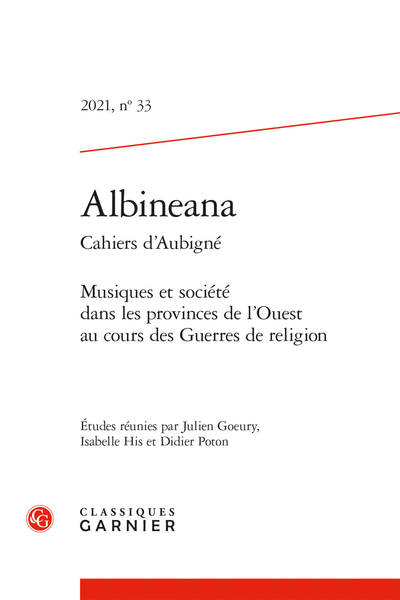 Albineana, 2021, n° 33 : "Musiques et société dans les provinces de l’Ouest au cours des Guerres de religion".
Albineana, 2021, n° 33 : "Musiques et société dans les provinces de l’Ouest au cours des Guerres de religion".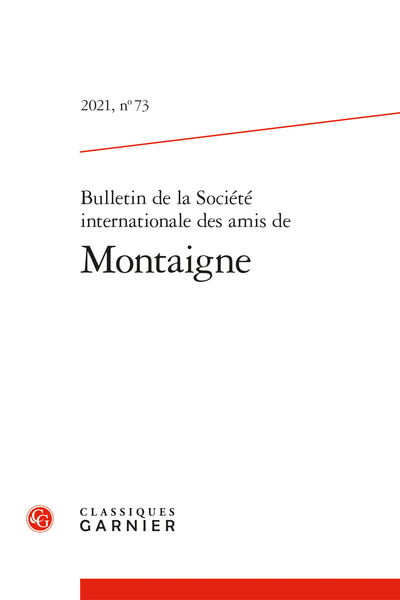 Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne, 2021, n° 73 : "varia".
Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne, 2021, n° 73 : "varia".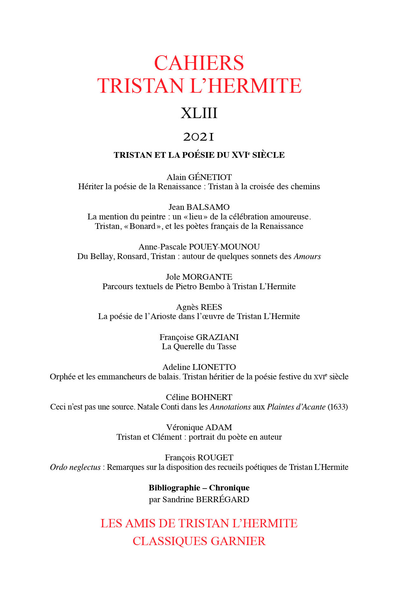 Cahiers Tristan L’Hermite, 2021, n° XLIII : "Tristan et la poésie du XVIe siècle".
Cahiers Tristan L’Hermite, 2021, n° XLIII : "Tristan et la poésie du XVIe siècle". Christopher J. Lane, Callings and Consequences: The Making of Catholic Vocational Culture in Early Modern France (Montreal and Kingston: McGill-Queen’s University Press, 2021). ISBN paperback: 978-0-2280-0855-2, $34.95; ISBN hardcover 978-0-2280-0854-5; ISBN PDF 978-0-2280-0975-7; ISBN ePub 978-0-2280-0976-4. See below for 20% discount.
Christopher J. Lane, Callings and Consequences: The Making of Catholic Vocational Culture in Early Modern France (Montreal and Kingston: McGill-Queen’s University Press, 2021). ISBN paperback: 978-0-2280-0855-2, $34.95; ISBN hardcover 978-0-2280-0854-5; ISBN PDF 978-0-2280-0975-7; ISBN ePub 978-0-2280-0976-4. See below for 20% discount. Peut-on être libertin sans en avoir les moyens? De la noblesse décadente du Grand Siècle à la bourgeoisie parvenue des révolutions en passant par le demi-monde arriviste des Lumières, l'argent joue partout un rôle crucial, même lorsqu'il se métamorphose en une via crucis.
Peut-on être libertin sans en avoir les moyens? De la noblesse décadente du Grand Siècle à la bourgeoisie parvenue des révolutions en passant par le demi-monde arriviste des Lumières, l'argent joue partout un rôle crucial, même lorsqu'il se métamorphose en une via crucis.