65th Annual Meeting for the Society for French Historical Studies (SFHS)
April 4-6, 2019
Indiana University-Purdue University, Indianapolis (IUPUI)
Indianapolis, Indiana, USA
(En français ci-dessous)
There is a long tradition among historians of France and the Francophone world of doing history "differently" so that we can engage a wider public through our craft. Among other things, we have published editorials in newspapers, worked with filmmakers to tell stories from the past, granted interviews on television, published trade books, staged plays, written novels, maintained blogs and hosted festivals. This conference will explore and celebrate the many ways that we innovate, play, or otherwise experiment with history to engage a broader public.
Our keynote speaker will be Patrick Boucheron (Professor, Collège de France). There will also be a plenary session with Professor Boucheron, Catherine Blondeau (Director, Grand T Theater, Nantes) and Krystel Gualdé (Chief Curator, Museum of Nantes) to discuss their creation of the biannual festival "Nous Autres" in Nantes, France.
The program committee welcomes proposals in English or French for complete panels or individual papers on all aspects of French and Francophone studies, medieval to contemporary. We particularly seek panels, roundtables, and workshops that explore this year’s theme of “History and Its Publics: Doing Things Differently." What are the ways that historians carve a role for themselves as public intellectuals? How have they engaged the public with history? What types of collaborations facilitate these public engagements?
The conference will be held on the IUPUI campus in Indianapolis. The campus borders along downtown Indianapolis and the White River State Park. The White River State Park houses the Indianapolis Zoo, NCAA Headquarters, Indiana State Museum, and the Eiteljorg Museum of American Indians and Western Art. All of these sites are convenient to the campus and conference hotel (Sheraton Indianapolis City Center).
Please do not submit proposals for talks that have already been presented or published, or that have been submitted for presentation in another forum. Proposals (in English or French) must be submitted in digital format by September 15, 2018 to: sfhsconference2019@gmail.com. Daniella Kostroun will serve as president of the society in 2019 and will organize the conference. Questions can be directed to her at the above email address or at dkostrou@iupui.edu.
In addition to paying the conference fees, all participants must be members of the Society for French Historical Studies in good standing at the time of the conference. Membership dues should be paid directly to Duke University Press: https://www.dukeupress.edu/Societies/french-historical-studies.
«L'Histoire et ses publics: faire les choses autrement»
65e congrès annuel de la Society for French Historical Studies (SFHS)
4-6 avril, 2019
Indiana University-Purdue University, Indianapolis (IUPUI)
Indianapolis, Indiana, USA
Parmi les historiens de la France et du monde francophone existe une longue tradition de «faire de l'histoire autrement» dans un souci de toucher des publics plus larges. Diverses activités témoignent de cette volonté: rédiger des éditoriaux, travailler avec des cinéastes pour raconter des histoires du passé, accorder des interviews à la télévision, publier des ouvrages, présenter des pièces de théâtre, écrire des romans, entretenir des blogs, ou organiser des festivals.L'objectif de ce congrès est d'examiner et de mettre en valeur les nombreuses façons dont nous innovons, expérimentons ou jouons avec l'histoire afin d'y associer un public non académique.
Patrick Boucheron, professeur au Collège de France sera notre conférencier d'honneur. Une session plénière accueillera Catherine Blondeau (directeur du théâtre «Le Grand T» à Nantes), Krystel Gualdé (chargée du développement scientifique, au Musée d'histoire de Nantes) et Patrick Boucheron en vue de communiquer sur la création du festival biannuel «Nous Autres» à Nantes.
Le comité accepte les propositions en anglais ou en français pour les séances thématiques ou les communications individuelles sur tous les aspects de l'histoire Française et francophones, du Moyen Âge à la période contemporaine.
Nous privilégions les séances, tables rondes et ateliers qui explorent le thème de cette année: Par quels moyens les historiens peuvent-ils assumer le rôle d'intellectuels publics? Comment entrent-ils en contact avec le public autour de l'histoire? Quels modèles de collaborations facilitent les engagements des historiens avec le public?
Le congrès se tiendra sur le campus d'IUPUI. Le campus se trouve à la lisière du centre-ville d'Indianapolis, et jouxte le White River State Park. Le White River State Park abrite le Zoo d'Indianapolis, le siège de la NCAA (l'Association Nationale du Sport Universitaire), le Musée de l'État d'Indiana, et le Musée Eiteljorg des amérindiens et de l'art de l'Ouest américain. Tous ces sites sont à proximité du campus et de l'hôtel de colloque (Sheraton Indianapolis City Centre).Nous vous remercions de ne pas soumettre de proposition de communications déjà présentées ou publiées, ou encore soumises en vue d’une présentation dans un autre forum. Les propositions (en français ou en anglais) qui n'excèderont pas une page et seront accompagnées par un bref résumé biographique; elles seront soumises au format numérique avant le 15 septembre 2018 à: sfhsconference2019@gmail.com. L’organisateur du congrès et président de la Société est Daniella Kostroun. Les questions peuvent lui être envoyées directement a l'adresse électronique mentionnée ci-dessus ou à dkostrou@iupui.edu.
Nous attirons votre attention sur le fait que tous les participants devront être membres en règle de la SFHS au moment du congrès. Les congressistes doivent payer les frais d'inscription au congrès et les frais d'adhésion au SFHS. Les frais d'adhésion sont à verser directement à la maison d'édition «Duke University Press» qui établit la liste officielle de membres de l'association SFHS: https://www.dukeupress.edu/Societies/french-historical-studies.




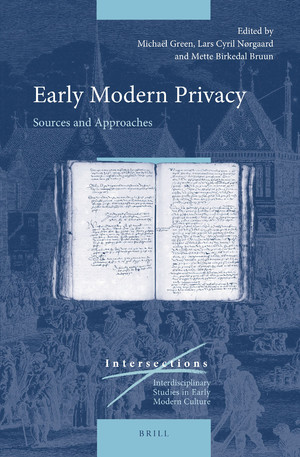 Early Modern Privacy. Sources and Approaches, dir. Michaël Green, Lars Cyril Nørgaard, and Mette Birkedal Bruun, Leiden/Boston, Brill, 2021.
Early Modern Privacy. Sources and Approaches, dir. Michaël Green, Lars Cyril Nørgaard, and Mette Birkedal Bruun, Leiden/Boston, Brill, 2021. François Hotman, Antitribonian, ed & transl. Howell A. Lloyd, Leiden/Boston, Brill, 2021.
François Hotman, Antitribonian, ed & transl. Howell A. Lloyd, Leiden/Boston, Brill, 2021.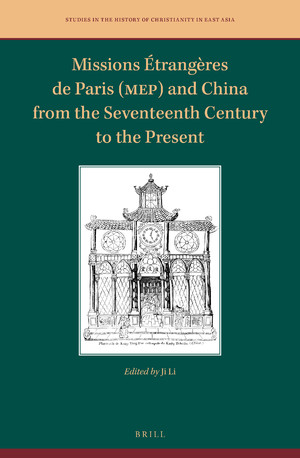 Missions Étrangères de Paris (MEP) and China from the Seventeenth Century to the Present, dir. Ji Li, Leiden/Boston, Brill, 2021.
Missions Étrangères de Paris (MEP) and China from the Seventeenth Century to the Present, dir. Ji Li, Leiden/Boston, Brill, 2021.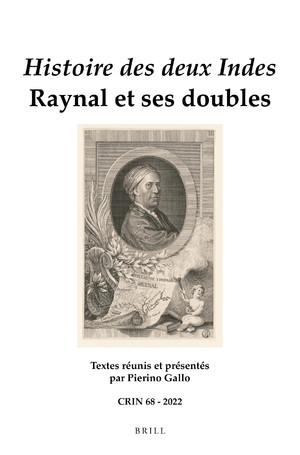 Histoire des deux Indes. Raynal et ses doubles, dir. Pierino Gallo, Leiden/Boston, Brill, 2021.
Histoire des deux Indes. Raynal et ses doubles, dir. Pierino Gallo, Leiden/Boston, Brill, 2021.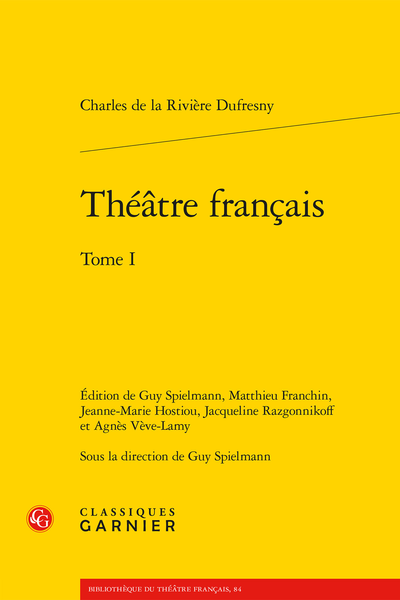 Dufresny, Théâtre français, Tome I, éd. dir. Guy Spielman, avec Jeanne-Marie Hostiou, Jacqueline Razgonnikoff, Agnès Vève-Lamy et Matthieu Franchin, Paris, Classiques Ganier, 2022.
Dufresny, Théâtre français, Tome I, éd. dir. Guy Spielman, avec Jeanne-Marie Hostiou, Jacqueline Razgonnikoff, Agnès Vève-Lamy et Matthieu Franchin, Paris, Classiques Ganier, 2022.