Colloque international
Organisé par
Laurette Burgholzer (Université de Berne) et Vincenzo Mazza (Université Paul Valéry – Montpellier 3)
Collège d’Espagne (CIUP) & Département des Arts du spectacle (BnF), Paris
10, 11 et 12 avril 2019
Le théâtre est nostalgie du présent.
Olivier Py (2013)
Apparentée au désir violent du marin expatrié de retourner dans sa patrie au temps de la Grèce antique, la nostalgie est aujourd’hui notion-Protée. Elle n’est pas seulement privation ou regret quasi-pathologique qui naît de l’impossibilité d’atteindre un lieu, temps ou état familier. Elle est également un sentiment d’impuissance de ceux qui aspirent à un idéal, qui recherchent avec force et passion une valeur ou une qualité.
Mal du pays, fantasme d’un âge d’or, goût du vintage, « maladie suisse » ou encore passéisme ... Loin d’être un contenu donné, la nostalgie constitue une pratique culturelle dont les formes et significations en évolution sont liées à un espace-temps triple : celui des acteur.trice.s des pratiques nostalgiques, celui de l’objet désiré, et celui des chercheur.se.s qui se penchent sur ces phénomènes.
Si la « passion des retours » (Nicola Savarese) semble suggérer un état précis, l’objet de la nostalgie peut apparaître sous maintes formes diverses : histoire personnelle ou collective, propre ou appropriée, idéalisée ou imaginée, ou encore authenticité, état originel et intact. Il s’agit bien d’une pratique à deux faces, caractérisée par l’« enracinement » et l’« errance » (Barbara Cassin). Quel que soit son objet de convoitise, la nostalgie présuppose un présent vécu comme expérience de manque, de migration ou d’exil. Étranger dans son cadre et lieu de vie, « [l]e nostalgique est en même temps ici et là-bas, ni ici ni là-bas, présent et absent, deux fois présent et deux fois absent » (Vladimir Jankélévitch).
La nostalgie représente une posture face au présent insatisfaisant et face à ce qui est absent. En même temps, elle suscite le jugement. Notamment face à un optimisme progressiste, la nostalgie peut être considérée bourgeoise, voire même réactionnaire. Pour appréhender les pratiques théâtrales et discursives de la nostalgie, il est nécessaire de distinguer ses deux figures : d’une part, la « disposition nostalgique », partant d’une implication sentimentale de perte et de manque, et d’autre part, le « dispositif discursif nostalgique » qui se manifeste sous forme de narrations stratégiques dont les objectifs peuvent inclure l’instrumentalisation politique, économique etc. (Olivia Angé).
Les arts peuvent être à la fois les produits transposés de ces deux figures de la nostalgie et de potentiels producteurs de sensations nostalgiques. Qui peut donner « tant de chair et de relief à ces fantômes du regret » (Albert Camus) ?
Le théâtre, cet art des sens, ce lieu de partage d’odeurs, de matières, de goûts, de lumières et d’ombres, de sons et de silences ne se borne pas à représenter. Il a parfois la capacité de rendre présent ce qui est éloigné et inaccessible, tout comme la célèbre madeleine de Proust. Dans les visions d’Antonin Artaud, le désir de ce qui est hors de portée dépasse les limites de la mémoire : « nous ressentons le besoin physique, violent, et comme la nostalgie organique d’un art et d’une parole magique, et comme le théâtre est le seul art à pouvoir constituer une synthèse unique de tous les moyens d’expression et de tous les langages, nous attendons du théâtre qu’il nous redonne le sens d’une nouvelle magie vitale, qui nous réconcilierait avec lui et peut-être avec la vie. »
Auparavant, des praticien.ne.s et connaisseur.se.s de théâtre du 19e siècle avaient cherché – en s’orientant vers Shakespeare, la Commedia dell’arte, la pantomime des Funambules, les marionnettes, le cirque – à trouver la formule des formes spectaculaires qui capteraient les sources vitales de l’inspiration et le génie de la communauté. C’est bien « l’une des grandes nostalgies primitivistes du romantisme » (Jean Sarobinski). En revanche, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle et pendant plus d’un siècle, ce que l’on nomme communément Commedia dell’arte a été l’objet de nombreuses projections nostalgiques, libres de la contrainte que la « Commedia dell’arte en tant que fait historique n’existe pas. Depuis toujours c’est une abstraction, un peu de nostalgie, un peu d’utopie » (Roberto Cuppone).
Les âges d’or concernent la communauté entre acteurs et public, l’acteur-créateur et la dramaturgie. Pour ne citer qu’un exemple : les formes et sujets du Siglo de oro espagnol sont revisités par Victor Hugo, dans Hernani ou Ruy Blas. Quels sont les connaissances, les rapports et les intentions face à cette période spécifique de l’histoire du théâtre, qui eut également un écho considérable dans les recherches d’un art dramatique renouvelé à l’aube du 20e siècle ? Les objets de la pratique nostalgique sont de qualité hybride, entre le fait et le fantasme. Si les pratiques théâtrales disposent de différentes manières de remémorer, de présenter, d’analyser, de citer le passé et l’état absent, la disposition et le dispositif nostalgiques en représentent une manière spécifique.
La recherche sur la nostalgie est en plein essor. Pour ne citer que les quatre dernières années, plusieurs événements scientifiques ont porté sur la nostalgie dans le domaine des arts et sciences sociales. À Metz en juillet 2015 a eu lieu le colloque Nostalgie : entre le mal-être et le désir, organisé par l’Association européenne François Mauriac, présidée par Nina Nazarova ; en automne 2016, Histoire, Mémoire et Nostalgie : Représentations littéraires et culturelles, symposium organisé par leDépartement de philologie anglaise et l’Association lituanienne pour l’étude de l’anglais de l’université de Vilnius ; l’année suivante à Nancy, Estelle Zunino et Patrizia Gasperini ont organisé le colloque La nostalgie dans tous ses états ; en mai 2018, l’Université du Québec à Chicoutimi a mis en place le colloque Nostalgies, mémoires et cultures médiatiques : entre esthétique, marchandisation et politisation. Malgré la richesse et la variété des argumentaires et des requêtes des organisateurs, les quatre colloques mentionnés n’ont accordé au théâtre qu’une place marginale.
Le colloque international qui se tiendra du 10 au 12 avril 2019 à Paris visera à établir un nouveau champ de recherche en études théâtrales en définissant comme objet d’étude les manifestations et discours de la nostalgie au théâtre. Les chercheur.se.s sont invité.e.s à identifier et questionner des cas de pratiques nostalgiques dans l’histoire du théâtre et les arts du spectacle contemporains, à étudier dans quelle mesure la pratique théâtrale peut générer une contre-histoire ou des récits historiques alternatifs. Il est également prometteur d’analyser l’impact de l’exotisme et de l’historicisme sur ces phénomènes, et d’examiner des propositions théâtrales de souvenirs de demain, pour une époque post-humaniste. « [L]e paradis est verrouillé et le Chérubin est derrière nous ; il nous faut faire le voyage autour du monde et voir si le paradis n’est pas ouvert, peut-être, par derrière » (Heinrich von Kleist). Si le théâtre se caractérise par la présence ici et maintenant, quels sont ses rapports avec la nostalgie, cette « petite sœur de l’apocalypse » qui efface le présent ?
Tout en favorisant des travaux de recherche fondamentale basée sur des documents écrits, iconographiques etc. concernant le théâtre, le cirque, les arts de la marionnette, la danse, l’opéra, la performance, les propositions peuvent se focaliser sur un ou plusieurs des aspects suivants :
- Mise en scène (décors, scénographie, lumière, costume, masque, musique, son, gestuelle, mimique, danse, voix etc.)
- Pédagogie (théorie et pratique de la formation d’acteurs dans les différents domaines)
- Structures et modalités de travail (compagnie, troupe ambulante, laboratoire, communauté etc.)
- Dramaturgie (sujets, personnages, style, texte-matériau, structure dramatique etc.)
- Discours pro- et anti-nostalgie au théâtre
Axes de recherche
- Un théâtre mythographe : production de récits historiques alternatifs ; la nostalgie au théâtre comme vecteur d’une idéalisation déformatrice du passé (David Lowenthal).
- Un théâtre des identités collectives : (re)présentations de la « communauté de perte » (exil, diaspora, états anéantis, « Ostalgie » etc.) et le rôle crucial de la nostalgie pour « construire, entretenir et reconstruire nos identités » (Fred Davis) ainsi que leur mise en question. La nostalgie peut être « provoquée non par la passion empirique mais par l’irruption d’une parole et d’une promesse » (Jacques Derrida).
- Un théâtre d’objets mnémoniques : objets fétiches, reliques laïques qui ont été en contact avec le passé. À l’instar de la madeleine de Proust déjà évoquée, les objets peuvent intervenir comme des médiateurs dans les rapports que des individus – sur le plateau et dans le public – établissent avec leur passé.
- Un théâtre de l’âge d’or des acteurs : « rethéâtralisation » et recherches d’une maîtrise corporelle et d’un lâcher-prise, allant d’imitations de formes et citations jusqu’aux utopies de société et de création (communauté artistique, « nature », théâtre populaire etc.), de la quête de personnages archaïques ou archaïsés aux constitutions d’un cadre rituel et/ou spirituel pour la pratique théâtrale.
- Anti-nostalgie et critique du théâtre nostalgique : accusations de la posture passive (mémoire-refuge) qui serait en opposition avec un théâtre didactique, de dénonciation, de lutte (Olivier Neveux), ou qui serait lié à un opportunisme économique. « Je n’arrive pas à comprendre le retrait suivant derrière le quatrième mur, dans le théâtre des acariens […]. Si le théâtre pousse vers le 19e siècle (ou s’il y est poussé par une nostalgie rentable), alors la malédiction de ma naissance tardive me presse vers la cantine » (Heiner Müller).
- Institutionnalisation de la nostalgie : théâtres et compagnies professionnels et amateurs dédiés à des formes spectaculaires du passé ; un théâtre qui sert d’asyle pour préserver des formes théâtrales en voie de disparition.
- Industrialisation de la nostalgie : Création et diffusion de spectacles sur la base d’un marché régional, national et mondial de la nostalgie collective.
Comité scientifique
Christian Biet (Université Paris Nanterre) ; Laurette Burgholzer (Université de Berne) ; Beate Hochholdinger-Reiterer (Université de Berne) ; Stefan Hulfeld (Université de Vienne) ; Joël Huthwohl (BnF) ; Vincenzo Mazza (Université Paul Valéry – Montpellier 3) ; Pierre-Louis Rey (Université Sorbonne Nouvelle).
Responsables du colloque
Laurette Burgholzer (Université de Berne) ; Vincenzo Mazza (Université Paul Valéry – Montpellier 3)
Modalités de soumission
Les propositions de communication devront être adressées à nostalgie.theatre@gmail.com.
Format de la proposition : Argumentaire d’environ 250 mots en explicitant l’approche théorique et méthodologique, titre de la contribution, bibliographie et 5 mots-clés. Les propositions seront accompagnées d’une brève biobibliographie et des coordonnées électroniques de l’auteur-e. Les propositions peuvent être rédigées en français ou en anglais.
Date limite d’envoi : 15 septembre 2018
Les réponses d’acceptation du comité d’organisation seront envoyées le 30 septembre 2018.
Langues du colloque : français et anglais.
La durée des communications ne devra pas dépasser les 30 minutes.
Frais d’inscription : Enseignant.e.s, chercheur.se.s, artistes : 50 euros ; étudiant.e.s, doctorant.e.s : 30 euros. Les versements seront à effectuer sur place.
Les frais de déplacement et d’hébergement ne seront pas pris en charge.
Publication : La publication des actes est prévue.
Le colloque La nostalgie au théâtre est soutenu par :
Bibliothèque nationale de France
Collège d’Espagne
E.S.T – Études sur le théâtre




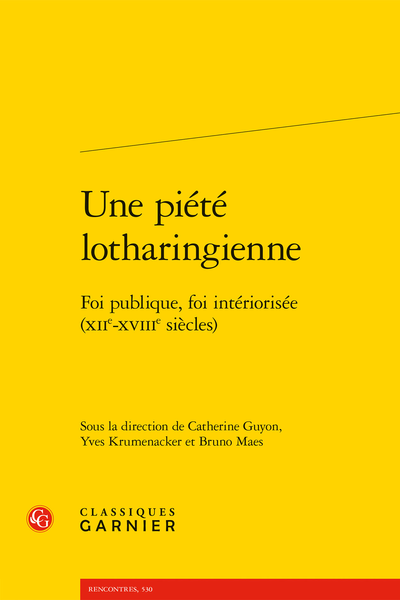 Une piété lotharingienne Foi publique, foi intériorisée (xiie-xviiie siècles), dir. Catherine Guyon, Yves Krumenacker et Bruno Maes, Paris, Classiques Garnoer, 2022.
Une piété lotharingienne Foi publique, foi intériorisée (xiie-xviiie siècles), dir. Catherine Guyon, Yves Krumenacker et Bruno Maes, Paris, Classiques Garnoer, 2022.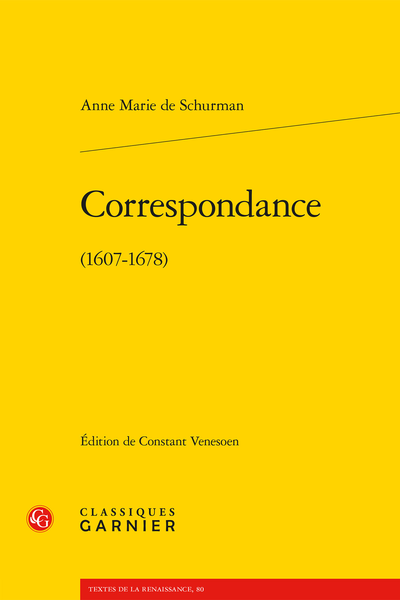 Anne-Marie de Schurman, Correspondance (1607-1678), éd. Constant Venesoen, Paris, Classiques Garnier, (2004), 2022.
Anne-Marie de Schurman, Correspondance (1607-1678), éd. Constant Venesoen, Paris, Classiques Garnier, (2004), 2022.