Jeudi 27 et vendredi 28 juin 2019
Propositions : le 15 septembre 2018
Université Paris-Est Créteil / Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3
PRESENTATION
Les arts d’Ancien Régime étaient souvent des arts de circonstance, au discours contraint, sans que ce constat doive entraîner un quelconque jugement de valeur esthétique, en ce que ces arts prennent leur sens plein dans un contexte social dont le jeu politique n’est jamais complètement absent. À la cour en particulier, toute activité avait nécessairement un volet politique, jusqu’aux plus intimes – comme la nuit de noces célébrée devant témoins lors de certains mariages royaux. Il ne pouvait en aller autrement pour les pratiques artistiques auxquelles s’adonnaient autant les courtisans que les souverains, notamment la poésie, la musique et la danse : on pense aux ballets dansés par Louis XIV en France et aux masques donnés à grands frais à la cour d’Angleterre, mais aussi à l’importance accordée à ces trois pratiques dans Il Cortegiano de Castiglione, pour qui elles sont indispensables au gentilhomme. Le poète, le musicien, le danseur courtisans sont donc bien éloignés de l’image que le Romantisme nous a laissée de l’artiste bohème, maudit ou méconnu, rebelle aux conventions de la société bourgeoise et, contrairement à elle, sincère.
Ce critère de sincérité, établi par un Jean-Jacques Rousseau qui opposait la langue du cœur à l’hypocrisie de la société, est devenu, et pour longtemps, le principe fondateur de l’expression artistique – reléguant par là-même toute œuvre composée pour répondre à des circonstances extérieures au rang de la médiocrité. C’est lui qui nous fait associer étroitement l’art à la sphère privée voire intime, et c’est souvent à son prisme que nous considérons les œuvres du passé, et en particulier celles de la Renaissance, au risque du contre-sens.
Pourtant, de nombreux indices invitent à reconsidérer la littérature de la première modernité dans le cadre social et idéologique qui était le sien et à aborder les choix esthétiques non plus seulement comme l’expression de préférences personnelles mais également comme celle d’un projet lié au groupe auquel le poète se rattache, et donc à les analyser dans un contexte qui prend en compte, par exemple, les rapports de force entre différentes factions courtisanes.
En dehors de la cour, d’autres pratiques artistiques sont tout aussi étroitement liées à l’action politique : on pense bien entendu aux campagnes de libelles et autres mazarinades, mais aussi à l’emblématique ou à la poésie spirituelle, en particulier lorsqu’un procès en canonisation est l’occasion d’affirmer la puissance d’un État, d’un lignage ou d’une ville – ainsi, des joutes poétiques en l’honneur de Thérèse d’Avila.
Nous nous proposons donc d’examiner le lien entre le politique et les arts en prêtant une attention redoublée au contexte d’énonciation ou de performance des œuvres, afin de faire apparaître la dimension politique des choix esthétiques même en l’absence de contenus explicitement politiques.
Plus précisément, nous nous intéresserons à la façon dont les formes elles-mêmes, qu’elles soient linguistiques, génériques, métriques, matérielles, visuelles ou sonores, expriment le politique, dans toute sa complexité – puisque même les formes destinées à la flatterie peuvent instiller le conseil, la critique, ou la négociation subtile de rapports de pouvoir. Ce colloque pourrait être enfin l’occasion d’interroger la notion même de forme dans les différents champs disciplinaires et selon les usages ou les contextes où elles sont observées.
AXES DE RECHERCHE
On pourra étudier, entre autres :
-
les divertissements officiels, tels les ballets de cour, les “entrées” de personnages publics, les masques et cérémonies civiques
-
les genres littéraires, qu’ils soient évidemment liés au politique, comme le pamphlet, ou en semblent faussement détachés, comme la pastorale – et les milieux dans lesquels ces formes sont partagées ou débattues
-
les formes métriques, qui font parfois référence à des cultures concurrentes (renvoi à un idéal classique ou à la culture vernaculaire d’un pays voisin) et impliquent un jeu d’influence, de rivalité ou d’émulation dans la construction des identités nationales ou de l’identité d’un groupe par rapport à un autre
-
les paratextes, qui tâchent de négocier la réception d’une œuvre à travers une série de dédicaces à des personnages importants, épîtres au lecteur, et poèmes à la louange de l’auteur rédigés par ses collègues et amis – et parfois articulent avec difficulté ces pièces d’occasion qui peuvent s’avérer politiquement contradictoires
-
les supports matériels choisis pour la diffusion de tel ou tel texte, comme le format de publication, la mise en page ou la fonte, l’histoire du livre et la material culture étant deux disciplines qui s’attachent depuis longtemps aux “sens des formes” dans ce que celles-ci ont de plus concret
Ce colloque réunira des spécialistes de l’Europe et de ses possessions extra-européennes du 15e au 18e siècle, dans une perspective comparatiste et résolument interdisciplinaire.
Conférence plénière
Nigel SMITH (Princeton University)
Comité scientifique
Mercedes BLANCO (Sorbonne Université), Fernando BOUZA (Universidad Complutense Madrid), Paloma BRAVO (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3), Camilla CAVICCHI (Centre d'Études Supérieures de la Renaissance), Charlotte COFFIN (Université Paris-Est Créteil), Line COTTEGNIES (Sorbonne Université), Séverine DELAHAYE-GRÉLOIS (Université Paris-Est Créteil), Jean-Louis FOURNEL (Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis / Institut Universitaire de France), Sagrario LÓPEZ POZA (Universidad de La Coruña), Karen NEWMAN (Brown University), Bruno PETEY-GIRARD (Université Paris-Est Créteil), Matteo RESIDORI (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3), Elisabeth ROTHMUND (Université Paris-Est Créteil), Jessica WOLFE (University of North Carolina at Chapel Hill).
Comité d’organisation
Paloma BRAVO (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, CRES-LECEMO), Charlotte COFFIN (Université Paris-Est Créteil, TIES-IMAGER), Séverine DELAHAYE-GRÉLOIS (Université Paris-Est Créteil, CREER-IMAGER).
Ce colloque est une collaboration des équipes IMAGER (Institut des Mondes Anglophone, Germanique et Roman) et CRES-LECEMO (Centre de Recherche sur l’Espagne des XVIe et XVIIe Siècles - Les Cultures de l’Europe Méditerranéenne Occidentale).
CONTRIBUTIONS
Les propositions (titre, résumé de 300 mots et notice biographique de 150 mots) sont à envoyer avant le 15 septembre 2018 à : lesensdesformes@gmail.com
Source: Fabula




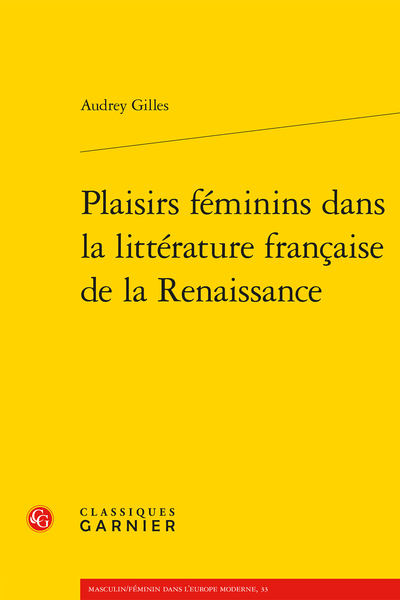 Audrey Gilles, Plaisirs féminins dans la littérature française de la Renaissance, Paris, Classiques Garnier, 2022.
Audrey Gilles, Plaisirs féminins dans la littérature française de la Renaissance, Paris, Classiques Garnier, 2022. Jennifer Eun-Jung Row, Queer Velocities Time, Sex, and Biopower on the Early Modern Stage, Northwest University Press, 2022.
Jennifer Eun-Jung Row, Queer Velocities Time, Sex, and Biopower on the Early Modern Stage, Northwest University Press, 2022. Esaïe COLLADON, Journal (1600-1609), éd. Patrice DELPIN, Genève, Droz, 2021.
Esaïe COLLADON, Journal (1600-1609), éd. Patrice DELPIN, Genève, Droz, 2021.