Journée d’études
Vendredi et Samedi 22 – 23 mars 2019
Centre de Recherches Egyptologiques de la Sorbonne (CRES) -
Faculté des Lettres de Sorbonne Université –
Escalier G, 3e étage, salle J 324, 1 rue Victor Cousin, 75005 PARIS
Les relations entre humains et animaux ont, tout au long de l’Histoire, été marquées par la volonté récurrente des premiers d’organiser la diversité et la pluralité des seconds dans des catégories plus ou moins vastes aux contours plus ou moins bien définis. Ces classifications ont bien souvent vocation à ordonner l’apparent chaos de la faune environnante, voire à permettre à l’humain d’affirmer un statut à part face aux non-humains. De manière générale, de nombreuses sociétés anciennes s’illustrent par l’anthropocentrisme qui se dégage de leur ordonnancement du vivant, défini d’après les divergences qu’il présente par rapport aux êtres humains, à l’exemple de la fameuse définition de l’homme comme seul possesseur du logos chez Aristote.
Ces catégorisations peuvent s’appuyer sur une variété de critères. Plusieurs sociétés proposent par exemple une première différenciation fondée sur l’habitat et l’habitus des animaux : chez les anciens Egyptiens comme dans la Genèse, on trouve une tripartition entre « ceux qui sont dans le ciel », « ceux qui sont dans l’eau », « ceux qui rampent sur la terre », etc. Le Moyen Âge, légataire des textes grecs et latins sans en être le passeur servile, a lui aussi interrogé les grandes formes du vivant, et offre diverses approches de la relation homme-animal selon le type de discours considéré : traités zoologiques, encyclopédies ou encore travaux lexicographiques. Les classifications mises en oeuvre par ces sociétés, et bien d’autres, diffèrent souvent de l’approche strictement hiérarchique et de la taxonomie systématisée par les savants de l’époque moderne, notamment C. von Linné et J.-B. de Lamarck, considérés comme les fondateurs des systèmes de classification du vivant dont descendent en grande partie nos propres considérations contemporaines.
L’objectif de cette journée de conférences et d’échanges, suivie d’une demi-journée de table ronde générale, modérée par de grands spécialistes du champ : Orly Goldwasser (Université Hébraïque de Jérusalem), Baudouin Van den Abeele (Université catholique de Louvain-la-Neuve) et Arnaud Zucker (Université Nice Sophia Antipolis), sera de tenter de comprendre la variété de ces hiérarchies et d’interroger quelques méthodes et pistes de recherche permettant de contourner les difficultés liées à la disparité des sources, aux problèmes de conservation, aux barrières linguistiques et cognitives et à l’impossibilité de reposer sur des informateurs systématiques. Toutes sont en effet spécifiques à l’anthropologie historique et compliquent l’appréhension de ces classifications pour les sociétés du passé, alors même que le champ a été ouvert dès les années 1960 en anthropologie (« ethnobiologie ») et en linguistique, mais aussi en psychologie cognitive.
Il s’agira d’un atelier avant tout méthodologique, visant à rassembler historiens, linguistes, épistémologues, archéologues, zoologistes…, qu’ils soient jeunes chercheurs ou scientifiques expérimentés, autour de trois questions majeures :
- comment et d’après quelles sources appréhender les catégorisations zoologiques dans les sociétés du passé ?
- quelles relations entre observations empiriques et pratiques scientifiques ?
- in fine, que nous apprennent les différents systèmes de catégorisation du vivant sur les sociétés qui les ont produites ?
Le but sera donc de mettre en lumière les pratiques classificatrices des sociétés anciennes en s’attachant moins aux résultats (l’établissement d’une taxonomie pour une société donnée) qu’aux sources et aux méthodes sollicitées, afin de s’ouvrir au mieux à l’échange avec les spécialistes d’autres périodes et disciplines. La perspective de cette journée et demie de workshop est en effet résolument pluridisciplinaire. Si la linguistique tient d’ordinaire une place importante dans les travaux traitant de classification, en ethnobiologie comme en anthropologie historique, les sources permettant au chercheur de postuler l’existence de catégories zoologiques ne se limitent pas à l’étude lexicographique. A ce titre, les sociétés sans écriture ne seront pas écartées de la réflexion, et l’on s’attachera au contraire à identifier les contextes où des espèces animales peuvent être intimement associées ou radicalement contrastées dans des discours imagés ou dans des pratiques. Les restes archéologiques et les programmes iconographiques, autant que les textes littéraires, nous permettent d’entrevoir des systèmes de classement mis en oeuvre, et pas seulement élaborés dans les discours réflexifs des encyclopédistes ou des savants. L’étude de ces « usages catégoriels » permettra peut-être même de distinguer entre des taxonomies savantes et des folk taxonomies répondant à une façon quotidienne et populaire de penser la diversité animale.
Les résumés en FRANÇAIS ou en ANGLAIS ne devront pas dépasser 300 MOTS auxquels seront ajoutées quelques références bibliographiques, pour une communication de 20 MINUTES suivie de 10 minutes de questions et échanges. Ils sont à envoyer avant le 30 novembre 2018 à l’adresse je.categorisation@gmail.com. Les réponses (positives ou négatives) seront envoyées par le comité d’organisation au plus tard le 15 décembre.
Les organisateurs : Meyssa BENSAAD, Yoan BOUDES, Axelle BREMONT et Simon THUAULT
Quelques travaux de référence
AARAB Ahmed & EL-MOUHAJIR Youssef (2014), « La dénomination zoologique arabe à travers le Kitâb el-Hayawân de Gâhiz », Arabic Biology and Medicine no. 5.
AARAB Ahmed & LHERMINIER Pascale (2015), Le ‘Livre des animaux’ d’al-Jâhiz, L’Harmattan, Paris.
BERLIN Brent (1992), Ethnobiological Classification. Principles of categorization of plants and animals in traditional societies, Princeton University Press, Oxford.
BUQUET Thierry (2013), « Nommer les animaux exotiques de Baybars, d’Orient en Occident », in Christian Müller et Muriel Roiland-Rouabah (eds.), Les non-dits du nom. Onomastique et documents en terre d’Islam. Mélanges offerts à Jacqueline Sublet, Presses de l’Ifpo, Beyrouth.
DITTMAR Pierre-Olivier (2012), « Le seigneur des animaux entre pecus et bestia. Les animalités paradisiaques des années 1300 », in Agostino Paravicini Bagliani (dir.), Adam, le premier homme, Florence, Sismel/Edizioni del Galluzzo, p. 219-254.
GOLWASSER Orly (2002), Prophets, Lovers and Giraffes: Wor(l)d Classification in Ancient Egypt, Harrassowitz, Wiesbaden.
GRANGE Juliette (2015), “De la nomenclature à la classification”, in Philippe Selosse & Denis Reynaud (eds.), Nomenclatures au XVIIIe s. : la science, « langue bien faite ». Tricentenaire Linné-Buffon, Presses de l’Aristoloche, Lyon, p. 175-188.
HÜNEMORDER Christian (1983), « Aims and intentions of botanical and zoological classification in the Middle Ages and Renaissance », History and Philosophy of the Life Sciences, vol. 5, no. 1, p. 53-67.
MEEKS Dimitri (2012), « La hiérarchie des êtres vivants selon la conception égyptienne », in Annie Gasse, Frédéric Servajean & Christophe Thiers (eds.), Et in AEgypto et ad AEgyptum. Recueil d’études dédiées à Jean-Claude Grenier, Université Paul-Valéry, Montpellier.
MILLER Jeanne (2013), More than the sum of its parts: Animal Categories and accretive logic in Volume One of al-Jahiz’s Kitâb al-Hayawân, these de doctorat, New York University, New York.
POMMERENING Tanja & BISANG Walter (eds.) (2017), Classification from Antiquity to Modern Times. Sources, methods, and theories from an interdisciplinary perspective, De Gruyter, Berlin & Boston.
PROVENCAL Philippe (2017), “La systématique zoologique dans le monde arabe”, Arabic Biology and Medicine 5, p. 21-28.
ROSCH Eleanor (1978), “Principles of categorization”, in Eleanor Rosch & Barbara B. Loyd (eds.), Cognition & Categorization, Lawrence Erlbaum Ass., New Jersey.
TILLIER Simon (2005), “Terminologie et nomenclature : l’exemple de la taxonomie zoologique”, Langages, vol. 157, p. 103-116.
VOISENET Jacques (2000), Bêtes et hommes dans le monde médiéval. Le bestiaire des clercs du Ve au XIIe siècle, Brepols, Turnhout.
ZUCKER Arnaud (2005), Les classes zoologiques en Grèce ancienne d’Homère à Elien (VIIIe siècle avant – IIIe siècle après JC), Publications de l’Université de Provence, Aix-en-Provence.




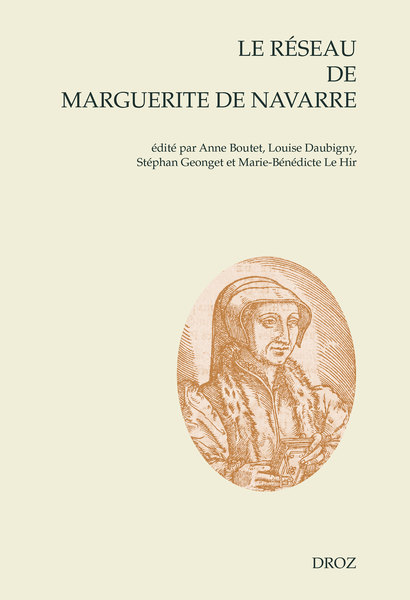 Le réseau de Marguerite de Navarre, Édité par Stéphan GEONGET, Anne BOUTET, Louise DAUBIGNY, Marie-Bénédicte LE HIR, Genève, Droz, 2022.
Le réseau de Marguerite de Navarre, Édité par Stéphan GEONGET, Anne BOUTET, Louise DAUBIGNY, Marie-Bénédicte LE HIR, Genève, Droz, 2022.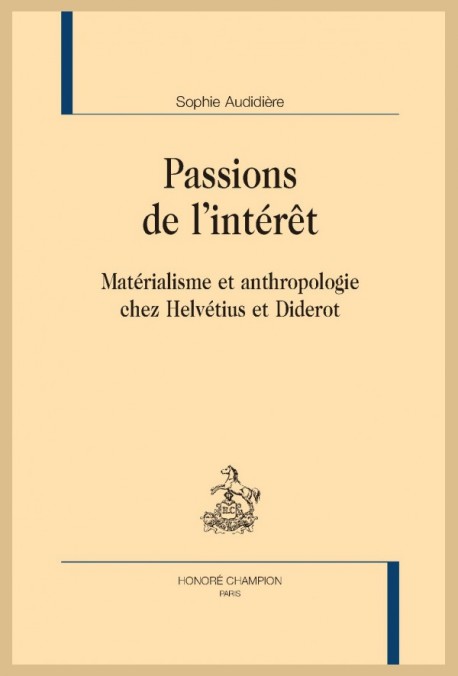 PASSIONS DE L'INTÉRÊT
PASSIONS DE L'INTÉRÊT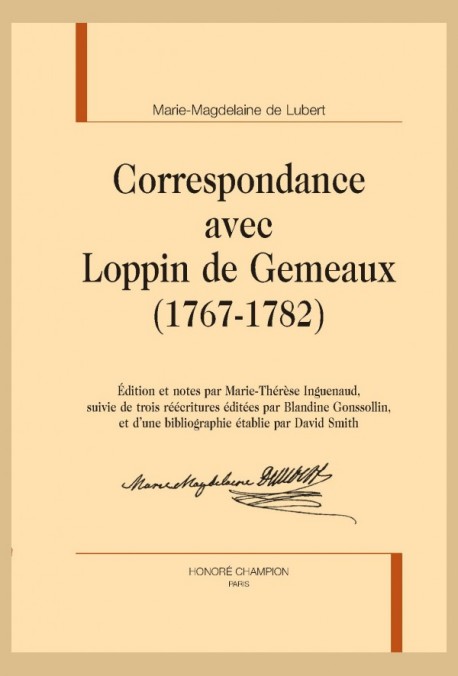 CORRESPONDANCE AVEC LOPPIN DE GEMEAUX (1767-1782)
CORRESPONDANCE AVEC LOPPIN DE GEMEAUX (1767-1782)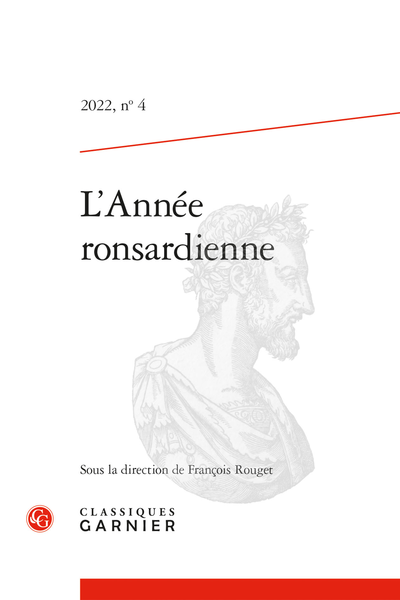 L'Année ronsardienne, 2022, n° 4 varia
L'Année ronsardienne, 2022, n° 4 varia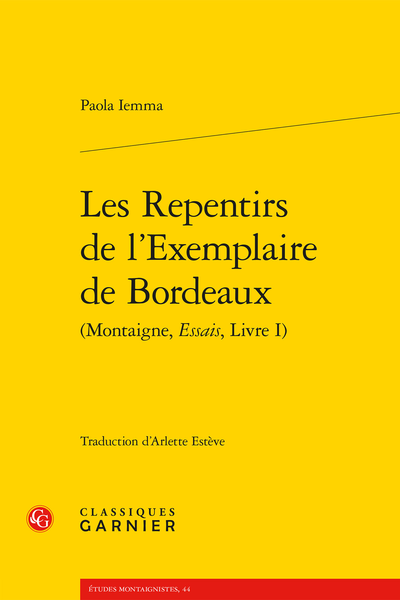 Paola Iemma, Les Repentirs de l’Exemplaire de Bordeaux (Montaigne, Essais, Livre I), trad. Arlette Estève , Paris, Classiques Garnier, (2004) 2022.
Paola Iemma, Les Repentirs de l’Exemplaire de Bordeaux (Montaigne, Essais, Livre I), trad. Arlette Estève , Paris, Classiques Garnier, (2004) 2022.