Les contes merveilleux, la Bible hébraïco-chrétienne et les mythes gréco-romains partagent l’intervention du surnaturel dans le récit. Le conte se donne d’emblée comme « bagatelle », mais la Bible comme vérité révélée, tandis que les mythes suscitent une question rétrospective, celle de savoir si les Grecs y ont crus (Paul Veyne). Ces trois corpus peuvent se définir comme des genres littéraires spécifiques, présentant une certaine homogénéité morphologique, si ce n’est thématique. C’est donc en tant que genres littéraires que nous nous proposons de les interroger, en examinant spécialement les rapports qu’ils peuvent entretenir entre eux.
La question poétique les rapproche ou les éloigne. Eric Auerbach (Mimésis) distingue deux « types fondamentaux » : le style laconique de la Bible et le style fleuri de la mythologie. Pour les contes, nous en trouvons de ces deux sortes, d’une concision lapidaire (Perrault, Grimm, etc.) ou davantage descriptifs et digressifs (d’Aulnoy, Andersen, Les Mille et Une Nuits, etc.). Nous pourrions ainsi nous interroger sur l’usage, dans ces genres, des procédés littéraires comme l’ellipse, la répétition, l’onomastique, la description, la métaphore, l’hyperbole, la caractérisation apparemment limitée des personnages.
Quelle est la fonction du surnaturel dans ces trois genres ? Dans les contes merveilleux, il a un rôle limité et quasi expérimental chez Perrault, alors qu’il manifeste une immanence chez les Grimm, par exemple. Dans les mythes antiques, il recourt à une pléthore d’agents, des dieux et demi-dieux, confrontant leur pouvoir. Dans la Bible, il est en principe monopolisé par un seul agent, Yhvh, quoique certains passages (les magiciens de Pharaon, Balaam, le Satan de Job, etc.) mettent en question cette omnipotence. Aussi, on pourrait explorer de manière comparative les conventions du surnaturel propres aux trois genres. Qu’en est-il par exemple de la visibilité des agents surnaturels ?
On sait que la question de la théophanie est cruciale dans la Bible et que la divinité, en principe invisible et innommée, semble s’efforcer d’intervenir de moins en moins ; mais dans la mythologie, les dieux ne prennent-ils pas aussi plaisir à passer incognito parmi les hommes ? Et dans le conte, les fées et autres ogres sont-ils si aisément repérables par les autres personnages ? La distinction classique (Tzvetan Todorov) entre le fantastique et le merveilleux, selon l’attitude plus ou moins perplexe des personnages envers le surgissement du surnaturel, est-elle opératoire sur les genres antiques ?
En outre, d’un point de vue narratif, ces trois genres sont liés entre eux. Les deux genres antiques, assez contemporains, ont possiblement subi des influences communes de littératures antérieures (sumérienne ou égyptienne), voire des influences réciproques (que l’on pense à Samson et Hercule par exemple). Mais le conte moderne est indubitablement inspiré par ces récits antiques. L’exemple de Psyché est bien connu, mais des nombreux intertextes bibliques sont aussi repérables dans les contes de Perrault : scène-type de la stérilité du couple dans « La Belle au bois dormant » ou de la générosité de la jeune fille au puits dans « Les Fées », épisodes de la vie de David dans « Le petit Poucet ». Non seulement ces trois genres font l’objet d’une intertextualité commune, mais ils partagent aussi le potentiel d’une infinie littérature seconde (pour reprendre la notion de Marc Escola et Sophie Rabau), faite de réécritures et de commentaires : Psyché se trouve d’abord chez Lucien avant Apulée ; la Bible hébraïque est disponible en versions massorétique, grecque (Septante) ou latine (Vulgate), manifestant chacune des variantes, et de nombreux épisodes sont réécrits plus tard par le Coran ; les contes fournissent un modèle emblématique de réécritures différentielles théorisé avec la notion de conte-type.
Cependant, ces trois genres ne sont pas que le lieu d’un cordial dialogue, mais aussi celui de rivalités que l’on pourrait aussi explorer. Ainsi, conjointement à la vogue du conte à la fin du XVIIe siècle, une querelle du merveilleux agite le milieu littéraire, opposant la valeur du merveilleux chrétien à celle de la mythologie païenne. Et si Perrault dénigre la mythologie antique, qu’il considère immorale et boursouflée, en faveur des contes des aïeux, au XVIIIe siècle c’est la Bible hébraïque qui est violemment prise à parti par Voltaire au profit du conte philosophique. Au XIXesiècle les folkloristes considèrent les contes comme un produit dégénéré du mythe. Et, comme bouclant la boucle, depuis la fin du XXe siècle, la Bible est devenue un légitime objet d’études narratologiques, de sorte que l’on peut la considérer comme une série de contes. Ainsi la Bible et les contes, aux corpus plus stabilisés (voire canonisés) que la mythologie, rencontrent-ils aujourd’hui des problématiques herméneutiques parallèles : des approches respectivement historico-critiques et folkloristes tentent de dégager les strates des textes à la poursuite du récit originel, tandis que des approches narratologiques ou littéraires interrogent ces textes à la fois dans leur singularité et dans leur intertextualité.
Mais Perrault ajoute que les contes ne sont pas « pures bagatelles ». Le potentiel de lecture des trois genres du littéral à l’allégorique, voire au mystique, résulte sans doute de leurs caractères poétiques et merveilleux / fantastique déjà évoqués. De fait, le débat interprétatif reste ouvert sur la leçon ou l’enseignement que peuvent contenir les textes bibliques ou mythologiques, sur la morale pédagogique des contes littéraires ou la valeur initiatique des contes de tradition orale. Nous pensons que mettre en perspective ces trois genres peut apporter un éclairage renouvelé sur tous ces enjeux.
PROPOSITIONS
Les propositions (résumé d’une page et biobibliographie) sont à envoyer conjointement à Jean-Paul Sermain (jean-paul.sermain@wanadoo.fr) et à Pierre-Emmanuel Moog (pemoog75@gmail.com) avant le 1er décembre 2018. Les articles devront être remis au plus tard le 1er novembre 2019.
Source: Fabula




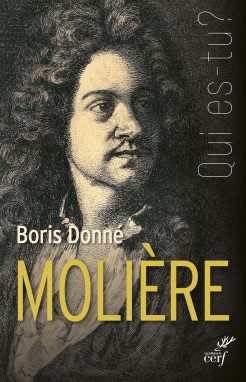 Boris Donné, Molière, Paris, Éditions du Cerf, coll. "Qui es-tu ?", 2022
Boris Donné, Molière, Paris, Éditions du Cerf, coll. "Qui es-tu ?", 2022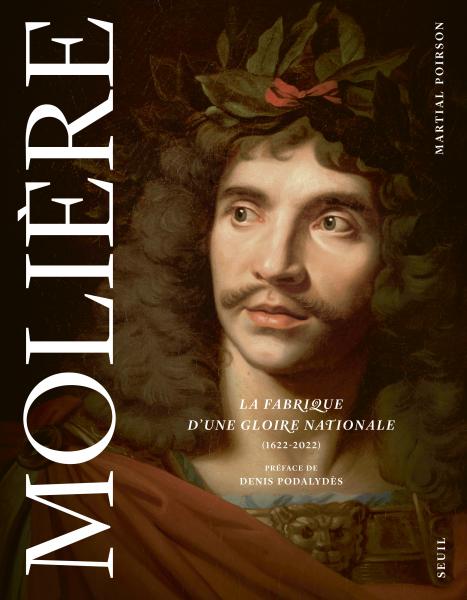 Martial Poirson, Molière. La fabrique d'une gloire nationale (1622-2022), Paris, Seuil, 2022.
Martial Poirson, Molière. La fabrique d'une gloire nationale (1622-2022), Paris, Seuil, 2022.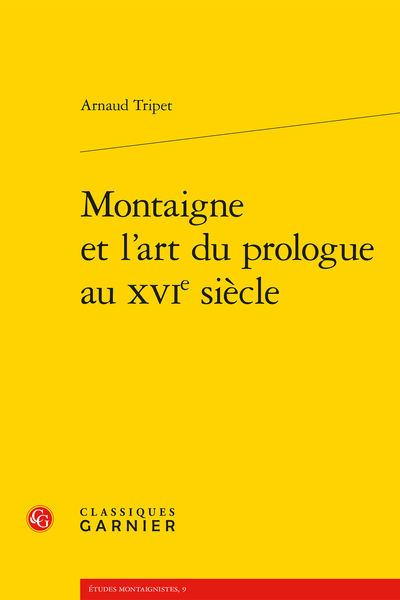 Arnaud Tripet, Montaigne et l’art du prologue au XVIe siècle, Paris, Classiques Garnier, coll. "Études montaignistes", 2022.
Arnaud Tripet, Montaigne et l’art du prologue au XVIe siècle, Paris, Classiques Garnier, coll. "Études montaignistes", 2022.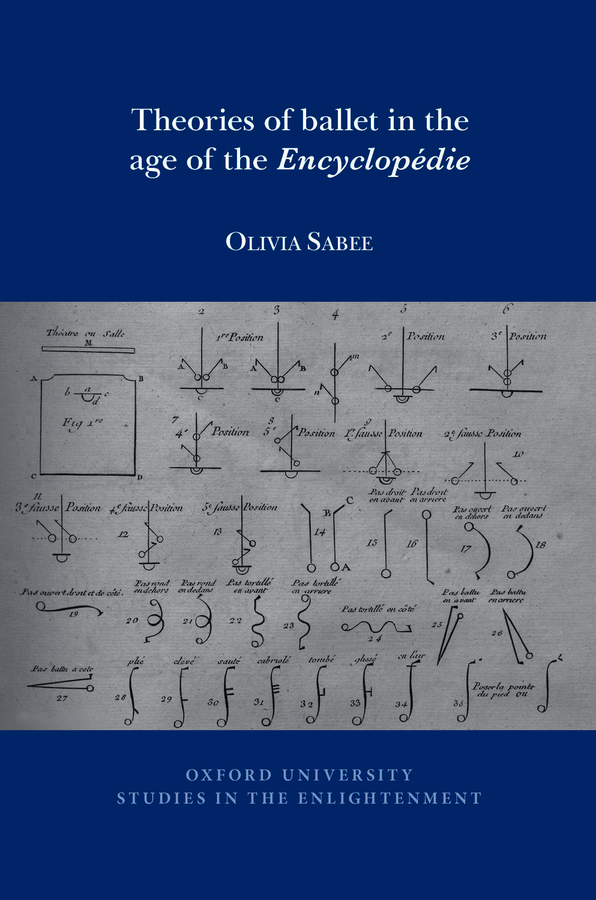 Olivia Sabee, Theories of Ballet in the Age of the Encyclopédie, Liverpool, Liverpool University Press, coll. "Oxford University Studies in the Enlightenment", 2022
Olivia Sabee, Theories of Ballet in the Age of the Encyclopédie, Liverpool, Liverpool University Press, coll. "Oxford University Studies in the Enlightenment", 2022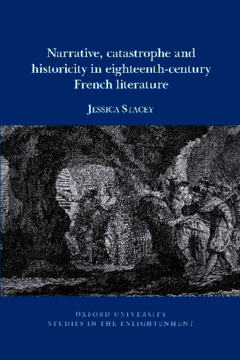 Jessica Stacey, Narrative, catastrophe and historicity in eighteenth-century French literature,
Jessica Stacey, Narrative, catastrophe and historicity in eighteenth-century French literature,