14-15 novembre 2019
Université de Haute-Alsace, Mulhouse
Colloque international organisé par Rudolf Mahrer et Anne Réach-Ngô,
avec le soutien de l’Université de Lausanne, de l’Université de Haute-Alsace
et de l’Institut Universitaire de France
Il arrive régulièrement qu’un auteur ou un groupe d’auteurs, un imprimeur-libraire ou un directeur de collection arrange des textes déjà écrits (parfois même déjà publiés) pour en faire un ensemble inédit. Lors de ce montage, l’autonomie des textes originaux est remise en jeu au sein de l’entité qui désormais les intègre. Un tel processus concerne des réalités littéraires et éditoriales fort diverses : volumes réunissant des poèmes, des contes ou des épîtres publiées d’abord séparément, œuvres complètes ou partielles d’un auteur, anthologies, feuilletons ou encore récits brefs encyclés en romans.
Le colloque “L’œuvre recomposée” sera consacré à l’étude de ces procédés de regroupement et de réagencement. Il s’agira d’étudier la manière dont plusieurs textes, naguère autonomes, sont à l’œuvre, c’est-à-dire engagent, une fois réunis, une poétique nouvelle qui relance le dispositif de signification du tout comme des parties. Les contributions prendront pour objet d’étude des parcours qui conduisent d’une pluralité de textes déjà écrits à la cohérence d’une œuvre nouvelle ; elles participeront ainsi, de manière théorique et méthodologique, à l’élaboration d’une génétique de la composition, tant auctoriale qu’éditoriale, centrée sur les opérations de (ré)organisation textuelle.
Les phénomènes étudiés étant étroitement liés à l’histoire des supports, les cas présentés pourront concerner tous les siècles de l’imprimerie, de la période des incunables – qui hérite de la pratique manuscrite du recueil factice – à celle des écrits numériques – où les textes sont pris dans un réseau virtuel à géométrie variable et en constant remaniement.
Plusieurs perspectives pourront être adoptées :
(1) La génétique textuelle a peu interrogé les opérations de (re)combinaison par lesquelles l’auteur rassemble des textes anciens. Les contributions pourront porter sur les opérations d’agencement auctoriales, telles qu’on pourra les reconstituer à partir des brouillons notamment. On s’intéressera aux opérations macrotextuelles, qui relèvent de l’élaboration du plan global, et concourent à fixer l’ordre et la hiérarchisation des parties dans le tout. On examinera également la topographie et les dispositifs péritextuels assurant une cohérence d’ensemble, préparant des lectures, favorisant une navigation dans le livre. On analysera encore dans quelle mesure ces transformations macrostructurelles conduisent à des réécritures locales, modifiant l’identité stylistique voire générique des textes réagencés.
(2) Les gestes de recomposition se produisent fréquemment à un moment de l’écriture où la poétique de l’auteur rencontre celle de l’éditeur. La négociation des projets auctoriaux et éditoriaux porte alors tout particulièrement sur le choix et l’arrangement des textes dans le livre. Par suite, les contributions porteront aussi sur l’entreprise de composition prise en charge par l’instance éditoriale en concertation avec l’auteur ou du moins avec l’assentiment de celui-ci, dont témoignent des épreuves annotées ou la correspondance auteur-éditeur. Suivant cette même perspective, certains textes peuvent être élaborés en vue d’un rassemblement à venir, que l’auteur laisse au soin d’un collectif ou d’un éditeur, de son vivant ou après sa mort. Quelle spécificité présente la production de tels écrits, nés du projet de paraître et de reparaître dans des configurations multiples et non contrôlées par l’auteur ? Comment celui-ci produit-il un texte-module dont la composition est déléguée ?
(3) Enfin, l’étude du regroupement et du réagencement conduit à se pencher sur des moments de l’élaboration des œuvres où l’éditeur agit seul, rassemblant des écrits sans l’autorisation des auteurs (recueils pirates) ou post-mortem (recueils posthumes, œuvres complètes, anthologies…). Bien qu’alors totalement allographique, la recomposition n’en demeure pas moins un processus, qui mérite une attention génétique. Quels textes sont choisis pour faire œuvre ensemble, selon quels critères de sélection, quel ordre… ? Il s’agit de reconnaître la créativité et l’historicité du geste de l’éditeur en passant, si l’on veut, de la description de ses interventions à celle de son invention.
L’analyse des processus de réagencement et de regroupement pourra croiser diverses approches telles que la génétique textuelle (identifiant les acteurs de l’œuvre polytextuelle et décrivant les processus de recomposition), la poétique (caractérisant les propriétés (péri)textuelles des œuvres recomposées), l’histoire du livre et des supports de l’écrit (questionnant les effets des supports d’écriture et de diffusion sur la recomposition et la structure de l’œuvre qui en résulte) ou encore la philologie (s’attachant à trouver des moyens d’éditer les œuvres à configuration variable).
*
Les propositions, d’environ 400 mots, seront envoyées, accompagnées d’une brève présentation bio-bibliographique, à anne.reach-ngo@uha.fr et rudolf.mahrer@unil.ch, avant le 1er décembre 2018.
*
Comité d’organisation
Rudolf Mahrer (Université de Lausanne)
Anne Réach-Ngô (Université de Haute-Alsace, Institut Universitaire de France)
avec l’aide de Marine Parra (Université de Haute-Alsace)
Comité scientifique
Jean-Michel Adam
Raphaël Baroni
Marta Caraion
Roger Chartier
Marc Escola
Almuth Grésillon
Jean-Louis Lebrave
Dominique Massonaud
Guillaume Peureux
Gilles Polizzi
Christophe Schuwey
Frédérique Toudoire-Surlapierre
Bénédicte Vauthier
Calendrier
1er décembre 2018 envoi des propositions
10 janvier 2018 réponse aux auteurs
15 mars 2019 publication du pré-programme
Bibliographie indicative
Adam Jean-Michel & Heidmann Ute (2010) : Textualité et intertextualité des contes. Perrault, Apulée, La Fontaine, Lhéritier…, Paris, Classiques Garnier.
Adam Jean-Michel (2018) : Souvent textes varient. Génétique, intertextualité, édition et traduction, Paris, Classiques Garnier.
Alexandre Didier, Frédéric Madeleine & Gleize Jean-Marie (2002) : Le Recueil poétique, Méthode ! Revue de littérature française et comparée, no2.
Audet René (2000) : Des textes à l'œuvre. La lecture du recueil de nouvelles, Québec, Éditions Nota bene.
Baroni Raphaël (2017) : Les Rouages de l’intrigue. Les outils de la narratologie postclassique pour l’analyse des textes littéraires, Genève, Slatkine.
Benjamin Walter (1972) : « Ich packe meine Bibliothek aus. Eine Rede über das Sammeln », in Gesammelte Schriften, Tillman Rexoth (éd.), Frankfurt am Main, vol. 4, 1e partie, pp. 388-396.
Baudrillard Jean (1968) : Le Système des objets, Paris, Gallimard.
bombart Mathilde & Peureux Guillaume (2003) : « Politiques des recueils collectifs dans le premier XVIIe siècle : émergence et diffusion d’une norme linguistique et sociale », in Irène Langlet, Le Recueil littéraire : pratiques et théories d’une forme, Rennes, Presses universitaires de Rennes, pp. 239-256.
Brescia Pablo & Evelia Romano (2006) : « Estrategias para leer textos integrados », in El ojo en el caleidoscopio Las colecciones de cuentos integrados en la literatura latinoamericana, Brescia, Pablo & Evelia Romano (éds.), México, UNAM, pp. 7-42.
Dumont François (dir.) (1998) : Poétique du recueil, Études littéraires, 30
(https://www.erudit.org/fr/revues/etudlitt/1998-v30-n2-etudlitt2262/).
Goeing Anja-Silvia, grafton Anthony T. & Michel Paul (éds) (2013) : Collector’s Knowledge. What Is Kept, What Is Discarded, Leiden / Boston, Brill.
Ingram Forrest L. (1971) : Representative Short Story Cycles of the Twentieth Century : Studies in a Literary Genre, The Hague, Mouton.
Grésillon Almuth (2008) : La Mise en œuvre. Itinéraires génétiques, Paris, CNRS Éditions.
Kennedy Gerald J. (1988) : « Towards a Poetics of the Short Story Cycle », in Journal of the Short Story in English, 11, pp. 9-25.
— (1995) : « The American Short Story Sequence. Definitions and Implications », in Modern American Short Story Sequences. Composite Fictions and Fictive Communities, Gerald J. Kennedy (éd.), Cambridge, Cambridge UP, pp. vii-xv.
Lebrave Jean-Louis (1994) : « Hypertexte – mémoires – écriture », Genesis, no 5, pp. 9-24. (https://www.persee.fr/doc/item_1167-5101_1994_num_5_1_951)
Letourneux Matthieu (2017) : Fictions à la chaîne. Littératures sérielles et culture médiatique, Paris, Seuil.
Mahrer Rudolf (dir.) (2017) : Après le texte. De la réécriture après publication, Genesis, 44 (https://journals.openedition.org/genesis/1579).
Matelo Gabriel (2010) : « Short Story Cycle/Cuentos integrados : apropiaciones nacionales y continentales de un formato narrativo », Actas del IV Congreso Internacional de Letras, [Buenos Aires, UBA], pp. 2207-2212.
Mora Gabriela (1993) : « Notas teóricas en torno a las colecciones de cuentos cíclicos o integrados », Revista chilena de literatura, no 42, pp. 131-137.
Langlet Irène (dir.) (1998) : Le Recueil littéraire : Pratiques et théorie d'une forme, Rennes, Presses universitaires de Rennes. Nouvelle édition (http://books.openedition.org/pur/32013).
Réach-Ngô Anne (dir.) (2014), Genèses éditoriales, Seizième Siècle, no 10 (https://www.persee.fr/issue/xvi_1774-4466_2014_num_10_1).
Sermain Jean-Paul (dir.) (2004) : Le Recueil, Féeries, no 1 (http://journals.openedition.org/feeries/61).
Schuwey Christophe (2013) : « Aux enseignes de papier : les recueils comme plateforme de publication », in Linda Gil et Ludivine Rey (dirs), Genèses des corpus littéraires à l’âge classique, Paris, CELLF (http://www.cellf.paris-sorbonne.fr/cellf-16-18/publications-en-ligne).
Jeanneret Yves & Labelle Sarah (2004) : « Le texte de réseau comme méta-forme », Culture, savoirs, supports, médiations : le texte n’est-il qu’une métaphore, Thessalonique, Université de Thessalonique (https://www.academia.edu/1011494/Le_texte_de_r%C3%A9seau_comme_m%C3%A9ta-forme).
Vauthier Bénédicte (2017) : « Las teorías sobre los ‘ciclos de cuentos integrados’ a prueba de cuatro cuentarios sobre la ‘destrucción del idilio de la tierra natal’ de Juan Eduardo Zúñiga (Largo noviembre de Madrid, La tierra será un paraíso, Capital de la gloria y La trilogía de la guerra civil) », in Hispanófila, no 179, pp. 41-59.
Voir aussi l’entrée « recueil » de l’atelier Fabula : http://www.fabula.org/atelier.php?Recueil.




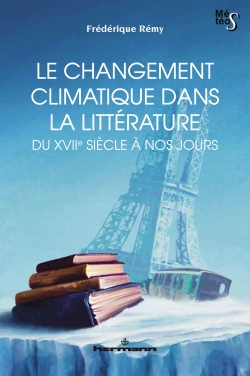 Frédérique Rémy, Le changement climatique dans la littérature du XVIIe siècle à nos jours, Paris, Editions Hermann, coll. "Météos", 2022.
Frédérique Rémy, Le changement climatique dans la littérature du XVIIe siècle à nos jours, Paris, Editions Hermann, coll. "Météos", 2022. Paul Audi, La riposte de Molière (rééd.), Lagrasse, Verdier, coll. "Verdier poche", 2022.
Paul Audi, La riposte de Molière (rééd.), Lagrasse, Verdier, coll. "Verdier poche", 2022.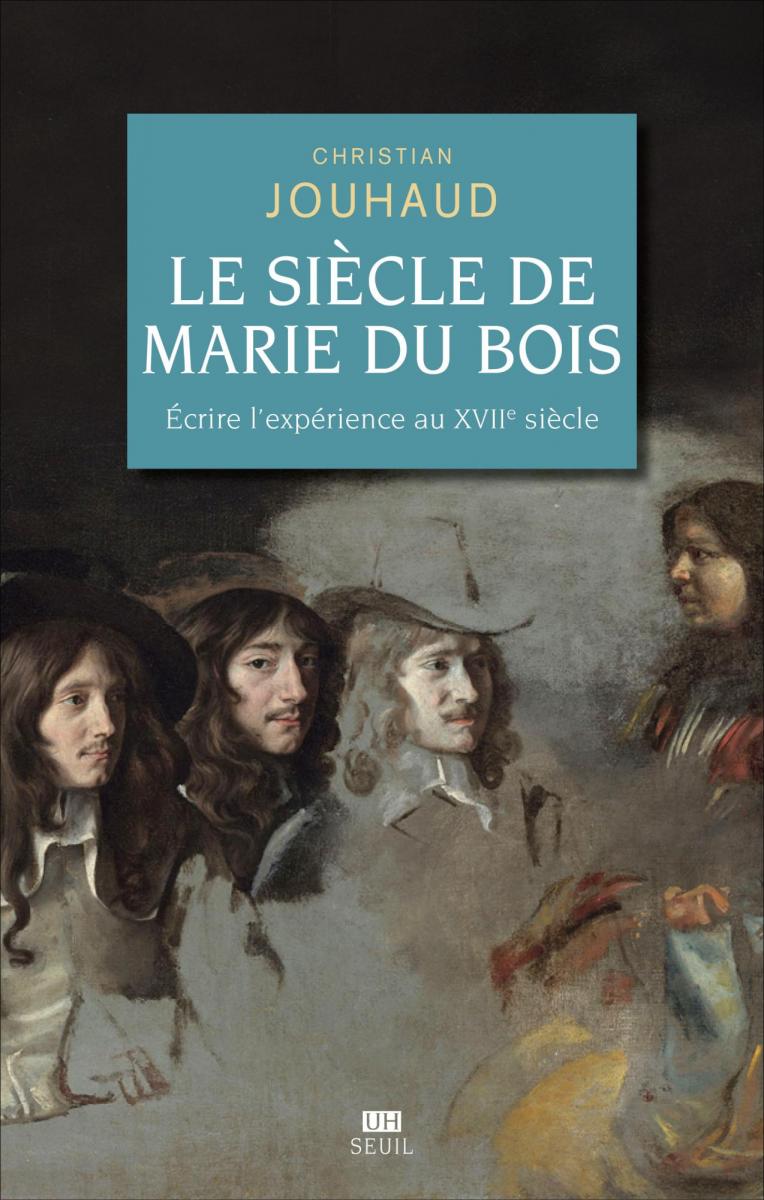 Christian Jouhaud, Le Siècle de Marie Du Bois. Écrire l'expérience au XVIIe siècle, Paris, Seuil, coll. "L'Univers historique", 2022.
Christian Jouhaud, Le Siècle de Marie Du Bois. Écrire l'expérience au XVIIe siècle, Paris, Seuil, coll. "L'Univers historique", 2022.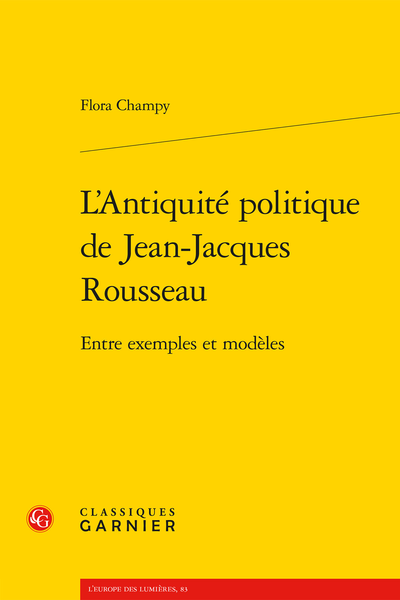 Flora Champy, L’Antiquité politique de Jean-Jacques Rousseau. Entre exemples et modèles, Paris, Classiques Garnier, coll. "L'Europe des Lumières", 2022.
Flora Champy, L’Antiquité politique de Jean-Jacques Rousseau. Entre exemples et modèles, Paris, Classiques Garnier, coll. "L'Europe des Lumières", 2022.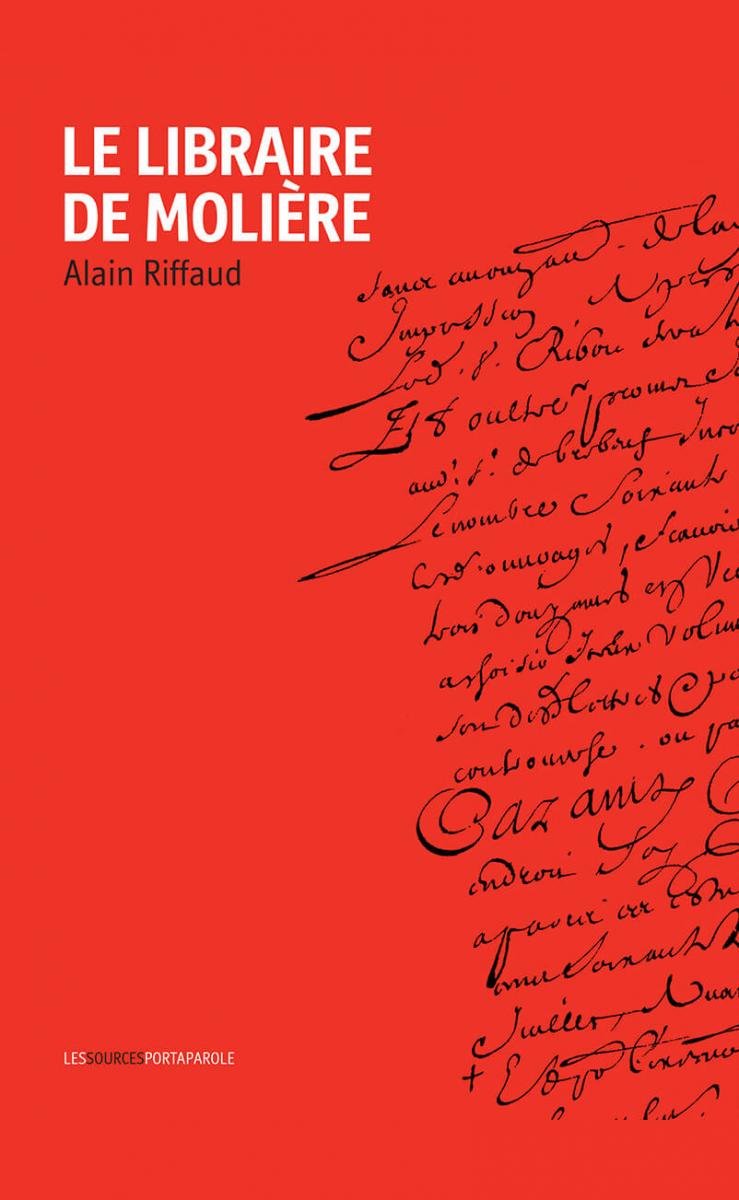 Alain Riffaud, Le libraire de Molière, Paris, PortaParole, 2022.
Alain Riffaud, Le libraire de Molière, Paris, PortaParole, 2022.