Université de Reims-Champagne Ardenne (CRIMEL, EA 3311)
2-4 octobre 2019
Les récentes études de Pierre Gatulle (Gaston d’Orléans, entre mécénat et impatience du pouvoir, Champ-Vallon, 2012) comme de Jean-Marie Constant (Gaston d’Orléans, Prince de la Liberté, Perrin, 2013), ainsi que leur catalogue de l’exposition qui s’est tenue à Blois en 2017 (Gaston d’Orléans, prince rebelle et mécène, P.U.R., 2017) ont permis de faire le point sur l’image protéiforme, au gré de la tradition et du fantasme, d’un prince autour duquel s’est construite une sorte de « cour parallèle » qui n’a rien à envier, du point de vue de son effervescence intellectuelle, artistique et idéologique, à celles des deux grands règnes du XVIIème siècle – et ce, bien qu’elle ait été souvent occultée par les aspects pittoresques et/ou discutables de l’action politique comme de la vie privée de Gaston d’Orléans.
Le colloque « Gaston d’Orléans et l’Antiquité » organisé à l’Université de Reims du 2 au 4 octobre 2019 se situera dans la lignée de ces études qui, développant les travaux de Claude Kurt Abraham (Gaston d’Orléans et sa Cour, Chapel Hill, 1964), ont permis de nuancer l’image romanesque longtemps attachée à Monsieur[1]. La figure de Monsieur, frère puis oncle du roi de France, se prête en effet aux analyses tant politiques qu’esthétiques et socio-culturelles, dans la mesure où ce prince a cristallisé, durant tout le règne de Louis XIII et ensuite dans le contexte de la Fronde, les attentes et les projections de Grands hostiles à la montée de l’absolutisme, comme de savants ou d’artistes gravitant dans sa Cour et enclins à un idéalisme social dont Gaston d’Orléans a pu sembler le champion.
Les liens de Monsieur, de son entourage et de sa cour avec l’Antiquité (grecque, romaine et hébraïque en particulier) pourront être abordés sous différents angles.
Gaston et l’Antique
- Les objets collectionnés par Gaston d’Orléans devaient refléter un goût, autant qu’ils satisfaisaient
une curiosité, comblaient un appétit de savoir et organisaient un discours implicite sur l’identité de
leur possesseur. Quelle place le collectionneur Gaston d’Orléans accorde-t-il à l’Antiquité ? Quels
types de médailles, statues, textes, objets d’art et de science semble-t-il avoir plus particulièrement
recherchés ?
- Les processus de constitution des collections et les intermédiaires : on pourra éclairer l’identité, les
parcours et la culture des intermédiaires de Gaston, qu’ils aient contribué au rassemblement ou à
la description des livres et des objets.
- Les principes de classement et de mise en valeur des objets. On sait que le château de Blois
comprenait une « galerie des Antiques » mentionnée dans l’inventaire après décès : quels principe
muséographiques (pour utiliser une notion anachronique), symboliques ou autres présidaient à
l’organisation des collections dans les demeures du prince ?
- La bibliothèque antique : quels ouvrages antiques ornaient la bibliothèque du prince ? Dans quelles
éditions et sous quelles formes ? Dans la possession des livres il est souvent difficile de faire le
départ entre intérêt bibliophile et goût de lecteur : quelles pistes peut-on suivre pour comprendre
le rapport de Gaston d’Orléans aux livres / aux textes antiques ?
- Un sort spécifique pourra être réservé au catalogue d’Augustin Courbé, libraire de Monsieur.
- Gaston d’Orléans fut très tôt donné pour modèle de l’honnête homme. Dans quelle mesure ses
collections et sa bibliothèque reflètent-elles le rapport du public mondain à l’Antiquité ? Décèle-ton
des spécificités liées à l’identité voire à la personnalité du prince ? Ses collections furent-elles
érigées en modèles et Gaston a-t-il eu des imitateurs ?
- Portraits de Gaston en prince érudit et/ou collectionneur : quelle place les antiques occupent-ils
dans les portraits du prince ?
Fictions antiques d’un prince moderne
- Quel imaginaire, quels modèles génériques, formels, esthétiques issus de l’Antiquité mit-on au
service de l’élaboration de l’image de Gaston d’Orléans, souvent donné pour un prince moderne ?
Quelles fictions antiques, explicites ou sous-jacentes, interviennent dans les représentations
littéraires et artistiques (monnaies, devises, tableaux, gravures, genres musicaux tels la chanson ou
le ballet) de Gaston d’Orléans ?
- La posture de mécène ou à tout le moins de dédicataire de Gaston d’Orléans pourra être interrogée
à travers les modèles antiques : à quelles traditions de patronage se réfère-t-on au XVIIème siècle
concernant le frère du roi ?
- Quels habits politiques hérités de l’Antiquité fit-on endosser à Gaston d’Orléans ? De quel ordre
est le rapport à l’Antiquité, et plus particulièrement l’usage de ses modèles esthétiques : repli
nostalgique, continuité, détour, travestissement parodique…
- P. Gatulle a signalé une « guerre des images » entre les proches du Roi [2]. Quels dialogues et quelles
concurrences peut-on observer entre les images issues de l’Antiquité émises autour de Gaston
d’Orléans et celles qui sont produites autour de Louis XIII sous l’influence de Richelieu, celles
auxquelles recourt Richelieu pour lui-même ou celles d’autres princes du sang ? De manière plus
générale, quel rapport à ces images Gaston a-t-il manifesté ?
- Quel imaginaire de l’Antiquité privilégie-t-on dans les cercles constitués autour de Monsieur ?
Comment la référence à l’Antiquité (rêvée) et aux auteurs antiques (allégués ou non) est-elle mise
à profit dans les oeuvres littéraires, picturales, et les ballets créés par ses protégés ? On pense entre
autres à l’Adonis de la cour de Claude Favier, à la Peruviana de Claude-Barthélemy Morisot, à la Sylvie
de Mairet, à la Climène de La Serre, aux Aventures amoureuses d’Omphale de Grandchamp, mais aussi
aux entrées et cérémonies officielles. Quelles périodes et quelles figures privilégie-t-on ? Quels liens
ces mondes imaginaires entretiennent-ils avec d’autres univers de fiction, comme les fictions
chevaleresques issues d’un Moyen Âge esthétisé ?
Modèles politiques, historiques et sociaux : Antiquitas magistra vitae ?
- Peut-on identifier dans les menées des partisans ou opposants de Gaston d’Orléans, ou dans les
productions d’auteurs contemporains, des modèles politiques issus de la pensée antique
contrevenant par exemple au machiavélisme de Richelieu ? Dans quelle mesure et de quelles
manières les différents partis ont-ils rattaché leurs valeurs et leurs revendications à l’Antiquité ?
- Quels modèles historiographiques s’élaborent à propos et autour de Gaston ? Quelle place y tient
l’Antiquité ? Dans quelle mesure les modèles antiques font-ils l’objet de recyclage, de
détournement, de manipulation, etc. ? Quels éléments de médiation, de vulgarisation, de
simplification entrent en jeu ?
- Peut-on identifier des modèles antiques de sociabilité dans les cercles savants et littéraires liés à
Monsieur ? On connaît par exemple le conseil de vauriennerie. Dans quelle mesure, dans ce conseil
et ailleurs, y a-t-il réitération et/ou parodie de pratiques antiques ?
- Culture antique et ethos aristocratique : les Mémoires de Monsieur [3], ceux de ses proches et de ses
pairs, leurs correspondances, ou encore les dédicaces d’un Tristan L’Hermite, par exemple,
témoignent d’un moment spécifique dans l’histoire de l’aristocratie. Comment l’ethos aristocratique
se manifeste-t-il dans les références, citations, allusions à l’Antiquité ?
Les propositions, qui compteront environ 500 mots, pourront être envoyées jusqu’au 31 décembre 2018 à Céline Bohnert et Valérie Wampfler :
celine.bohnert@univ-reims.fr
valerie.wampfler@univ-reims.fr
Les langues du colloque seront le français et l’anglais.
1 Cf. les titres des ouvrages de Georges Dethan, Gaston d’Orléans, conspirateur et prince charmant, Fayard, 1959 ; Christian Bouyer, Gaston d’Orléans, le frère rebelle de Louis XIII, Pygmalion, 2007, précédemment Séducteur, frondeur et mécène, Albin Michel, 1999.
2 P. Gatulle, « La grande cabale de Gaston d’Orléans aux Pays-Bas espagnols et en Lorraine : le prince et la guerre des images », XVIIe siècle, n°231, 2006 (2), p. 301-326.
3 Colloque organisé sous le patronage scientifique de Jean-Marc Chatelain (BnF), Jean-Marie Constant (Univ. Le Mans), Jean Duron (CMBV), Pierre Gatulle (Paris-Nanterre), Jacqueline Glomski (University College London), Frank Greiner (Lille III), Thomas Leconte (CMBV), Yann Lignereux (Univ. Nantes), Bernard Teyssandier (URCA).




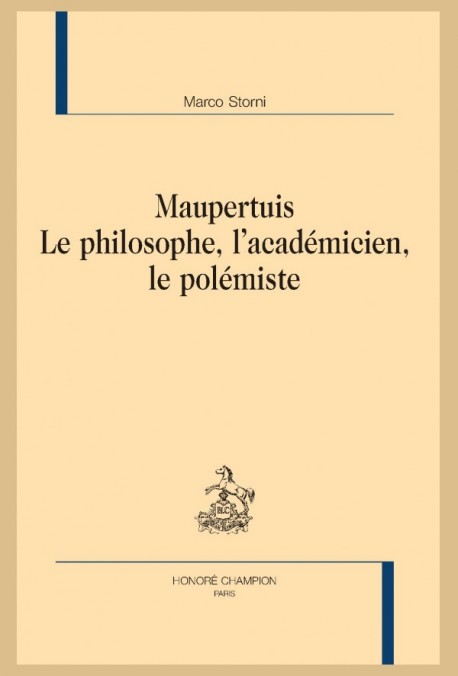 Marco Storni, Maupertius. Le Philosophe, l'Académicien, le Polémiste, Paris, H. Champion, 2022.
Marco Storni, Maupertius. Le Philosophe, l'Académicien, le Polémiste, Paris, H. Champion, 2022.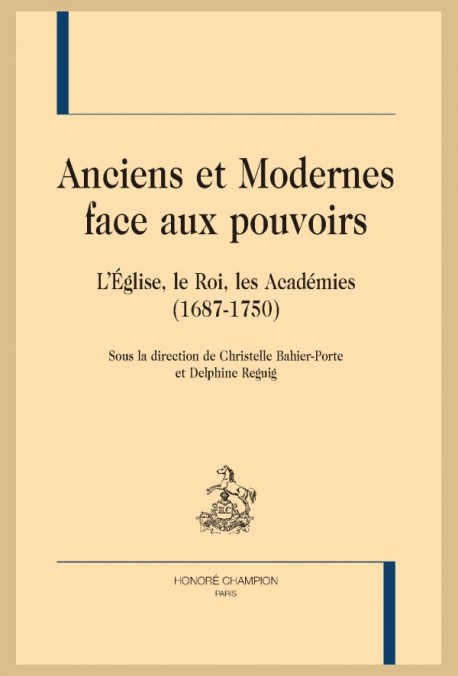 Anciens et Modernes face au pouvoir. L'Église, le Roi, les Académies (1687-1750), dir. Christelle Bahier-Port et Delphine Reguig, Paris, H. Champion, 2022.
Anciens et Modernes face au pouvoir. L'Église, le Roi, les Académies (1687-1750), dir. Christelle Bahier-Port et Delphine Reguig, Paris, H. Champion, 2022.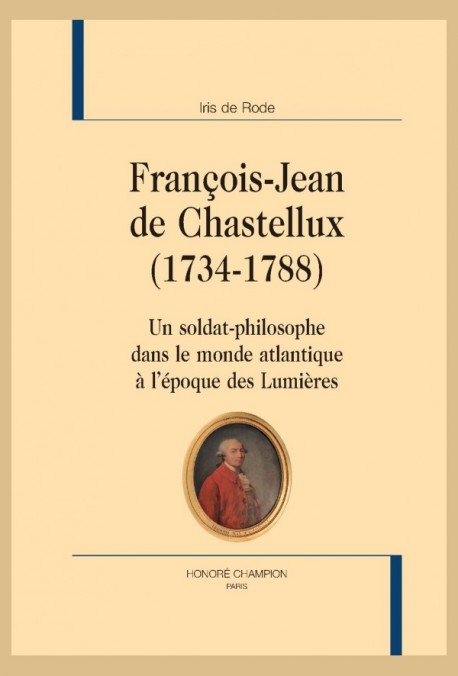 Iris de Rode, François-Jean de Chastellux (1734-1788). Un soldat-philosophe dans le monde atlantique à l'époque des Lumières, Paris, H. Champion, 2022.
Iris de Rode, François-Jean de Chastellux (1734-1788). Un soldat-philosophe dans le monde atlantique à l'époque des Lumières, Paris, H. Champion, 2022. Le dernier numéro de la revue Pratiques et formes littéraires 16-18, consacré aux "Recueils factices. La la pratique de collection à la catégorie bibliographique" (dir. Mathilde Bombart), est accessible en open access sur
Le dernier numéro de la revue Pratiques et formes littéraires 16-18, consacré aux "Recueils factices. La la pratique de collection à la catégorie bibliographique" (dir. Mathilde Bombart), est accessible en open access sur 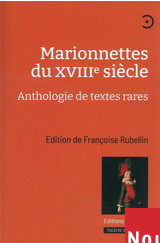 Françoise Rubellin, Marionnettes du XVIIIe siècle : anthologie de textes rares, Espace 34, 2022.
Françoise Rubellin, Marionnettes du XVIIIe siècle : anthologie de textes rares, Espace 34, 2022.