Dir. Sabine Chaouche et Jan Clarke
____________________
En 1680, Louis XIV prit une décision des plus importantes qui devait marquer la vie théâtrale de la capitale. Une nouvelle entreprise théâtrale allait voir le jour grâce à la fusion de la troupe de l’Hôtel de Bourgogne ― créée dans la première moitié du siècle ― et de la « Troupe du Roi » ― formée, après la disparition de Molière, des membres de la troupe de ce dernier et de celle du Théâtre du Marais. Elle serait plus tard connue sous le nom de « Maison de Molière », titre glorieux qui célébrerait le génie comique et l’héritage culturel de l’un des plus grands auteurs de théâtre français.
Si le talent exceptionnel de Molière en tant que dramaturge, comédien et metteur en scène a le plus souvent été salué au cours des siècles et analysé par la critique littéraire et par les spécialistes des arts de la scène, son travail en tant que directeur de compagnie et entrepreneur de spectacles, de même que le contexte dans lequel les entreprises théâtrales parisiennes ont évolué aux XVIIe et XVIIIe siècles sont fréquemment passés sous silence. De façon plus générale, la vie quotidienne du théâtre a été exclue de ces deux champs de recherche (texte et représentation théâtrale) car elle implique une approche historique à la fois sociale et économique qui s’appuie également sur l’histoire de la consommation et de la culture matérielle.
Dès le XVIIe siècle, les théâtres, de même que les spectacles de cour eurent une logistique sophistiquée et une organisation complexe. Les troupes traitaient principalement avec des artistes, des fournisseurs locaux, mais aussi régionaux, géraient un personnel nombreux et faisaient souvent face au manque de temps en matière de répétition et de production. Leur implantation au sein de certains quartiers eut un impact sur développement de ceux-ci. À partir du milieu du XVIIe siècle, les spectacles devinrent un pôle unique d’opérations commerciales étant au centre de la vie parisienne (ou de Versailles et Fontainebleau), et de l’activité économique. En ce sens, ils furent intimement liés à l’émergence de la société de consommation, vendant aux spectateurs des produits culturels mais aussi d’autres produits comme des boissons ou des livres de sujet par exemple. Les institutions théâtrales les plus importantes présentaient déjà, semble-t-il, certaines caractéristiques des entreprises culturelles contemporaines qui vendent, en outre, des produits dérivés.
Si l’on considère généralement qu’une écrasante majorité des études consacrées aux arts de la scène porte sur les théâtres parisiens, peu d’entre elles s’attachent en réalité aux aspects proprement économiques et opérationnels quotidiens des théâtres parisiens ou des spectacles de cour[1]. La préparation de ce volume a donc un double objectif : célébrer l’esprit d’entreprise symbolisé par Molière, qui n’a pas assez été pris en compte jusqu’ici, tout en observant la manière dont l’entreprise théâtrale des XVIIe et XVIIIe siècles et ses environs ont évolué, des débuts de L’Illustre Théâtre à Paris en 1643 à la scission de la compagnie de la « Maison de Molière » et de la fermeture de celle-ci en 1793.
Examiner l’interface entre les théâtres, leurs fournisseurs et leurs publics nous semble important afin de donner un nouvel aperçu de la période qui a précédé l’émergence de l’industrie théâtrale (Hemmings, 1993) et la « révolution » de la consommation (McKendrick, Brewer and Plumb, 1982). Nous recherchons des contributions qui mettent l’accent sur l’organisation des différentes compagnies parisiennes et l’exploitation des théâtres, et qui relient l’histoire du théâtre à un contexte social et économique plus large comme celui de la vie des quartiers dans lesquels étaient implantés les théâtres (moyens de transports, rues, taxes, boues et lanternes). Nous cherchons aussi à recueillir des contributions capables de mettre en lumière la vie quotidienne des employés des théâtres à travers leurs expériences, leurs compétences et leur travail, et révéler comment ils ont participé à la vie théâtrale florissante qui a marqué l’époque de Molière et plus tard le XVIIIe siècle, à un moment où la concurrence entre compagnies et institutions rivales a culminé. Nous sommes intéressées enfin par la façon dont les théâtres parisiens ont été gérés comme des entreprises culturelles et la manière dont les compagnies ont développé un réseau de fournisseurs.
Ce volume aura une double approche : il s’agira d’évaluer à la fois le macro-environnement ― c’est-à-dire le contexte social, politique, culturel et économique liés à la vie quotidienne des théâtres, ― et le microenvironnement des théâtres, c’est-à-dire leur activité économique particulière et leur organisation pratique (journées typiques, personnel et direction, coûts de fonctionnement, artisans travaillant pour les théâtres).
Nous invitons les historiens du théâtre, de la vie économique et sociale, de la culture matérielle, de la consommation, de l’histoire de Paris, Versailles ou Fontainebleau à se pencher sur les thèmes suivants :
- Le cadre de vie : la vie quotidienne dans les quartiers ou les rues environnant le théâtre (ou les villes accueillant les spectacles de cour) et les locaux, l’emplacement du théâtre ; le logement des acteurs.
- Le fonctionnement d’un théâtre ou d’une troupe : sa composition, son organisation quotidienne et l’évolution de son administration ; les horaires, les tâches à accomplir ; les comités.
- Les opérations financières et les prises de risque.
- L’intérieur du théâtre et les services ou commodités destinés à la clientèle.
- La logistique, y compris les voyages, les modes de transport, les entrepôts, le matériel utilisé, etc.
- Les affiches et les campagnes publicitaires ; les stratégies et innovations pour attirer les spectateurs.
- Le commerce : les fournisseurs majeurs ou mineurs, les biens et services fournis (pour la scène mais aussi tout ce qui a trait à l’extérieur de la scène et au fonctionnement quotidien du théâtre) ; les magasins près des théâtres ou les espaces de divertissement ; les relations entre les théâtres et les marchands.
- Les produits dérivés et les marchandises vendues dans les théâtres.
- Les réseaux d’employés et de familles ; les spectateurs ayant des relations étroites avec les troupes.
- Le niveau de vie et de consommation des acteurs ou des employés ; leurs biens immobiliers ou patrimoine ; leurs passe-temps.
Veuillez envoyer votre proposition en français ou en anglais (250 à 300 mots) accompagnée d’une courte biobibliographie (1 page maximum) avant le 30 janvier 2020 à la fois à Sabine Chaouche (sabinec@sunway.edu.my) et à Jan Clarke (jan.clarke@durham.ac.uk).
La notification d’acceptation des propositions sera envoyée d’ici la fin du mois de février 2020.
La longueur des articles attendus (en français ou en anglais) est de 6 500 à 8 500 mots, y compris les notes de bas de page. La publication est prévue en 2022.
Nous n’acceptons que les articles inédits.
______________________________________________________________________
NOTE :
[1] Voir Administrer les menus plaisirs du roi : La cour, l’État et les spectacles dans la France des Lumières de Pauline Lemaigre-Gaffier (Paris, Champ Vallon, 2015) qui constitue une somme unique sur la gestion des Menus Plaisirs au xviiie siècle. Nous n’entendons pas ici le thème de l’argent tel qu’il apparaît dans les pièces de théâtre, traité par Martial Poirson. Certains travaux relatifs à l’économie du théâtre ont abordé ce sujet sans l’examiner pleinement. Les documents d’archives sur les théâtres français publiés par W. Howarth (1997) étaient importants. Ils ont été suivis par le travail pionnier de Jan Clarke sur la production et la gestion du spectacle au xviie siècle. Ses ouvrages sur l’Hôtel Guénégaud (1998, 2001, 2007) puis des études ciblées sur les conditions de création (2006), la lumière (2011) ou l’acoustique (2013) ont offert un éclairage nouveau sur les aspects pratiques du théâtre. Les politiques culturelles, la stratégie des acteurs pour faire du profit, l’imbrication de l’économie, de l’écriture et de la performance n’ont été prises en compte que récemment. Voir Mark Darlow (2012), Sabine Chaouche (2013, 2014, 2015), S. Chaouche, Estelle Doudet et Olivier Spina (2017) ou François Velde (2018). La vie quotidienne à l’intérieur et autour des théâtres a également été minorée dans les études sur le théâtre français malgré les études de Jules Bonnassiés (1874), Georges Mongrédien (1950) et John Lough (1979) ‒ qui sont désormais assez datées. Pierre Baron a récemment publié la biographie de Louis Lécluze (2018) qui retrace son parcours d’acteur mais aussi d’entrepreneur (création du Théâtre des Variétés-Amusantes). La relation entre la consommation ou la culture matérielle et le théâtre est généralement négligée en ce qui concerne les xviie et xviiie siècles (voir cependant l’article de J. Clarke sur le Marais et quartier Saint-Germain (2011) et celui de S. Chaouche (2012) qui montre comment la présence des théâtres dans certains quartiers stimula le commerce et la consommation des Parisiens). Le numéro de la Revue d’Histoire du Théâtre consacré aux « Commerces du théâtre », dirigé par Léonor Delaunay et M. Poirson (2017), couvre par exemple uniquement le xixe siècle.
LISTE DES REFERENCES :
Alasseur, Claude, La Comédie -Française au xviiie siècle, étude économique, Paris, Mouton, 1967.
Baron, Pierre, Louis Lécluze (1711-1792), Acteur, auteur poissard, chirurgien-dentiste et entrepreneur de spectacles, Paris, H. Champion, 2018.
Bonnassiés, Jules, La Comédie-Française : Histoire administrative, Paris, Didier et Cie, 1874.
Brewer, John et Porter, Roy (dir.), Consumption and the World of Goods, Londres / New York, Routledge, 1993.
Chaouche, Sabine, « L’économie du luxe ou le théâtre recyclé. L’intendance des Menus-Plaisirs par Papillon de la Ferté », Dix-Huitième Siècle, n° 40, 2008, p. 395‒412.
—, « L’implantation des théâtres privilégiés à Paris. Locus belli, locus otii, locus negotii », dans L’Opéra de paris, la Comédie-Française et l’Opéra-comique : Approches comparées (1669-2010), S. Chaouche, Denis Herlin, Solveig Serre (dir.), Paris, École des Chartres, 2012, p. 25‒38.
—, La Mise en scène du répertoire à la Comédie-Française, 1680-1815, Paris, H. Champion, 2013.
—, “Daily Life at the Playhouse’ series”, The Frenchmag, 6 épisodes, 2012 et 2013.
—, « Stratégies économiques et politiques de programmation à la fin du xviie siècle. Les spectacles à l’heure des barbouilleurs et des amuseurs », Dix-Septième Siècle, n° 265, 4, 2014, p. 677‒690.
—, « Étude économique et sociale du théâtre de Jean-François Regnard », dans Théâtre de Jean-François Regnard, Paris, Éditions Classiques Garnier, vol. i, 2015, p. 593‒637.
Chaouche, Sabine ; Doudet, Estelle et Spina, Olivier (dir.), Écrire pour la scène, European Drama and Performance Studies, n° 9, 2017-2.
Clarke, Jan, The Guénégaud Theatre in Paris, 1673-1680. Volume one, Founding, Design and Production, Lampeter, E. Mellen, 1998.
—, Volume Two: the Accounts Season by Season, Lampeter, E. Mellen, 2001.
—, Volume three, the Demise of the Machine Play, Lampeter, E. Mellen, 2003.
—, “The Material Conditions of Molière’s Stage”, dans The Cambridge Companion to Molière, David Bradby, et Andrew Calder (dir.), Cambridge, Cambridge University Press, 2006, p. 15‒36.
—, « L’éclairage », dans La Représentation théâtrale en France au xviie siècle, Pierre Pasquier et Anne Surgers (dir.), Paris, Armand Colin, 2011, p. 119‒140.
—, « L’espace urbain dans la scénographie du dix-septième siècle », dans La Ville en scène en France et en Europe (1552-1709), Jan Clarke, Pierre Pasquier, et Henry Phillips (dir.), Oxford, Peter Lang, 2011, p. 119‒138.
—, « Les conditions matérielles de la création des Précieuses ridicules », Le Nouveau Moliériste, n°x, 2013, p. 3‒24.
—, « L’acoustique théâtrale au dix-septième siècle : le cas de la Salle des Machine », dans Les Sons du théâtre : Angleterre et France (xvie-xviiie siècle, éléments d’une histoire de l’écoute, Xavier Bisaro et Bénédicte Louvat-Molozay (dir.), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2013, p. 23‒42.
Clay, Lauren R., Stagestruck: The Business of Theater in Eighteenth-Century France and Its Colonies, Ythaca et Londres, Cornell University Press, 2013.
Cornuaille, Philippe, Les décors de Molière (1658-1674), Paris, Presses Universitaires de la Sorbonne, 2015.
Darlow, Mark, Staging the French Revolution: Cultural Politics and the Opéra de Paris, 1789-1794, New York, OUP, 2012.
Delaunay, Léonor, and Poirson, Martial (dir.), Les Commerces du théâtre, Revue d’Histoire du Théâtre, n° 276, 2017.
Forestier, Georges, Molière, Paris, Gallimard, 2018.
Hemmings, Frederic William John, The Theatre Industry in Nineteenth-Century France, Cambridge, CUP, 1993.
Howarth, William D. (dir.), French Theatre in the Neo-classical Era, 1550-1789, Cambridge, Cambridge University Press, 1997.
Lemaigre-Gaffier, Pauline, Administrer les menus plaisirs du roi : La cour, l’État et les spectacles dans la France des Lumières, Paris, Champ Vallon, 2015.
Lough, John, Seventeenth-Century French Drama: The Background, Oxford, Clarendon Press, 1979.
McKendrick, Neil ; Brewer, John, et Plumb, J.H., The Birth of a Consumer Society: The Commercialization of Eighteenth-Century England, Bloomington, Indiana University Press, 1982.
Mongrédien, Georges, La vie privée de Molière, Paris, Hachette, 1950.
—, La vie quotidienne des comédiens au temps de Molière, Paris, Hachette, 1992.
Serre, Solveig, L’Opéra de Paris (1749-1790) : politique culturelle au temps des Lumières, Paris, Éditions du CNRS, 2010.
Spanu Fremder, Silvia, Le répertoire et la dramaturgie de la Comédie-Italienne de Paris durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, thèse de doctorat soutenue à l’Université de Paris 4-Sorbonne, 2010.
Velde, François, « An Analysis of Revenues at the Comédie Française, 1680-1793 », https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3069496




 « Rire des affaires du temps (1560-1653). L'actualité au prisme du rire »
« Rire des affaires du temps (1560-1653). L'actualité au prisme du rire »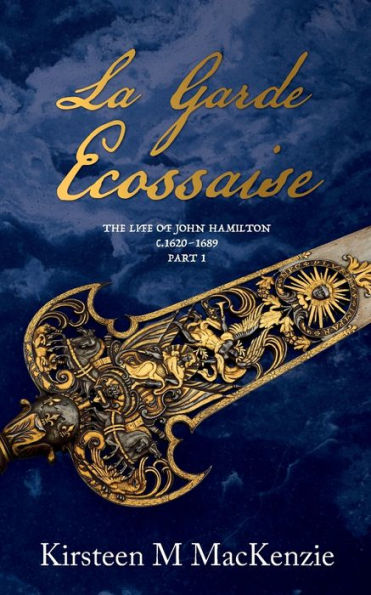 Kirsteen M MacKenzie, La Garde Ecossaise: The Life of John Hamilton c.1620-1689: Part 1, History Gateway Limited, 2022, pp.536.
Kirsteen M MacKenzie, La Garde Ecossaise: The Life of John Hamilton c.1620-1689: Part 1, History Gateway Limited, 2022, pp.536.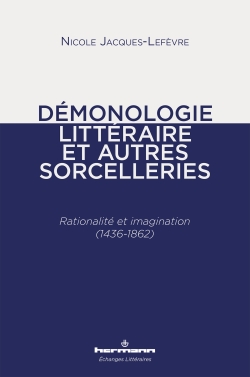 Nicole Jacques-Lefèvre, Démonologie littéraire et autres sorcelleries. Rationalité et imagination (1436-1862), Paris, Hermann, 2022.
Nicole Jacques-Lefèvre, Démonologie littéraire et autres sorcelleries. Rationalité et imagination (1436-1862), Paris, Hermann, 2022.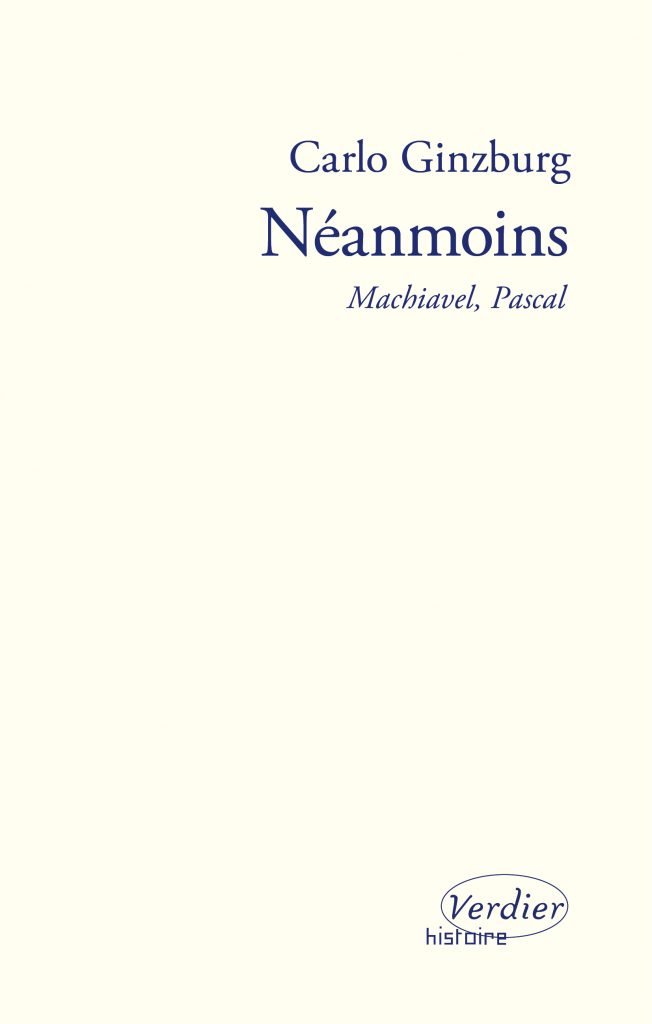 Carlo Ginzburg, Néanmoins. Machiavel, Pascal (trad. M. Rueff), Lagrasse, Verdier, 2022.
Carlo Ginzburg, Néanmoins. Machiavel, Pascal (trad. M. Rueff), Lagrasse, Verdier, 2022.