Colloque international organisé à l’université de Picardie Jules Verne par le CERCLL/CERR (Université de Picardie Jules Verne, Marc Hersant) et TELEM (Université de Bordeaux Montaigne, Catherine Ramond)
Comité scientifique : Sylviane Albertan-Coppola, Delphine Denis, Béatrice Didier, Jean Garapon, Julien Goeury, Béatrice Guion, Christophe Martin, Paul Pelckmans, Jean Sgard, Damien Zanone.
Programme des journées
Mercredi 21 octobre
9h 30 : accueil participants.
10h 00 : Marc Hersant, Catherine Ramond, introduction du colloque.
10h 20 : Session 1, présidence Pierre Frantz : Approches croisées et transversales.
10h 20 : Hélène Merlin-Kajman (Université Paris 3), « Portraits croisés des mêmes : Madame de Lafayette, La Rochefoucauld et Retz ».
10h 40 : Delphine Amstutz (Université Paris-Sorbonne), « Figures du pouvoir : portraits croisés du roi et de son favori dans les récits factuels et fictionnels du premier XVIIe siècle ».
11h 00 : Martin Rueff (Université de Genève, Suisse), « Jean-Jacques Rousseau : le portrait et le tableau ».
11h 20 : discussion et pause
11h 50 : Patrick Dandrey (Université Paris-Sorbonne), « Faire taire le désir. Portraits croisés de l’amour (et des amants) dans l’œuvre historique et romanesque de Mme de Lafayette ».
12h 10 : Françoise Poulet (Université Bordeaux Montaigne), « Voir l’homme par le petit bout de la lorgnette : les formes du portrait dans les histoires comiques et les ‘historiettes’ ».
12h 30 : Karine Abiven (Université Paris-Sorbonne), « Décrire ou raconter ? Portrait et memorabilia »
12h 50 : discussion et repas
14 h 30 : Session 2, présidence Patrick Dandrey : le portrait dans le récit historique.
14h 30 : Béatrice Didier (ENS), « Les portraits de musiciens chez Stendhal ».
14h 50 : Anne Duprat (Université de Picardie), « La construction du genre dans les portraits de Brantôme».
15h 10 : Carole Martin (Université de Texas State, USA), « Portraits : le cas des relations de voyage à la fin du XVIIe siècle ».
15h 30 : discussion et pause
16h : Camille Pollet (Université de Nantes), « Charlemagne et Mahomet : deux portraits historiques parsemés de fiction dans l’œuvre de Boulainvilliers (1658-1722) ».
16h 20 : Sergine Pelvilain (Université de Picardie), « Le portrait d’une reine sans royaume : les stratégies auctoriales de Prévost dans L’Histoire de Marguerite d’Anjou ».
16h 40 : Camille Guyon-Lecoq (Université de Picardie), « Histoire moralisée et évocation lyrique dans le portrait d’Hippolyte de Seytres par Vauvenargues : récit et poésie en prose ».
17h : discussion
17h 30 : Jan Herman (Université de Louvain, Belgique), « Les recueils de pensées comme portraits d’auteur au XVIIIe siècle : le cas des ‘Esprits’ de Marivaux et de Prévost ».
17h 50 : Riccardo Campi (Université de Bologne, Italie), « Crise du portrait de Vauvenargues à Chamfort ».
18h 10 : discussion et fin de la journée.
Jeudi 22 octobre
9h, session 3, présidence Hélène Merlin-Kajman : Croisements.
9h : Giorgetto Giorgi (Université de Pavie, Italie), « Les portraits dans le Don Carlosde Saint-Réal : histoire et fiction ».
9h 20 : Alexandre De Craim (FNRS ULB), « 'Mignard ne l’a pas mieux fait' : contiguïté du portrait galant et du portrait d’histoire dans le Mercure de Donneau de Visé (1672-1710) ».
9h 40 : Baudouin Millet (Université Lyon 2), « Portraits de Swift ».
10h 00 : discussion.
10h 20 : Lucia Omacini (Université de Venise, Italie), « Madame de Staël,Considérations sur la Révolution française face aux fictions romanesques: entre le dit et le non dit ».
10h 40 : Myriam Tsimbidy (Université Bordeaux Montaigne), « La poétique des portraits chez Bussy-Rabutin ».
11h00 : discussion et pause
11h20 : session 4 (première partie), présidence Martin Rueff : Mémoires et autobiographie.
11h 20 : Emmanuèle Lesne (Université de Clermont Ferrand), « Les portraits de Condé (et Mme la Princesse) à travers les Mémoires du XVIIe siècle: clichés et variantes ».
11h 40 : Claire Quaglia (Université Paris-Diderot), « Les portraits dans les Mémoiresdu jeune Brienne ».
12h 00 : Malina Stefanovska (Université de Californie, USA), « Le portrait du roi : histoire ou mémoire ? ».
12h 20 : discussion et repas.
14h : session 4 (seconde partie), présidence Jean Sgard : Mémoires et autobiographies.
14h : Francesco Pigozzo (École Normale Supérieure de Pise, Italie), « Le vrai et le réel dans le portrait de Monsieur par Saint-Simon ».
14h 20 : Annabelle Bolot (Université de Picardie), « Enjeux et interférences des modèles dans le portrait du duc de Bourgogne : fiction du réel ou réel de la fiction ? »
14h 40 : Jacques Berchtold (directeur de la Fondation Martin Bodmer, Suisse), « Rousseau et la question du portrait ».
15h : discussion et pause
15h40 : Frédéric Charbonneau (Université de Mc Gill, Canada), « L’irréel du portrait’ chez Saint-Simon ». (visio-conférence)
16h 00 : Laurence Mall (Université de l’Illinois, USA), « Une ribambelle de belles - les (auto-)-portraits narratifs dans Mon Calendrier de Rétif ».
16h 20 : Ilhem Belkhala, (Université de Tunis et Université Paris-Sorbonne), « Du portrait à la représentation : le cas de la prostituée dans l’œuvre de Rétif de La Bretonne ».
16h 40 : Jean-Christophe Igalens (Université Paris-Sorbonne), « Régimes du portrait dans l’Histoire de ma vie de Casanova ».
17h 00 : discussion et fin de la journée de colloque.
18h 30 : LECTURE (durée environ 1h, au Logis du Roy)
Galerie de portraits: Retz, Saint-Simon, Rousseau, par William della Rocca.
Vendredi 23 octobre
9h 30 : Session 5, présidence Marie-Françoise Melmoux-Montaubin : Feintises.
9h 30 : Jean Sgard (Université Stendhal Grenoble 3), « Histoire d’une Grecque moderne : portrait d’ambassadeur ».
9h 50 : Jean-Paul Sermain (Université Paris 3), « Dorsin, Marianne, Marivaux : la place du portrait dans la composition romanesque ».
10h 10 : Sylviane Albertan-Coppola (Université de Picardie), « Portraits de religieuses dans La Vie de Marianne ».
10h 30 : discussion et pause.
11h 10 : Marianne Charrier-Vozel (Université Rennes 1), « Portraits en série desMémoires du comte de Grammont aux romans de Crébillon et de Mme Riccoboni ».
11h 30 : Coralie Bournonville (Université de Picardie), « La quête du portrait fidèle dans les Mémoires d’un honnête homme de Prévost ».
11h 50 : Audrey Faulot (Université de Picardie), « Le déni de l’auto-portrait chez Prévost ».
12h 10 : discussion et repas.
Visite organisée de la cathédrale d’Amiens.
14h : Session 6, première partie, présidence Béatrice Didier : Fictions
14h : Paul Pelckmans (Université d’Anvers, Belgique), « La magie douteuse du portrait de Julie ».
14h 20 : Lise Charles (Université Paris-Sorbonne), « L’histoire dans le portrait. Entre allusion et dévoilement ».
14h 40 : Adrien Paschoud (Université de Lausanne, Suisse), « Arpenter les passions : l’art du portrait dans Les Aventures de Télémaque de Fénelon ».
15h : discussion et pause.
15h40 : session 6, seconde partie, présidence, Delphine Denis : Fictions
15h 40 : François Rosset (Université de Lausanne, Suisse), « Des portraits en utopie ».
16h : Luc Ruiz (Université de Picardie), « Quels portraits dans des œuvres ‘fantastiques’ de la fin du XVIIIe siècle (Cazotte, Beckford, Potocki) ? ».
16h 20 : Fabienne Bercegol (Université de Toulouse), « À la croisée des genres : le portrait dans Les Martyrs de Chateaubriand ».
16h 40 : discussion et conclusion du colloque.
RESPONSABLEs:
Marc Hersant et Catherine Ramond
Source: Fabula




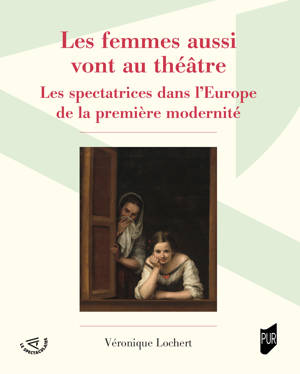 Véronique Lochert, Les femmes aussi vont au théâtre. Les spectatrices dans l'Europe de la première modernité, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2023.
Véronique Lochert, Les femmes aussi vont au théâtre. Les spectatrices dans l'Europe de la première modernité, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2023.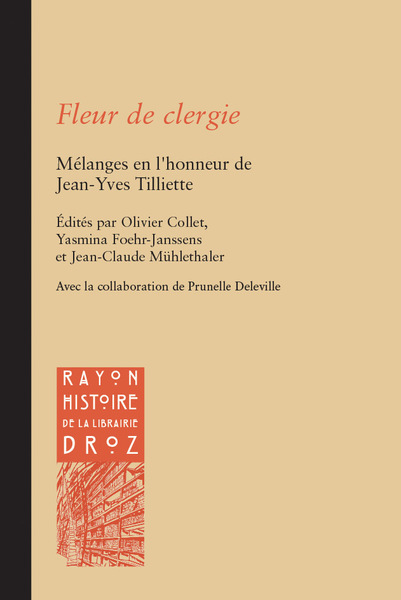 Fleur de clergie. Mélanges en l'honneur de Jean-Yves Tilliette, édition coordonnée par Olivier COLLET, Yasmina FOEHR-JANSSENS, Jean-Claude MÜHLETHALER, Genève, Droz, 2023.
Fleur de clergie. Mélanges en l'honneur de Jean-Yves Tilliette, édition coordonnée par Olivier COLLET, Yasmina FOEHR-JANSSENS, Jean-Claude MÜHLETHALER, Genève, Droz, 2023.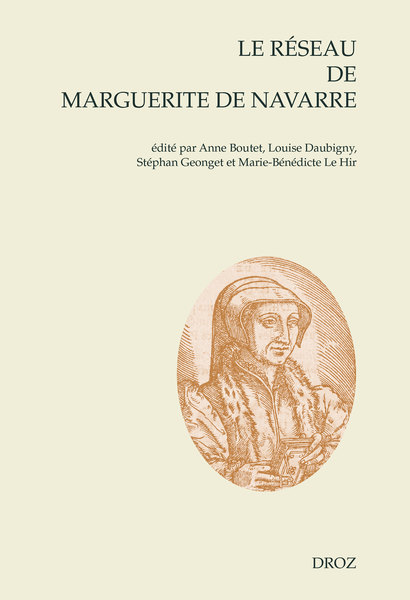 Le réseau de Marguerite de Navarre, édité par Stéphan GEONGET, Anne BOUTET, Louise DAUBIGNY, Marie-Bénédicte LE HIR, Genève, Droz, 2023.
Le réseau de Marguerite de Navarre, édité par Stéphan GEONGET, Anne BOUTET, Louise DAUBIGNY, Marie-Bénédicte LE HIR, Genève, Droz, 2023.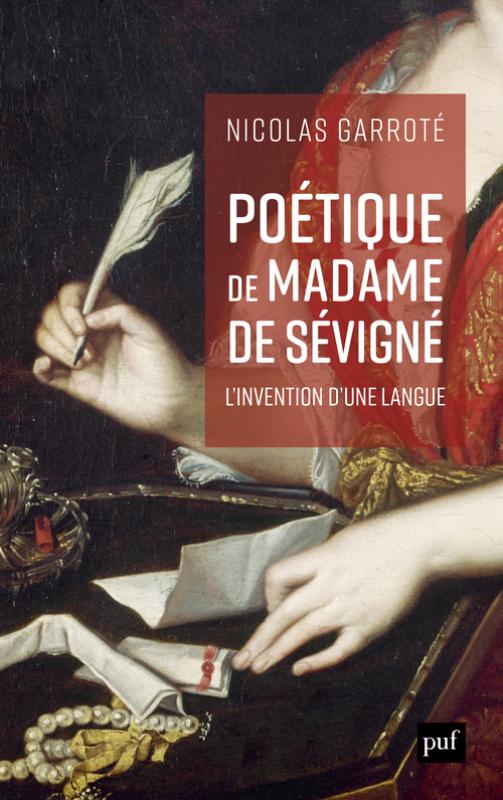 Nicolas Garroté, Poétique de Madame de Sévigné L'invention d'une langue, Paris, PuF,
Nicolas Garroté, Poétique de Madame de Sévigné L'invention d'une langue, Paris, PuF,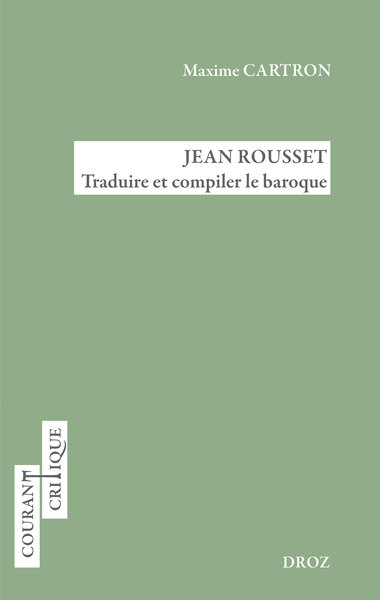 Maxime Cartron, Jean Rousset. Traduire et compiler le baroque, Genève, Droz, 2023.
Maxime Cartron, Jean Rousset. Traduire et compiler le baroque, Genève, Droz, 2023.