Faculté des Lettres et des Sciences Humaines - Université de Limoges
Vendredi 7 février 2020
Cette journée d’étude fait suite au colloque organisé par l’équipe EHIC en 2019 « Contre-cartographies dans les Amériques, XVIème-XXIème siècle » qui a révélé tout le potentiel de cette thématique. Nous souhaiterions élargir la discussion aux autres continents dans une perspective comparative et multidisciplinaire.
Les mécanismes de l’alliance entre cartes et domination et de sa subversion à travers la notion de contre-cartographie restent au cœur de notre réflexion. Il s’agit d’appliquer ce concept, issu de la géographie radicale (née des mouvements contre-culturels des années 1960 aux États-Unis), à d’autres disciplines et à l’entendre dans un sens élargi, diachronique, trans- et pluridisciplinaire pour intégrer la diversité des formes cartographiques (cognitives, sonores, corporelles, artistiques, numériques, etc.) et des politiques de la représentation qui ont pour enjeu la critique des formes hégémoniques de production de l’espace.
La cartographie critique ou radicale conteste l’hégémonie de la carte en tant qu’outil de représentation de l’espace imposée à partir du XVIème siècle par le processus de colonisation européen. L’élargissement des frontières « du monde connu » avait alors généré un profond renouvellement de la conception de l’espace et contribué au développement d’une science cartographique visant à traduire le monde sous la forme d’une image mobile et mobilisable (Mignolo). Instruments de savoir-pouvoir géopolitique et stratégique, de guerre, d’exercice de la souveraineté et d’emprise symbolique et matérielle sur l’espace national, les cartes sont les supports essentiels de la puissance gouvernementale des États modernes. Cartographier ne signifie non pas seulement connaître et rendre intelligible mais aussi domestiquer, soumettre, occulter, contrôler et même contredire l’ordre de la nature au travers d’une administration verticale des populations, des territoires et des ressources. Loin d’avoir disparu, ces processus violents se perpétuent aujourd’hui encore par le biais des nouvelles technologies de cartographie intégrale du monde.
Le discours cartographique qui aspire à garantir un reflet fidèle de la réalité (Hartley) ne produit pourtant pas tant une « vision du monde » qu’un monde. Si la carte constitue un outil majeur d’inscription territoriale et symbolique du pouvoir hégémonique, elle peut aussi faire l’objet d’un travail de démystification ou de réappropriation de la part des communautés, collectifs et individus qui contestent sa prétention à la description objective de l’ordre spatial. Ainsi, partout dans le monde, des groupes minoritaires et/ou subalternes ont pu proposer des contre-cartographies qui déconstruisent la vision totalisante des cartes hégémoniques, cherchent à en révéler les enjeux épistémiques, éthiques et politiques sous-jacents et proposent de rendre visible ce qu’elles occultent. La résistance vise non pas seulement à déconstruire les principes de vision verticale désincarnée et de divisions institués par les cartes mais aussi à reconstruire de nouvelles géo-graphies, à faire émerger d’autres rapports cognitifs au territoire, appréhendé comme lieu et support de vie.
De la même façon, les logiques de manipulation, de subversion et de détournement de l’ordre cartographique se situent au cœur d’un imaginaire qu’ont largement contribué à forger auteurs et artistes, inscrivant ses représentations dans le champ de la production culturelle. Ses déclinaisons dans les lettres, les arts visuels et performatifs invitent à l’envisager comme matériau créatif et objet de fiction, induisant, au carrefour des disciplines et des langages, de nouveaux « partages du sensible » (Rancière). C’est ce versant culturel qu’il s’agira également d’explorer à travers des réflexions croisées sur les cartes fictionnelles et métaphoriques, leur construction, leurs effets sur le lecteur ou le spectateur et les transferts éventuels de schémas hégémoniques et/ou contre-hégémoniques d’un monde à un autre. Vue sous cet angle, la carte n’est plus seulement cantonnée au rôle de compagne d’une Histoire globale unifiée (eurocentrique, étatique, patriarcale et capitaliste). Elle peut devenir le moteur d’une pluralisation critique des histoires, des mondes, des subjectivités et des territorialités.
Nous continuerons donc à explorer les questions suivantes : quels enjeux se trouvent derrière les dynamiques contre-cartographiques ? Dans quel contexte les logiques contre-cartographiques peuvent-elles se mettre en place ? Comment se créent-elles et de quelles impulsions émanent-elles ? Quels savoirs sont mobilisés dans les processus d’élaboration contre-cartographique ? Dans quelle mesure parviennent-elles à déjouer les représentations hégémoniques de l’espace ?
*
Toutes les propositions axées sur les questions contre-cartographiques, quelle que soit l’aire géographique concernée, sont les bienvenues et pourront s’intégrer dans les axes suivants (liste non exhaustive) :
Cartographie critique et radicale (militante, décoloniale, féministe, écologiste...) ;
Logiques contre-étatiques et anti-impérialistes : cartographies alternatives ;
Questionnements géopolitiques sur les sphères d’influence (mouvances, flux migratoires, frontières etc.) ;
Remise en question et redéfinition des géographies culturelles et/ou linguistiques ;
Cartographies des mondes souterrains (mafias, contrebandiers, hackers…) ;
Détournement et déconstruction des cartes dans les arts et les lettres ;
Contre-cartographies numériques.
*
Les propositions en français (400-500 mots) devront être accompagnées d’une courte biographie de leur auteur (200 mots) à envoyer avant le 15 novembre 2019 à diane.bracco@unilim.fr et lucie.genay@unilim.fr
*
Un ouvrage en français publié aux Presses Universitaires de Limoges rassemblera les articles sélectionnés à la suite de cette journée ainsi que les travaux produits par le colloque de 2019. Nous attirons donc l’attention des participant.e.s sur la date limite d’envoi des articles de 20 000 signes fixées au 30 juin 2020.
Organisateurs :
Diane Bracco diane.bracco@unilim.fr
Lucie Genay lucie.genay@unilim.fr
Philippe Colin philippe.colin@unilim.fr
Bibliographie sélective
Besse, Jean-Marc. Face au monde : atlas, jardins, géoramas, Paris, Desclée de Brouwer (Arts & esthétique), 2003.
Besse, Jean-Marc et Tiberghien, Gilles A. Opérations cartographiques. Arles, Coédition Actes Sud, 2017.
Bryan, Joe & Wood, Denis. Weaponizing Maps: Indigenous People and Counterinsurgency in the Americas. New York/London, Guilford Press, 2015.
Clerval, Anne, et. al. (dir.) Espace et rapports de domination. Collection Géographie sociale. Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015.
Crampton, Jeremy W. “Maps as Social Constructions: Power, Communication and Visualization, Progress in Human Geography”. Progress in Human Geography, Atlanta, Georgia State University, 25, 2, 2001, p. 235–252.
Farinelli, Franco. La crisi della ragione cartografica. Turin, Einaudi, 2009.
Foucault, Michel. « Questions à Michel Foucault sur la géographie ». Hérodote, n° 1, janvier-mars 1976, Dits Ecrits tome III., p. 71-85.
Garfield, Simon. On the Map: Why the World Looks the Way it Does. Londres, Profile Books, 2013.
Harley, John B. “Maps, Power and Knowledge” dans The Iconography of Landscape. Dir. D. Cosgrove et S. Daniels, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, p. 277-312.
Harley, John B. The New Nature of Maps: Essays in the History of Cartography. Baltimore, John Hopkins University Press, 2001.
Lefebvre, Henri. La Production de l’espace. 4e édition, Paris, Economica, 2000.
Mignolo, Walter. The Dark Side of Renaissance. Literacy, Territoriality and Colonization, Ann Harbor, The University of Michigan Press, 1997.
Moran, Yolanda. L’Analyse de la géographie radicale concernant le Tiers-Monde. Thèse de doctorat. Ecole Nationale Supérieure des Bibliothèques dirigée pas Angel Valle. Villeurbanne, 1989.
Poole, Peter. Cultural Mapping and Indigenous Peoples. Geneva, UNESCO, 2003.
Porto, Carlos. Geo-grafías. Movimientos sociales, nuevas territorialidades y sustentabilidad. México, Siglo Veintiuno, 2001.
Rekacewicz, Philippe. « Cartographie radicale ». Le Monde Diplomatique (Atlas du monde diplomatique), 2013.
Speranza, Graciela. Atlas portátil de América Latina. Arte y ficciones errantes. Barcelona, Anagrama, 2012.
Westphal, Bertrand. Le Monde plausible. Espace, lieu, carte. Paris, Les Éditions de Minuit, 2011.
Westphal, Bertrand. La Cage des méridiens. La littérature et l’art contemporain face à la globalisation. Paris, Les Éditions de Minuit, 2017.
Wood, Denis. The Power of Maps. New York/London, Guilford Press, 1992.
Wood, Denis et Fels, John. “Design on Signs/Myths and Meanings in Maps”. Cartographica, Ottawa, Canadian Cartographic Association, 23, 3, 1986, p. 54-103.
https://www.unilim.fr/ehic/events/event/appel-a-communications/




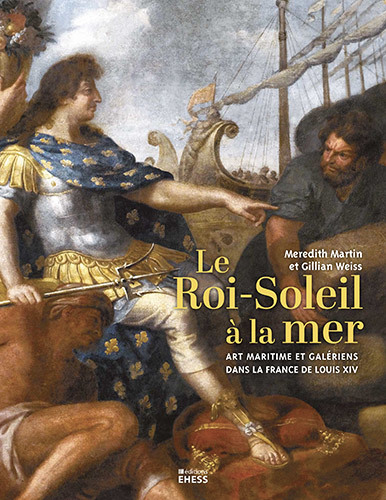 M. Martin, G. Weiss, Le Roi-Soleil à la mer. Art maritime et galériens dans la France de Louis XIV, Aubervilliers, éditions EHESS, 2022.
M. Martin, G. Weiss, Le Roi-Soleil à la mer. Art maritime et galériens dans la France de Louis XIV, Aubervilliers, éditions EHESS, 2022.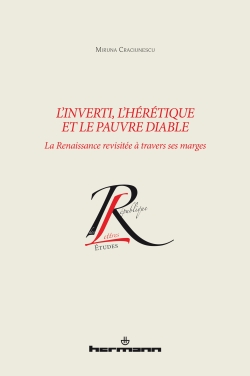 M. Craciunescu, L'inverti, l'hérétique et le pauvre diable. La Renaissance revisitée à travers ses marges, Paris, Hermann, coll. "Les collections de la République des Lettres", 2022
M. Craciunescu, L'inverti, l'hérétique et le pauvre diable. La Renaissance revisitée à travers ses marges, Paris, Hermann, coll. "Les collections de la République des Lettres", 2022 Larry F. Norman, Sous le choc de l'antique, Paris, Éditions Hermann, coll. "Échanges littéraires ", 2022
Larry F. Norman, Sous le choc de l'antique, Paris, Éditions Hermann, coll. "Échanges littéraires ", 2022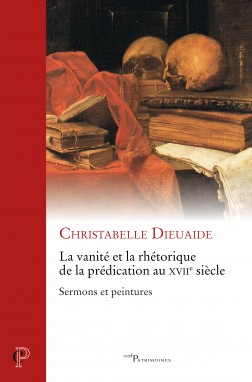 Ch. Dieuaide, La vanité et la rhétorique de la prédication au XVIIe siècle, Paris, Editions du Cerf, coll. "Cerf Patrimoines", 2022.
Ch. Dieuaide, La vanité et la rhétorique de la prédication au XVIIe siècle, Paris, Editions du Cerf, coll. "Cerf Patrimoines", 2022. L. Piettre, L'ombre de Guillaume Du Bellay sur la pensée historique de la Renaissance, Genève, Droz, 2022.
L. Piettre, L'ombre de Guillaume Du Bellay sur la pensée historique de la Renaissance, Genève, Droz, 2022.