UNIVERSITÉ DE HAUTE ALSACE, MULHOUSE – 24-25 SEPTEMBRE 2020
(En anglais ci-dessous)
À l'heure de l'information en temps réel et de la multiplication des fausses nouvelles, l'étude de la rédaction et de la circulation des nouvelles à l'époque moderne est riche en enseignements. La transmission de l'information connaît en effet d'importantes mutations aux XVIIe et XVIIIe siècles: à la diffusion orale et manuscrite s’ajoutent des canaux imprimés de plus en plus diversifiés.
Ce colloque Jeunes Chercheurs « Informer et forger l’opinion en Europe et dans la Jeune Amérique aux XVIIe et XVIIIe siècles » vise à faire le point sur les nouvelles modalités de l’information qui caractérisent les XVIIe et XVIIIe siècles. On s’intéressera principalement à la France, aux îles Britanniques et à la Jeune Amérique, mais on ne s’interdira pas d’étudier d’autres aires géographiques en Europe afin, par exemple, de mettre en évidence les réseaux impliqués dans la circulation des nouvelles.
On pourra exploiter différents types de textes : presse, correspondance, placards et autres affiches, certains libelles, critiques d'art, œuvres de fiction qui mettent en scène le processus d’information.
Deux axes seront privilégiés :
- Les formes du journalisme. On pourra mener une réflexion sur l’acte d’informer : que signifie-t-il : communiquer, polémiquer, provoquer, émouvoir, vendre, juger, créer ? Cette réflexion pourra s’intégrer à une étude du médium (quels types de textes ? quels contenus ? quels auteurs ? quels publics ?) et de son rapport à l’espace (géographie de l’information, rapport métropole-province, réseaux internationaux et transferts culturels, traductions).
- La constitution d’une sphère et d’une opinion publiques. On pourra s’interroger sur la dynamique qui sous-tend la fabrication de l’opinion et sur la relation qu’entretiennent les auteurs de nouvelles et les récepteurs. On pourra également réfléchir à la pertinence de la notion d’opinion publique dans son rapport au contexte politique et économique des aires géographiques concernées aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Quelques autres pistes possibles (liste non limitative) :
- diffusion et réseaux de l'information dans une aire géographique spécifique (Angleterre, France, Jeune Amérique) et entre différentes aires géographiques (traductions) : par exemple, la traduction et la réappropriation des journaux anglais dans la France du XVIIIe siècle ; la circulation de l’information entre l’Angleterre et les colonies en Amérique du Nord ;
- aspects matériels (techniques, logistiques, économiques, juridiques, etc.) de la création et de la diffusion des journaux : par exemple, Benjamin Franklin et la poste gratuite dans la Jeune Amérique ;
- constitution de publics : catégories socio-professionnelles visées, stratégies textuelles mises en œuvre ;
- information, rumeur, désinformation (« fake news »?) et propagande ;
- circulation de l’information, émergence et développement de la presse politique, à la faveur de crises, par exemple, comme les Guerres civiles anglaises, la guerre d’indépendance américaine ou la Révolution française ;
- presse et censure : ses modalités, ses effets, les débats qu’elle suscita, à l’image de la position de Milton défendant vigoureusement une presse libre dans son pamphlet Areopagitica ;
- chantres et contempteurs de la presse et/ou des journalistes : par exemple, confrontation entre Fréron (fondateur de l’Année littéraire) et les philosophes ;
- presse et critique d’art : par exemple, Le Mercure et la critique de spectacles ; la Correspondance littéraire, philosophique et critique pour le compte-rendu des Salons (par Diderot).
- écrivains journalistes (Defoe, Marivaux, etc.); presse et littérature ; représentation de la presse dans les œuvres de fiction ; infiltration de la fiction dans le journalisme.
- presse et gender (les femmes journalistes, les femmes destinataires des journaux...).
Les propositions de communications (environ 250 mots en français ou en anglais), accompagnées d’une courte notice bibliographique, sont à envoyer aux organisateurs avant le 30 avril 2020. Une réponse sera adressée aux auteurs avant le 15 juin 2020.
Une publication des communications, après sélection, est envisagée.
*
Comité d’organisation :
Laurent Curelly laurent.curelly@uha.fr
Christine Hammann christine.hammann@uha.fr
Véronique Lochert véronique.lochert@uha.fr
*
Partenaires associés
Institut de Recherche en Langues et Littératures Européennes (ILLE, EA 4363, Université de Haute Alsace -Mulhouse) ;
Institut Universitaire de France ;
Société d’Étude du XVIIe siècle ;
Société d’Études Anglo-Américaines des XVIIe et XVIIIe siècles (SEAA XVII-XVIII) ;
Société Française d’Études du Dix-Huitième Siècle (SFEDS).
***
A CONFERENCE FOR EARLY-CAREER SCHOLARS
UNIVERSITÉ DE HAUTE ALSACE, MULHOUSE (FRANCE) – 24-25 SEPTEMBER 2020
"THE SHAPE OF NEWS AND PUBLIC OPINION IN SEVENTEENTH- AND EIGHTEENTH-CENTURY EUROPE AND AMERICA"
Our age, in which news travels the world in a split second and fake news has become all too common, has much to learn from the study of the writing and dissemination of news in the early modern era. The modes of news transmission underwent significant change in the seventeenth and eighteenth centuries. In addition to being passed on orally or in manuscript, news rolled off the printing press in increasingly diverse forms.
This conference, intended for early-career scholars, will explore the news revolution of the seventeenth and eighteenth centuries, mostly in France, the British Isles and colonial America, but papers on other geographical areas in Europe are welcome, particularly if they seek to map out news networks on the European continent.
Various sources may be looked at, such as newspapers, correspondence, placards and bills, broadsides, pamphlets, art reviews and fiction – when it deals with news and news processing.
The following two themes will be given special treatment:
Forms of journalism: what did informing people mean in seventeenth- and eighteenth-century Europe and America? Did it mean communicating news, taking part in controversial debates, arousing interest through provocation or emotion, commodifying news, passing judgments and/or creating literary objects? This may be studied with reference to the media used (types of texts, content?), the target audience (what authors for what sort of readers?), as well as spatiality (the geography of news, the metropolis vs. peripheral areas, international news networks and cultural transfers, translations).
The formation of a public sphere: papers may explore the dynamics underpinning relationships between purveyors of news and readers. They may also study the shaping of public opinion as well as discuss the very notion of public opinion with reference to the political and economic features of France, Britain and America in the seventeenth and eighteenth centuries.
Papers may address – but are by no means limited to – the following topics:
The circulation of news and news networks in a specific geographical area (primarily the British Isles, France and colonial America) and between various geographical areas (through translation for example): e.g. the translation and recycling of English newspapers in eighteenth-century France; the circulation of news between England and its American colonies.
Material aspects of news writing and of the circulation of news (for example, technical, logistic, economic or legal aspects): e.g. Benjamin Franklin and the free post in colonial America.
Readership: what social groups were targeted? What textual strategies were used?
News, rumour and “fake news” as used for propagandistic purposes.
The circulation of news and the emergence and development of political news in times of crisis: e.g. the British Civil Wars, the American Revolutionary War or the French Revolution.
News and censorship: modes of censorship and their impact; the debates over censorship: e.g. Milton’s vindication of a free press in Areopagitica.
Champions and critics of the press and/or journalists: e.g. the debate between Fréron (the founder of L’Année littéraire) and the French philosophes.
The press and art reviews: e.g. the reviews of art events in Le Mercure; Diderot’s reviews of the Salons in Correspondance littéraire, philosophique et critique.
Fiction writers who were also news writers (Defoe, Marivaux, etc.); literature and the press; the representation of the press in fiction; the use of fiction in news writing.
The press and gender: female journalists, female readers, etc.
Paper proposals (approximately 250 words in English or in French + a short bio) should be submitted to the organisers by 30 April 2020. The programme committee will send notifications of its selection no later than 15 June 2020.
A selection of papers will be considered for publication.
*
Organising committee :
Laurent Curelly laurent.curelly@uha.fr
Christine Hammann christine.hammann@uha.fr
Véronique Lochert véronique.lochert@uha.fr
Sponsors :
Institut de Recherche en Langues et Littératures Européennes (ILLE, EA 4363, Université de Haute Alsace -Mulhouse) ;
Institut Universitaire de France ;
Société d’Étude du XVIIe siècle ;
Société d’Études Anglo-Américaines des XVIIe et XVIIIe siècles (SEAA XVII-XVIII) ;
Société Française d’Études du Dix-Huitième Siècle (SFEDS).
***
Bibliographie / Bibliography :
BAKER, Keith, Michael, « Public Opinion as Political Invention », in Inventing the French Revolution, Cambridge University Press, 1989.
— Au tribunal de l’opinion, Essais sur l’imaginaire politique au XVIIIe siècle, Paris, Payot, 1993.
BARKER, Hannah, Newspapers, politics and English society, 1695-1855, Harlow, Longman, 2000.
BONY, Alain, « Portrait du Spectator en "Socrate moderne" », in Annie Cointre, Alain Lautel, Annie Rivera eds, La Traduction romanesque au XVIIIe siècle, Artois PU, 2003, p. 141-164.
BOULARD, Claire, Presse et socialisation féminine en Angleterre de 1690 à 1750. Etudes du Gentlemen’s Journal, du Spectator et du Female Spectator, Paris, L’Harmattan, 2000.
BOYS, Jayne E. E., Londons News Press and the Thirty Years War, London: The Boydell Press, 2011.
BROWNLEES, Nicholas, ed. The Language of Periodical News in Seventeenth-Century England. Newscastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2011.
CARON, Mélinda, « L’épistolière mondaine anonyme dans les périodiques littéraires d’Ancien Régime (XVIIe-XVIIIe siècle) », article en ligne.
– « La Spectatrice, Aspasie, la comtesse de… ou le masque identitaire féminin dans la presse littéraire d’Ancien Régime », in D. Martens & M. Watthee-Delmontte (dir.), De la pseudonymie littéraire. Formes et enjeux d’une pratique auctoriale, XVIe-XXIe siècle (à paraître).
-« L’Anecdote et l’actrice dans l’imaginaire périodique des Lumières », in G. Haroche-Bouzinac et al. (dir.), L’Anecdote entre littérature et histoire, Rennes, PU de Rennes, 2015, p. 77-91.
– « L’Épistolière mondaine anonyme dans les périodiques littéraires d’Ancien Régime », in G. Pinson (dir.), La Lettre et la presse. Poétiques de l’intime et culture médiatique au XIXe siècle, numéro spécial de Médias 19, septembre 2011.
CHARTIER, Roger, « Espace public et opinion publique », Les origines culturelles de la Révolution française, Paris, Seuil, 1990 (rééd. 2000), p. 37-60.
––, La main de l’auteur et l’esprit de l’imprimeur. Paris: Gallimard, 2015.
CURELLY, Laurent, An Anatomy of an English Radical Newspaper – The Moderate (1648-9), Newcastle-upon-Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2017.
DAHL, Folke, A Bibliography of English Corantos and Periodical Newsbooks, 1620–1642. London: Bibliographical Society, 1952.
DAVIES, Simon F., and Puck FLETCHER eds, News in Early Modern Europe – Currents and Connections, Leiden and Boston, Brill, 2014.
DIJK, Suzan van, Traces de femmes : présence féminine dans le journalisme français du XVIIIe siècle, Amsterdam – Maarsen, APA-Holland University Press, 1988.
DOOLEY, Brendan ed, The Dissemination of News and the Emergence of Contemporaneity in Early Modern Europe, Farnham, Ashgate, 2010.
––, and Sabrina Baron eds, The Politics of Information in Early Modern Europe, London, Routledge, 2001.
DORNIER, Carole, « Opinion et public dans les Considérations sur les mœurs de Duclos », Dix-Huitième siècle, 28, 1984, p. 121-137.
ERTLER, Klaus Dieter, A Lévrier, M Fischer eds, Regards sur les « Spectateurs », Peter Lang, 2012.
Etudes sur la presse au 18e siècle, Centre d’Etudes du 18e siècle de l’Université de Lyon II, 1978.
FARGE, Arlette, Dire et mal dire, l’opinion publique au XVIIIe siècle, Paris, Seuil, 1992.
FEYEL, Gilles, La presse en France des origines à 1944. Histoire politique et matérielle, Paris, Ellipses, coll. « Infocom », 2007 [1999].
FOGEL, Michèle, Les Cérémonies de l’information dans la France du XVIe au XVIIIe siècle, Paris, Fayard, 1989.
FRANK, Joseph, The Beginnings of the English Newspaper, 1620–1660, Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1961.
GARNOT, Benoît, Le Peuple au siècle des Lumières, Échec d’un dressage culturel, Paris, Imago, 1990.
GAUVARD, Claude, et alii (éd.), Information et société en Occident à la fin du Moyen Age, Paris, Publications de la Sorbonne, 2004.
––, « La fausse information de la Gazette à Twitter », Le Temps des Médias, Revue d’Histoire, février 2018.
GROSPERRIN, Bernard, « Faut-il instruire le peuple ? La réponse des physiocrates », Cahiers d’histoire, 162, 1976, p. 157-169.
GUNN, Jeremy A. W., Queen of the World, opinion in the public life of France from the Renaissance to the Revolution, Oxford, The Voltaire foundation, 1995.
HABERMAS Jürgen, L’Espace public : archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise, trad. Marc B. de Launey, Paris, Payot, 1978 [1962].
HAFFEMAYER, Stéphan, L'information dans la France du XVIIe siècle. La Gazette de Renaudot de 1647 à 1663, Paris, Champion, 2003.
HALASZ, Alexandra, The Marketplace of Print: Pamphlets and the Public Sphere in Early Modern England, Cambridge, Cambridge University Press, 1997.
HARMS, Roeland, Joad RAYMOND, and Jeroen SALMAN eds, Not Dead Things : The Dissemination of Popular Print in England and Wales, Italy, and the Low Countries, 1500–1820, Leiden, Brill, 2013.
HUBERT, Jocelyne (éd.), La presse dans tous ses états : lire les journaux du XVIIe au XXIe siècle, Paris, Magnard, 2007.
JOUHAUD, Christian, et Alain VIALA, (éd.), De la publication. Entre Renaissance et Lumières, Paris, Fayard, 2002.
KOSSELECK, Reinhart, Le Règne de la critique, trad. française Paris, Editions de Minuit, 1979.
LAKE Peter, and Steve PINCUS eds, The Politics of the Public Sphere in Early Modern England, Manchester, Manchester University Press, 2007.
LANDI, Sandro, « Notes pour une histoire de l’opinion publique comme catégorie du discours politique », 2009, .
LÉVRIER, Alexis, Les Journaux de Marivaux et le monde des « Spectateurs », Paris, PUPS, 2007.
–– (éd.), La Spectatrice, Reims, Université de Reims Champagne Ardenne, coll. « Héritages critiques », 2013.
McELLIGOTT, Jason. Royalism, Print and Censorship in Revolutionary England, Woodbridge, The Boydell Press, 2007.
––, “John Crouch: A Royalist Journalist in Cromwellian England”, Media History 10:3, 2004, p. 139-55.
MERLIN-KAJMAN, Hélène, L’Absolutisme dans les lettres et la théorie des deux corps. Passions et politique, Paris, Champion, 2000.
––Public et Littérature en France au XVIIe siècle, Paris, Les Belles Lettres, 1994.
— « Figures du public au dix-huitième siècle », Dix-huitième siècle, 23, Paris, PUF, 1991, p. 345-356.
NABLOW, Ralph A, The Addisonian Tradition in France, Passion and Objectivity in Social Observation, Fairleigh Dickinson UP, 1990.
NELSON Carolyn, and Matthew SECCOMBE, British Newspapers and Periodicals, 1641–1700. A Short-Title Catalogue of Serials Printed in England, Scotland, Ireland, and British America, New York, Modern Language Association of America, 1987.
OZOUF, Mona, « Le concept d’opinion publique au XVIIIe siècle », L’homme régénéré : essais sur la Révolution française, Paris, Gallimard, 1989, p. 21-53.
PEACEY, Jason, Print and Public Politics in the English Revolution, Cambridge, Cambridge University Press, 2013.
PETTEGREE, Andrew, The Invention of News – How the World Came to Know About Itself, New Haven and London, Yale University Press, 2014.
PIÉJUS, Anne (dir.), « Mercure galant ». Articles sur la littérature, la musique et les spectacles, 1672-1710, OBVIL 2017 (http://obvil.sorbonne-universite.site/corpus/mercure-galant/).
RAYMOND, Joad, Pamphlets and Pamphleteering in Early Modern Britain, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.
––. The Invention of the Newspaper – English Newsbooks, 1641-1649, Oxford, Clarendon Press, 1996.
–– ed. News Networks in Seventeenth-Century Britain and Europe, London and New York, Routledge, 2006.
–– ed, News, Newspapers, and Society in Early Modern Britain, London andPortland, Frank Cass, 1999.
––, and Noah MOXHAM eds, News Networks in Early Modern Europe, Leiden and Boston, Brill, 2016.
RETAT, Pierre, Le Journalisme d’Ancien Régime, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1982.
REYNIE, Dominique, Le triomphe de l’opinion publique. L’espace public français du XVIe au XXe siècle, Paris, Odile Jacob, 1998.
SGARD, Jean dir., Dictionnaire des journaux (1600-1789), revue en ligne.
SGARD, Jean, et RETAT, Jean, dir., Presse et histoire au 18e siècle. L’année 1734, éd. du C.N.R.S, 1978.
VEYSMAN, Nicolas, Mise en scène de l'opinion publique dans la littérature des Lumières, Paris, Champion, 2004.
VINCENT, Monique, Le "Mercure galant" : présentation de la première revue féminine d'information et de culture : 1672-1710, Paris, H. Champion, 2005.
ZARET, David, Origins of Democratic Culture: Printing, Petitions, and the Public Sphere in Early-Modern England, Princeton, Princeton University Press, 2000.
Gazettes européennes du 18e siècle : http://www.gazettes18e.fr/




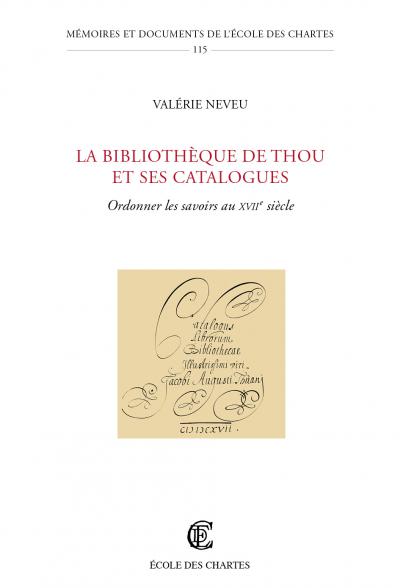 Valérie Neveu, La bibliothèque de Thou et ses catalogues. Ordonner les savoirs au xviie siècle, Paris, Ecole Nationale des Chartes, 2022.
Valérie Neveu, La bibliothèque de Thou et ses catalogues. Ordonner les savoirs au xviie siècle, Paris, Ecole Nationale des Chartes, 2022.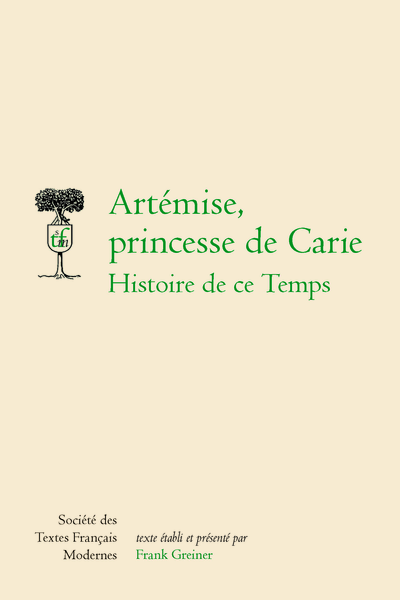 Artémise, princesse de Carie Histoire de ce Temps, éd. Franck Greiner, Paris, Classiques Garnier, coll. "Société des Textes Français Modernes", 2022.
Artémise, princesse de Carie Histoire de ce Temps, éd. Franck Greiner, Paris, Classiques Garnier, coll. "Société des Textes Français Modernes", 2022.
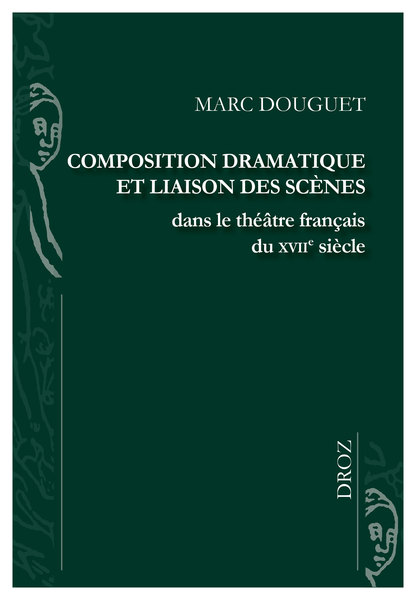 Marc DOUGUET, Composition dramatique et liaison des scènes dans le théâtre français du XVIIe siècle, Genève, Droz, 2023.
Marc DOUGUET, Composition dramatique et liaison des scènes dans le théâtre français du XVIIe siècle, Genève, Droz, 2023. Pierre de RONSARD, Les quatre premiers livres de la Franciade (1572), édité par Denis BJAÏ, François ROUGET, Genève, Droz, 2023.
Pierre de RONSARD, Les quatre premiers livres de la Franciade (1572), édité par Denis BJAÏ, François ROUGET, Genève, Droz, 2023.