Institut national d’histoire de l’art
6, rue des Petits Champs, 75002
Auditorium
Entrée libre
PARCOURS SCIENTIFIQUES : relire l’histoire théâtrale à travers la base de données
Responsables : Pierre Frantz & Sophie Marchand (Université Paris-Sorbonne)
Cette seconde journée a pour vocation de réfléchir à la manière dont l’accès aux données de la base RCF et plus généralement le recours aux humanités numériques enrichissent et modifient les recherches sur le théâtre et son histoire. Comment les parcours de recherche se trouvent-ils infléchis par la fréquentation de la base RCF ? Comment cette dernière permet-elle de faire surgir de nouvelles questions, de mettre en cause des idées reçues, de dessiner une histoire des spectacles distincte de l’histoire littéraire ? Au-delà des acquis scientifiques permis par le programme RCF, une part importante des discussions sera consacrée à des questions méthodologiques. On s’interrogera sur les usages possibles de la base RCF, sur ses publics, sur les croisements possibles avec d’autres programmes similaires concernant d’autres répertoires.
Programme de la journée
9h30 : Présentation par Pierre Frantz
Session 1 : Parcours. L’apport des registres aux recherches sur le théâtre des XVIIe et XVIIIe siècles
9h45 :Tristan Alonge (Paris IV-Sorbonne) : « Relire les succès de Racine à travers le corpus des Registres de la Comédie-Française 1680-1793 ».
10h05 : Élodie Bénard (Labex OBVIL, Paris IV-Sorbonne) : « Représentations du théâtre moliéresque : le répertoire de la Comédie-Française et les premières Vies de Molière (1680-1740) ».
10h25 Discussion
10h45 Pause
11h15 : Lauren Clay (Vanderbilt University) : « Les "best-sellers" du siècle de Lumières : le cas surprenant de Voltaire ».
11h35 : Katherine Astbury (Warwick) : « Les registres et les changements de régime sous la Révolution française ».
11h55 : Rahul Markovits (École Normale Supérieure) : « Répertoires et registres des troupes françaises en Europe : quelles possibilités d'intégration ? »
12h15 : Discussion
pause déjeuner
Session 2 : Repenser le théâtre et l’histoire des spectacles à partir des registres
14h : Gregory Brown (University of Nevada, Las Vegas) : « Retour aux registres de la Comédie-française, un dossier extraordinaire sur la vie littéraire française au XVIIIesiècle ».
14h20 : Clare Siviter (Warwick) : « Pour une approche théâtrale des bases de données ».
14h40 : Table ronde : Explorations, retours d’expériences et propositions méthodologiques sur l’usage de la base RCF par Thibaut Julian (Paris IV-Sorbonne et Université de Valenciennes), Marie-Cécile Schang (Paris IV-Sorbonne) et Virginie Yvernault (Paris IV-Sorbonne, Voltaire Foundation).
15h10 Discussion
15h40 Pause
16h : Renaud Bret-Vitoz (Université Toulouse-Jean Jaurès) : « Éclairages et apports des registres de la Comédie-Française à propos des notions de saison théâtrale et de répertoire ».
16h20 : Sophie Marchand (Paris IV-Sorbonne) : « Réflexions sur le succès scénique ».
16h40 : Logan Connors (Bucknell University) : « Stratégies pédagogiques : le site des registres de la Comédie-Française comme catalyseur de la lecture ».
17 h. Discussion
Jour III 16.12.15.
Institut national d’histoire de l’art
6, rue des Petits Champs, 75002
Auditorium & salle 528 – hackathon
Entrée libre
EXPÉRIMENTATIONS PRATIQUES : revoir et repenser le corpus en contexte numérique
responsables : Sara Harvey (Université Paris-Sorbonne / Paris Ouest-Nanterre) & Agathe Sanjuan (Comédie-Française)
Le programme technologique RCF, comme bien d’autres projets en humanités numériques en cours d’élaboration actuellement, déplace les frontières de l’archive, du corpus et de la collection, tant dans une perspective théorique et définitoire, qu’en regard des modèles classificatoires associés traditionnellement à ces différents ensembles de documents. Ces potentialités nouvelles sont évidemment liées à la structuration des espaces d’accueil virtuels qui hébergent cette documentation et produisent à leur tour du contenu : les documents sont dématérialisés et accueillis dans un nouvel environnement de conservation qui démultiplie les potentiels lecteurs, ils sont redynamisés par des initiatives éditoriales originales et ouvertes à divers usagers, ils sont aussi transformés par l’élaboration de bases de données et d’outils de recherche et de visualisation qui en exploite la puissance quantitative. Ces approches novatrices de la documentation font apparaître des parcours inédits de consultation, tout autant que des hypothèses de recherche renouvelées. Des programmes comme le nôtre invente en quelque sorte un espace muséal dynamique dans lequel l’archive patrimoniale s’expose autant qu’elle se métamorphose et nous invite à repenser à tous points de vue la place, aussi bien que la situation et le sens de la documentation dans l’économie d’ensemble des institutions virtuelles en devenir et des pratiques de recherche qui y sont associées.
Partant de cette réflexion initiale, notre journée de réflexion vise à interroger les manières actuelles de lire les documents, de les voir, de les penser et de les redéfinir. Pour cela, il nous apparaît nécessaire d’axer notre dialogue sur les pratiques, ainsi que sur des programmes concrets. Les savoir-faire exigés par ces programmes en humanités numériques érigent un nouvel art de faire des sciences humaines, de mettre en valeur et en scène la culture et d’en extraire de nouvelles réflexions critiques.
Ainsi, notre journée sera entièrement dédiée à cet « art du faire », celui des informaticiens d’abord, avec une session de travail intensive sur les outils de visualisation optimaux, puis celui des spécialistes de la documentation qui sont aujourd’hui amenés à rencontrer les chercheurs pour entamer un dialogue aussi fécond que nécessaire.
La journée se déroulera en deux sessions complémentaires & parallèles
- un hackathon axé sur le développement des outils de visualisation et les processus d’interopérabilité adaptés aux outils de recherche du programme RCF.
- une rencontre entre professionnels de la documentation et chercheurs autour des notions d’archives, de corpus et de collections en contexte numérique.
Programme de la journée
9h accueil des participants
9h15 Sara Harvey & Agathe Sanjuan : présentation générale du projet RCF et introduction à la problématique de la journée : les notion de corpus, d’archives, de fonds et de collection face aux humanités numériques
Jamie Folsom : les interfaces de programmation - projet RCF
11h Début du hackathon
Informaticiens invités : Frédéric Glorieux (OBVIL– Paris Sorbonne), Christophe Schuwey (Paris-Sorbonne et Université de Fribourg), Marouane Hachicha (Université de Nantes, projet Comédie Italienne), Christopher York (MediaLab, MIT), Jamie Folson (MediaLab, MIT), Kurt Fendt (MediaLab, MIT), Bertrand Bordage (Université de Rouen, Dezède, NoriPyt), Raphaëlle Lapôtre (BnF), Adrien Di Mascio (LOGILAB)
11h : Première table ronde : les humanités numériques & les projets de « corpus » en histoire du théâtre
Joann Elart, projet Dezède ; Paul Fièvre, projet Théâtre classique ; Georges Forestier, projet Molière ; Ruth Martinez, projet Libre Théâtre ; Lise Michel, projet Naissance de la critique dramatique ; Françoise Rubellin, projet CIRESFI - étude des Registres de la Comédie-Italienne
13h déjeuner
14h30 : Seconde table-ronde : les humanités numériques et la politique nationale
- Sonia Zillhardt, Département de la Recherche, de l’Enseignement Supérieur et de la Technologie, Ministère de la Culture et de la Communication // Joann Elart, Université de Rouen
15h15 : Troisième table-ronde : les humanités numériques à la BnF
- Emmanuelle Bermes, adjointe scientifique et technique auprès du Directeur des services et des réseaux, Isabelle Brueil, chargée de la mission de coordination de la médiation numérique, Clara Fougerol, coordinatrice du signalement et du traitement des métadonnées pour la direction des collections, Cécile Geoffroy, responsable du numérique département des Arts du Spectacle // Françoise Rubellin, Université de Nantes
16h : Quatrième table-ronde : les humanités numériques et les archives nationales
- Jessica Huyghe, responsable du service image, adjointe au responsable du, Département de la conservation, Archives nationales (sous réserve) ; Charlotte Renaud
Chargée de projets de numérisation, Département de la Conservation, Archives nationales // Jeffrey Ravel, MIT
Partenaires : ANR, Comédie-Française, Paris-Ouest Nanterre, Paris-Sorbonne, MIT, Harvard, Labex Passé dans le présent




 Brienne le Jeune, Mémoires Tome I Première rédaction, 1re partie (1682-1684), éd. J. Delon, Paris, Honoré Champion, 2022.
Brienne le Jeune, Mémoires Tome I Première rédaction, 1re partie (1682-1684), éd. J. Delon, Paris, Honoré Champion, 2022.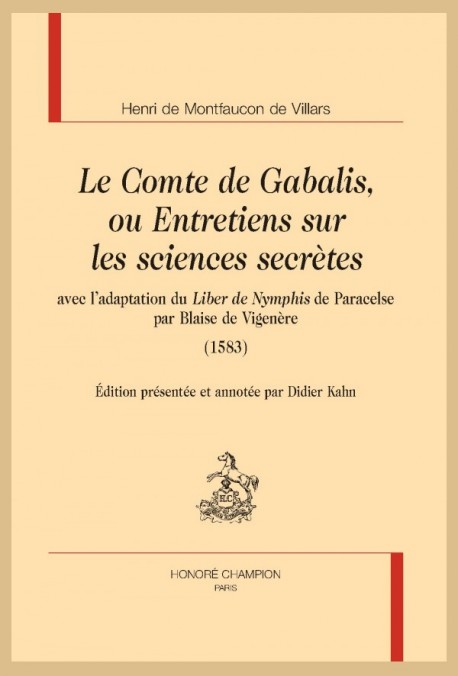 Henri de Montfaucon de Villars, Le comte de Gabalis, ou entretiens sur les sciences secrètes, avec l'adaptation du "Liber de Nymphis" de Paracelse par Blaise de Vigenère (1583), réimpression de l'édition de 2010 en version brochée, présentée et annotée par Didier Kahn - Paris, Honoré Champion, 2022.
Henri de Montfaucon de Villars, Le comte de Gabalis, ou entretiens sur les sciences secrètes, avec l'adaptation du "Liber de Nymphis" de Paracelse par Blaise de Vigenère (1583), réimpression de l'édition de 2010 en version brochée, présentée et annotée par Didier Kahn - Paris, Honoré Champion, 2022. Correspondance générale de La Beaumelle (1726-1773) Tome XVII Septembre 1769 – 1er Août 1772, éd. Hubert Bost, Claude Lauriol et Hubert Angliviel de La Beaumelle, Avec Pauline Haour, Claudette Fortuny et François Pugnière, Paris, Honoré Champion, 2022.
Correspondance générale de La Beaumelle (1726-1773) Tome XVII Septembre 1769 – 1er Août 1772, éd. Hubert Bost, Claude Lauriol et Hubert Angliviel de La Beaumelle, Avec Pauline Haour, Claudette Fortuny et François Pugnière, Paris, Honoré Champion, 2022.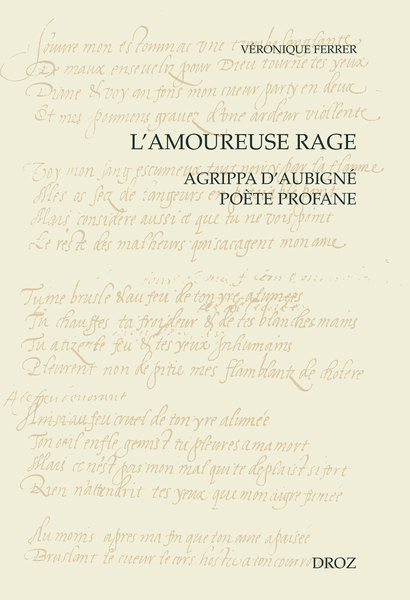 Véronique Ferrer, L'amoureuse rage. Agrippa d'Aubigné poète profane, Genève, Droz, 2022.
Véronique Ferrer, L'amoureuse rage. Agrippa d'Aubigné poète profane, Genève, Droz, 2022.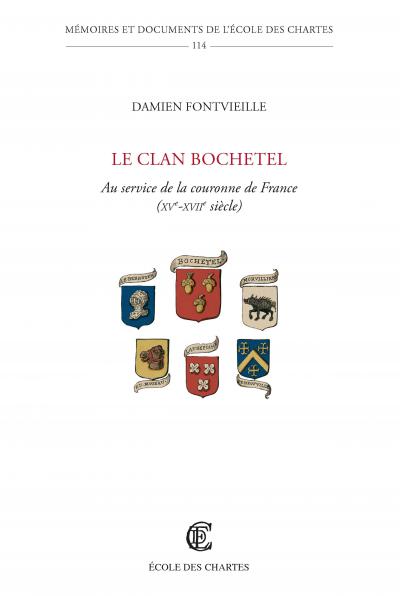 Damien Fontvieille, Le clan Bochetel. Au service de la couronne de France (XVe-XVIIe siècle), Paris, Ecole des Chartes, 2022.
Damien Fontvieille, Le clan Bochetel. Au service de la couronne de France (XVe-XVIIe siècle), Paris, Ecole des Chartes, 2022.