Montréal (21-22 octobre 2020), avant le 15 janvier 2020
Colloque international « jeune-chercheur » d’histoire de la guerre de Montréal
Le théâtre de la guerre a longtemps été perçu comme le domaine réservé des hommes. Les femmes sont pourtant loin d’en être absentes qu’elles la subissent ou bien qu’elles en soient les actrices. Central dans toutes les sociétés, le fait militaire et l’expérience de la guerre est également un élément important de la construction sociale des genres depuis l’Antiquité. Organisé dans le cadre des activités du Groupe de recherche en histoire de la guerre, ce colloque a donc pour ambition d’interroger les relations qu’entretiennent les femmes et la guerre et la manière dont les « féminités » s’y construisent.
L’histoire militaire des femmes s’est en effet longtemps réduite à celle des grandes figures féminines occidentales et des cheffes de guerre, de Boudicca à Jeanne d’Arc. Lorsqu’elles apparaissaient, les femmes étaient réduites aux violences qui leur avaient été faites, ou à leur expérience à l’arrière du front en tant qu’infirmières, ouvrières, ou messagères. Lorsqu’il était question de genre, cela était surtout la construction des identités masculines dans la guerre qui était interrogée. Il a fallu attendre l’ouverture du recrutement aux femmes dans l’armée au xxe siècle pour que les travaux commencent à s’intéresser à leur participation à l’institution militaire, ou aux combats (Thomas, 1978 ; Bard, 1995). Plus récemment, des études ont mis l’accent sur leur expérience de combattantes, sur la place des femmes dans les structures et les institutions militaires, ainsi que sur les interactions des forces armées avec les sociétés, pour accéder à l’expérience des femmes dans la guerre (Lynn, 2008 ; Virgili 2011 ; Clio, 2006).
À la croisée de l’histoire du fait militaire, de l’histoire des femmes et de l’histoire du genre, ce colloque souhaite aborder les multiples formes de la présence des femmes au sein des armées, de leurs expériences de guerre et de la construction des « féminités » en milieu guerrier. Il souhaite aborder ces thématiques dans la longue durée, de l’Antiquité à nos jours, et en dépassant les frontières de l’Europe pour embrasser ces questions de manières globales et transnationales. Car les relations des femmes à l’armée et la construction sociale des genres en son sein, comme leurs formes, leurs manifestations et leurs sens, diffèrent selon les époques, les lieux et les conflits. Les relations, les rôles et les identités sexuelles sont ainsi déterminés et réinterprétés au prisme des normes martiales, sociales et culturelles dans lesquels ils s’insèrent. Ce colloque propose donc de poursuivre les réflexions initiées par les historiens et historiennes de la guerre et du fait militaire et de participer au renouvellement de leurs questionnements. Quelles relations les femmes entretiennent-elles à l’armée ? Quels y sont leurs rôles ? Comment penser et représenter les « féminités » guerrières ? Quelle place prennent-elles dans l’imaginaire du combattant ? En quoi les représentations militaires, sociales et culturelles influencent-elles l’expérience des femmes dans l’institution militaire et dans les combats ?
Au carrefour de ces réflexions, les propositions de recherche pourront se décliner à partir de quelques grandes lignes directrices :
-Penser le rapport entre les femmes et les institutions militaires dans différents contextes chronologiques, politiques et culturels ;
-Explorer l’expression, la construction et l’évolution des « féminités » dans le contexte guerrier ;
-Examiner l’expérience de guerre des femmes qu’elles soient combattantes ou non.
Le colloque, organisé avec le soutien notamment du département d’histoire de l’UQAM, du Centre Interuniversitaire de Recherche sur la première Modernité (CIREM 16-18) et du Groupe de recherche en histoire des sociabilités (GRHS), se veut interdisciplinaire et ouvert à tous les jeunes chercheuses et chercheurs des cycles supérieurs (maîtrise, doctorat et post-doctorat) en histoire, histoire de l’art, études littéraires et philosophie, ainsi que de tous les autres champs des sciences sociales. Il accueillera toutes propositions en lien avec l’étude des femmes en situation de guerre, de l’Antiquité à nos jours. Les thématiques soulevées ci-dessus ne limitent en rien les propositions de communication.
Les propositions de communication peuvent être envoyées en français ou en anglais (300 mots maximum) avant le 15 janvier 2020, à l’adresse qui suit : colloque.grhg@gmail.com. Les propositions devront comprendre une brève présentation du corpus étudié (les sources, le cadre de l’enquête et méthodologie) et une courte bibliographie (10 titres max). Elles devront également comprendre votre nom, prénom et affiliation institutionnelle, le niveau d’étude (maîtrise, doctorat, post-doctorat), un curriculum vitae et indiquer les éventuels besoins de soutien financier pour le déplacement et l’hébergement ainsi que le coût estimé du voyage. Le colloque aura lieu le 21-22 octobre 2020*.
Note importante. Dans la mesure du possible, les organisateurs chercheront à assurer le transport et le logement des participants au colloque. Cependant, tous ceux ou celles qui peuvent éventuellement assurer leur propre financement grâce au soutien de leur université ou de leur centre de recherche, sont invités à le faire savoir au moment de l’envoi du dépôt de leur proposition. L’existence du financement externe (même non assuré) est, en effet, un important prérequis pour la demande de subvention générale qui sera déposée pour l’organisation du colloque.
Comité scientifique : Violaine Sebillotte Cuchet (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Lyse Roy (UQÀM), Carl Bourchard (Université de Montréal), Ersy Contogouris (Université de Montréal), Piroska Nagy (UQÀM), Frédéric Charbonneau (Université McGill), Benjamin Deruelle (UQÀM)
Comité organisateur : Nicolas Handfield, Philipp Portelance, Vicky Laprade, Philippe Sainte-Marie, Chloe Raymond-Poitras, Mathilde Viberti, Alexandre Vaillancourt




 Isabelle Coquillard, Corps au temps des Lumières. Les docteurs régents de la Faculté de médecine en l'Université de Paris au XVIIIe siècle, Paris, Honoré Champion, 2022.
Isabelle Coquillard, Corps au temps des Lumières. Les docteurs régents de la Faculté de médecine en l'Université de Paris au XVIIIe siècle, Paris, Honoré Champion, 2022. Nicolas Brucker, Lumières et religion. La transcendance dans le roman : Prévost, Rousseau, Rétif, Paris, Honoré Champion, 2022.
Nicolas Brucker, Lumières et religion. La transcendance dans le roman : Prévost, Rousseau, Rétif, Paris, Honoré Champion, 2022.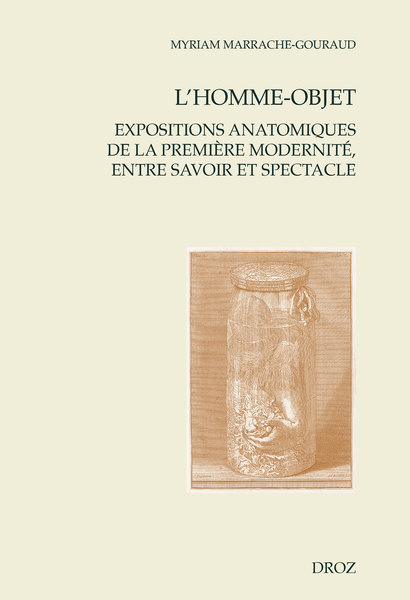 Myriam MARRACHE-GOURAUD, L'homme-objet Expositions anatomiques de la première modernité, entre savoir et spectacle, Genève, Droz, 2022.
Myriam MARRACHE-GOURAUD, L'homme-objet Expositions anatomiques de la première modernité, entre savoir et spectacle, Genève, Droz, 2022. Firmin Abauzit (1679-1767). Production et transmission des savoirs d'un intellectuel au siècle des Lumières, dir. Maria-Cristina Pitassi, Paris, Honoré Champion, 2022.
Firmin Abauzit (1679-1767). Production et transmission des savoirs d'un intellectuel au siècle des Lumières, dir. Maria-Cristina Pitassi, Paris, Honoré Champion, 2022.