Numéro 54 de Clio. Femmes, genre, histoire
Parution : automne 2021
Propositions à envoyer pour le 1er mars 2020
Dossier coordonné par Bibia Pavard et Juliette Rennes
Argumentaire de l’appel
La nudité dévoile autant le corps que les conventions qui en régissent l’usage. Dans ce numéro de Clio, la nudité est appréhendée comme un révélateur et un catalyseur des normes sociales et des rapports de domination. Le genre de la nudité est ainsi envisagé en relation avec d’autres dimensions sociales du corps : l’âge, la classe sociale et le statut ethnoracial.
Si les représentations de la nudité constituent un sujet traditionnel de l’histoire de l’art, l’étude de la nudité comme pratique sociale —le fait de se dénuder— est plus récente. Des travaux sur ce sujet se sont développés en relation avec l’essor de l’histoire culturelle du corps, des sensibilités et des émotions. Un numéro spécial de la revue Rives méditerranéennes en 2008 avait posé un jalon important en appelant aux enquêtes empiriques précises au-delà de l’hypothèse de Norbert Elias associant civilisation des mœurs et recouvrement des corps (Bertrand et Carol 2008).
On fait ici l’hypothèse que l’approche en termes de genre, en articulation avec d’autres catégories d’analyse, éclaire de nombreuses dimensions de l’acte de se dénuder et que, réciproquement, étudier la nudité aide à mieux comprendre l’évolution des normes et rapports de genre et d’autres rapports de domination.
Les articles pourront aborder les pratiques de dénudement contraintes ou volontaires à différentes époques et dans une variété d’espaces géographiques et sociaux (les espaces urbains ou ruraux, la maison, la scène, les bains, la plage, le stade…).
Cinq angles d’analyse, non exclusifs les uns des autres, pourront être abordés.
v Se dénuder comme geste d’humiliation/humilité ou au contraire comme acte de célébration de certaines normes corporelles. Comment ces significations morales de l’acte de se dénuder varient selon le genre, le statut social, les époques, les contextes (guerrier, policier, judiciaire, religieux, sportif…) ?
v L’érotisation du dénudement. Quels types de corps sont-ils valorisés pour être érotisés ? Selon les sociétés et les époques, que peut-on montrer des corps dans un contexte érotique, en fonction du genre, de l’origine, de l’âge ?
v Se dénuder comme pratique professionnelle. Quelles sont, à travers l’histoire, les métiers et les activités professionnelles impliquant de se dénuder (sur des scènes de danse ou de théâtre, pour des peintres et sculpteurs, devant la caméra ou l’objectif photographique…).
v L’encadrement juridique. Qu’est-ce qui est permis et interdit, pour qui, dans quels contextes et dans quels lieux ? De l’outrage public à la pudeur à l’exhibitionnisme, et au voyeurisme, comment à travers l’histoire ont évolué les lois ou les normes qui régissent la nudité en fonction du genre, du statut social, de l’orientation sexuelle, ou de l’âge ?
v L’hygiène, la médicalisation, l’enquête scientifique. Dans quelle mesure l’évolution des normes d’hygiène transforme-t-elle les interdits sur la nudité ? Comment la médicalisation change-t-elle le regard sur les corps dénudés ? Que sait-on de l’expérience de se dénuder face à des médecins ou des scientifiques à travers les époques ?
v La politisation du geste de se dénuder. Dans quels contextes se dénuder peut-il être un acte militant ? Au cours des deux derniers siècles, naturisme, féminisme, écologie, antispécisme, « maNufestations » ou performances artistiques nues ont contribué à re-signifier la nudité : le fait de montrer son corps entièrement ou en partie nu (par exemple la poitrine pour les femmes) est érigé en acte de contestation de l’ordre établi. Quels ont été ces différents usages militants — contestataires, révolutionnaires mais aussi réactionnaires— de la nudité à travers les époques ?
NB : Clio est une revue trans-période qui accueille des articles portant sur l’antiquité, l’époque médiévale, moderne et contemporaine.
Les propositions d’articles inédits en anglais ou français sont à envoyer pour le 1er mars 2020 à : bibiapavard@gmail.com et rennes@ehess.fr
Elles devront comporter de 4000 à 6000 signes et présenter les sources, la problématique, les thématiques envisagées, la manière dont l’article s’insère dans l’historiographie et comporteront cinq titres bibliographiques maximum.
Elles seront accompagnées d’une présentation bio-bibliographique de l’auteur·e (max. 10 lignes).
Outre les articles de recherche peuvent être proposés pour ce dossier :
1-Des suggestions de comptes rendus d’ouvrages en sciences sociales sur la nudité (Envoyer une proposition en présentant l’ouvrage et son intérêt pour Clio et le dossier « Se dénuder » en 1000 à 2000 signes)
2-Des articles de commentaire de document pour la rubrique « document » de Clio (Envoyer une proposition de présentation du document et de son lien avec le dossier « Se dénuder » en 2000 à 4000 signes).
3-Un état de la recherche sur les travaux sur la nudité pouvant porter sur une période précise ou un sous-aspect particulier (Envoyer une proposition de 4000 à 6000 signes).
Calendrier :
v Propositions d’articles inédits en anglais ou français sont à envoyer pour le 1er mars 2020
v Réponse du comité de rédaction sur l’acceptation ou le refus de la proposition le 15 avril 2020.
v Articles à remettre pour le 1er sept. 2020 – ils seront soumis à expertise interne et externe au comité de rédaction. Ils ne doivent pas dépasser 40 000 signes (notes, espaces, annexes et bibliographie compris).
v Réponse du comité de rédaction sur l’acceptation ou le refus de l’article en novembre 2020.
v La version définitive des articles doit être envoyée pour le 1er mars 2021.
v Publication prévue à l’automne 2021 (version imprimée et numérique en français suivie d’une version numérique en anglais).
Références bibliographiques à titre indicatif
bard Christine, 2014, « ‘Mon corps est une arme’, des suffragettes aux Femen », Les Temps Modernes, vol. 678, n°2, p. 213-240.
bauberot Arnaud, 2015, Histoire du naturisme. Le mythe du retour à la nature, Rennes, Presses universitaires de Rennes.
Bertrand Régis et Carol Anne (dir.), 2008, « Le corps dénudé », Rives méditerranéennes n°30.
Beth A. Eck, 2001, « Nudity and Framing: Classifying Art, Pornography, Information, and Ambiguity », Sociological Forum, Vol. 16, No. 4, p. 603-632
Boquet, 2019, « Sancta verecundia. Conceptions et usages de la honte dans l’hagiographie féminine au XIIIe siècle », Mémoire original présenté pour l’obtention de l’Habilitation à diriger les recherches en histoire médiévale, soutenu le 22-06-2019.
Brancher Dominique, 2012, « Splendeurs et misères des figures de style : Pudeurs du discours médical aux XVIe et XVIIe siècles », Histoire, médecine et santé, juin, no 1.
Burgelin Olivier et Perrot Philippe, 1987, « Parure, pudeur, étiquette », Communications, n°46.
Corbin Alain (dir.), 2011, Histoire du corps, tome 2: de la Révolution à la Grande Guerre, Paris, Seuil.
Cordier Pierre, 2005, Nudités romaines : un problème d’histoire et d’anthropologie, Paris, les Belles lettres.
Courtine Jean-Jacques (dir.), 2011, Histoire du corps, tome 3: Les mutations du regard, le XXe siècle, Paris, Seuil.
Dalibert Marion, et Quemener Nelly, 2014, « Femen, l’émancipation par les seins nus ? », Hermès, La Revue, vol. 69, n°2, p. 169-173.
Davis Tracy C, 1989, « The Spectacle of Absent Costume: Nudity on the Victorian Stage », New Theatre Quarterly. 5 (20), p. 321-333.
Duerr Hans Peter, 1998, Nudité et pudeur. Le mythe du processus de civilisation, trad. de l’allemand par Véronique Bodin ; avec la participation de J. Pincemin, Paris, Éd. de la Maison des sciences de l’homme.
Gaté Juliette, 2016, « Nudité » in Juliette Rennes (dir.), Encyclopédie critique du genre. Corps, sexualité, rapports sociaux, Paris, La Découverte, p. 409-417.
Gilligan Ian, 2019, Climate, clothing, and agriculture in prehistory : linking evidence, causes, and effects, Cambridge/New York, Cambridge University Press.
Guerchanoc Florence et Valérie Huet (dir.) 2008, S’habiller, se déshabiller dans les mondes anciens, dossier de la revue, Métis, 6.
Hanafi Nahema, 2012, « Pudeurs des souffrants et pudeurs médicales », Histoire, médecine et santé, no 1, p. 9-18.
Harp, Stephen L., 2014, Au Naturel : Naturism, Nudism, and Tourism in Twentieth-Century France, Baton Rouge, Louisiana State University Press.
Janin-Thivos Michèle, 2008, « Torture inquisitoriale et nudité : la pudeur en question », Rives nord-méditerranéennes, 30, p.65-76.
Lafont Anne, 2019, L’Art et la race. L’Africain (tout) contre l’œil des Lumières, Paris, Les presses du réel.
Centre universitaire d’études et de recherches médiévales, 2001, Le nu et le vêtu au Moyen âge : XIIe-XIIIe siècles, actes du 25e Colloque du CUERMA, 2-3-4 mars 2000, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence.
Lesbros Delphine, 2006, « Vice-Versa. Regard sur les figures couchées dans les couvercles des forzieri », Images Re-vues [En ligne], 3, document 3, mis en ligne le 01 septembre 2006.
Manin Lise, 2013, « Enquête sur les corps dénudés au XIXe siècle. Les insuffisances du scandale », Hypothèses 1 (16), p.179-190.
Manin Lise, 2015, « Outrages publics à la pudeur et outrages aux bonnes mœurs : la nudité en procès dans la France du second XIXe siècle », in Philippe Chassaigne (dir.), Puissance(s) publiques et censure(s) de l’époque moderne à nos jours, Peter Lang.
Marter Joan, 1996, « Joan Semmel’s Nudes: The Erotic Self and the Masquerade » Woman’s Art Journal, Vol. 16, No. 2 (Autumn, 1995 – Winter, 1996), p. 24-28.
Masquelier Adeline (dir.), 2005, Dirt, undress and differences : critical perspectives on body’s surface, Bloomington.
Mercier Élisabeth, 2016, « Sexualité et respectabilité des femmes : la SlutWalk et autres (re)configurations morales, éthiques et politiques », Nouvelles Questions Féministes, vol. 35, n°1, p. 16-31.
Miles Margaret R. 1989, Carnal Knowing: Female Nakedness and Religious Meaning in the Christian West, Boston, Mass. Beacon Press.
Mulvey Laura, 1975, « Visual pleasure and Narrative Cinema », Screen, Volume 16, n° 3, p. 6-18.
Perrault Sylvie, 2007, « Danseuse(s) noire(s) : analyse et permanence d’un stéréotype au music-hall », Corps, n° 3, p. 65-72.
Pollen Annebella, 2018, « Utopian Bodies and Anti-fashion Futures: The Dress Theories and Practices of English Interwar Nudists », Utopian Studies, n°28, p. 451-481.
Renaud Alexandre, Charles Guérin et Mathieu Jacotot (éd.), 2012, Rubor et Pudor : vivre et penser la honte dans la Rome ancienne, Paris, Éd. Rue d’Ulm.
Taraud Christelle, Mauresques. Femmes orientales dans la photographie coloniale (1860-1910), Paris, Albin Michel, 2003.
Tcherkezoff Serge, 2005, « La Polynésie des vahinés et la nature des femmes : une utopie occidentale masculine », Clio. Histoire‚ femmes et sociétés, n°22, 2005, p.63-82.
Vigarello Georges (dir.), Histoire du corps, tome 1: de la Renaissance aux Lumières, Paris, Seuil, 2011.
Virgili Fabrice, 2000, La France « virile ». Des femmes tondues à la Libération, Paris, Payot.




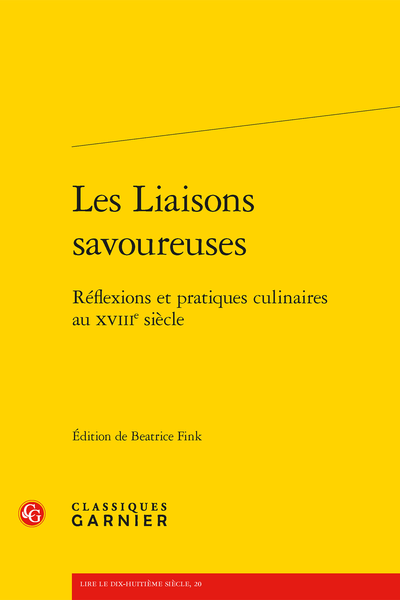 Béatrice Fink, Les Liaisons savoureuses. Réflexions et pratiques culinaires au XVIIIe siècle, Paris, Classiques Garnier, (1995) 2023.
Béatrice Fink, Les Liaisons savoureuses. Réflexions et pratiques culinaires au XVIIIe siècle, Paris, Classiques Garnier, (1995) 2023.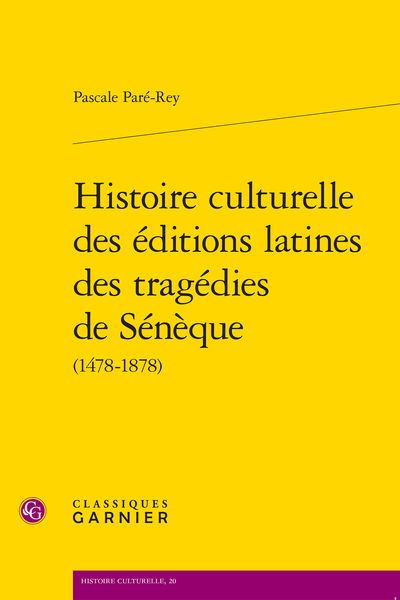 Pascale Paré-Rey, Histoire culturelle des éditions latines des tragédies de Sénèque (1478-1878), Paris, Classiques Garnier, 2023.
Pascale Paré-Rey, Histoire culturelle des éditions latines des tragédies de Sénèque (1478-1878), Paris, Classiques Garnier, 2023. Thierry Gontier, L'égoïsme vertueux. Montaigne et la formation de l'esprit libéral, Paris, Les Belles Lettres, 2023.
Thierry Gontier, L'égoïsme vertueux. Montaigne et la formation de l'esprit libéral, Paris, Les Belles Lettres, 2023.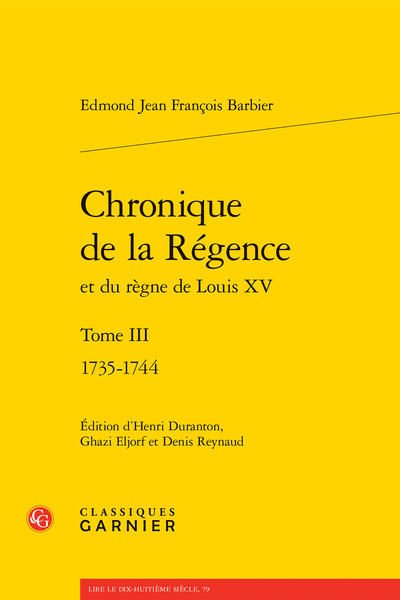 Edmond Jean François Barbier, Chronique de la Régence et du règne de Louis XV. Tome III 1735-1744, éd. Duranton (Henri), Eljorf (Ghazi), Reynaud (Denis), Paris, Classiques Garnier, 2023.
Edmond Jean François Barbier, Chronique de la Régence et du règne de Louis XV. Tome III 1735-1744, éd. Duranton (Henri), Eljorf (Ghazi), Reynaud (Denis), Paris, Classiques Garnier, 2023.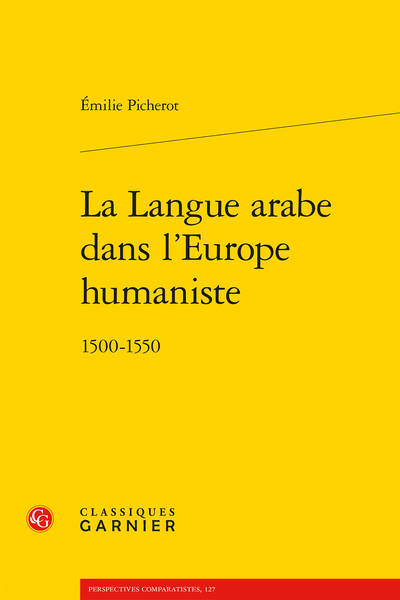 Emilie Picherot, La Langue arabe dans l'Europe humaniste 1500-1550, Paris, Classiques Garnier, 2023.
Emilie Picherot, La Langue arabe dans l'Europe humaniste 1500-1550, Paris, Classiques Garnier, 2023.