The Society for French Studies
Postgraduate Conference 2018
CALL FOR PAPERS
RÉPÉTITION/REPETITION
Friday 16 March 2018
IMLR, London
(Proposals: 5 January 2018)
Keynote Speaker: Prof Peter Dayan (University of Edimburgh)
English
Humans are mimetic animals. We learn how to speak, how to walk, how to read, how to remember even and to think of ourselves as part of a history, through repeating gestures we were taught, reproducing practices that were passed on to us. Without its repetitions, life would be indecipherable, illegible. Repetition’s creative possibilities are particularly striking when one turns to the arts: in music and poetry, repetition is used as a composition principle (canon, song…) and a vehicle for expressivity (pathos). Additionally, repetition can be read as an ethical principle whereby we imitate models, as Classical authors were once to be imitated; through this mimetic behaviour, one can hope to achieve moral excellence.
But repetition is ambiguous; if we learn and eventually become autonomous beings through processes of repetition, don’t we also mimic out of conformism, and thus sometimes despite what we know to be right, as the most distressing dystopias have shown? Repetition can even infringe on what is deemed pathological behaviour (as with palilalia, paliphrasia, iteration), and one would go through a lot of trouble to draw a clear line between this “deviant” mode of repetition and its poetical counterpart. Turning to parodies, to mimes, to words spoken by burlesque characters (Molière’s for instance) or by non-human ones (Loulou in “Un cœur simple”), repetition appears as a comic device and an instrument of satire. But mechanical repetition is not always funny; on the production lines, workers reiterate the same meaningless gesture again and again, and alienate themselves: repetition now symbolises the condition of the modern worker. At last, repetition can take a tragic turn: whether it be at the level of the individual with Freud, or at the level of the collective with Hegel and Marx, history can be read as the repetition of the same, repetition that subjects are bent on preventing, often to no avail (preventing history from repeating itself: a too well-known trope of the second part of the 20th century).
What are the functions of repetition in literature from the Middle Ages onward? What role does it play in performance arts, wherein it signifies both a rehearsal, and the principle at the very basis of theatre, i.e. saying again a text that has already been said a thousand times (Corneille or Racine today), telling again a story that has already been told a thousand times (Antigone, the Trojan war…)? What do we make of phrases designed to be repeated (formules) that we can find in genres as diverse as the chanson de geste, philosophical discourse, the tale, the letter…? When we repeat something, do we produce something identical to the original, or rather, as Borges hinted in “Pierre Ménard”, are we only dealing with singular objects impossible to reproduce? Taking up Deleuze’s repetition(Différence et répétition), or Derrida’s iteration (“Signature Événement Contexte”), we could explore and question the poststructuralist philosophical reformulations of the notion of “repetition”, and its further theorisations in more recent research (in gender studies for instance).
The Society for French Studies invites proposals on all aspects of repetition from all the fields of French and Francophone Studies. Contributions from all periods and disciplines are welcome, including literature, poetry, history, philosophy, rhetoric, performance, translation, queer, gender and cultural studies.
Suggested topics include, but are not limited to:
· Parody and pastiche
· Tropes of repetition
· (In)Authenticity
· Originality
· Humour
· Teaching/didactics/pedagogy
· Religion
· Animals
· Mimetism
· Mimesis
Please send abstracts (250-300 words) for twenty-minute papers, either in French or in English, along with the name of your institution, the title of your PhD and your year of study to sfsrepetition2018@gmail.com no later than Friday 5 January 2018.
Organisers: Thomas Liano and Charlotte Thevenet
Français
L’être humain est un animal mimétique. Pour apprendre à parler, à marcher, à lire, pour se souvenir et s’inscrire dans une histoire, on répète et on reproduit les gestes, les pratiques qui nous ont été enseignées et transmises. Sans ses redites, la vie serait indéchiffrable tant elles s’inscrivent au cœur de ce qui fait l’humain. Principe créatif, la répétition l’est particulièrement quand on se tourne vers les arts : en musique comme en poésie, la répétition est un principe de composition (canon, chanson…) et un vecteur d’expressivité (pathos). En outre, on peut lire dans la répétition un principe éthique, celui de l’imitation des modèles, lié à l’imitation des Anciens en littérature, et qui permet à celui qui s’y soumet de prétendre à l’excellence morale.
Mais la répétition ne va pas sans ambiguïté ; si l’on répète pour apprendre et devenir autonome, ne répète-t-on pas aussi par conformisme, et ce parfois au détriment de ce que l’on sait juste, comme le montrent les plus glaçantes dystopies ? La répétition peut alors même friser le pathologique (palilalie, paliphrasie, itération), et l’on serait bien en peine de déterminer une frontière étanche entre ce mode de répétition et la répétition poétique. Dans la parodie, le mime, dans la bouche de personnages burlesques (chez Molière par exemple) ou non humains (le perroquet Loulou dans « Un cœur simple »), la répétition se fait comique et instrument de la satire. Mais la répétition mécanique parfois ne fait pas rire ; sur les chaînes de production, le travailleur s’aliène à répéter cent fois, mille fois, les mêmes gestes dépourvus de sens, et la répétition devient symbole de la condition du travailleur moderne. La répétition, enfin, peut prendre un tour tragique : que ce soit au niveau individuel avec Freud, ou au niveau collectif avec Hegel et Marx, l’histoire peut être conçue comme la répétition du même, que les sujets cherchent à tout prix, mais souvent en vain, à éviter (éviter que l’histoire ne se répète : trope bien connu de la deuxième partie du XXème siècle).
Quelles fonctions tient la répétition dans la littérature du Moyen-Age à nos jours ? Quel rôle joue-t-elle dans les arts du spectacle, où elle désigne à la fois la préparation en vue d’une représentation (rehearsal), et le principe même de l’adaptation qui consiste à répéter un texte dit des milliers de fois (Corneille ou Racine aujourd’hui), à répéter un motif exploité et mis en scène depuis la nuit des temps (Antigone, la guerre de Troie…) ? Comment comprendre l’usage de la formule dans des formes littéraires aussi diverses que la chanson de geste, le discours philosophique, le conte, la lettre… ? Répète-t-on toujours à l’identique, ou comme le suggère Borges dans « Pierre Ménard », n’y a-t-il que des objets singuliers impossibles à reproduire ? En mobilisant la « répétition » chez Deleuze (Différence et répétition), ou l’« itération » chez Derrida (« Signature Evénement Contexte »), on pourra s’interroger sur les réélaborations philosophiques auxquelles la notion de répétition a donné lieu dans le post-structuralisme français, et au-delà dans les fonctions nouvelles que lui ont conféré, par exemple, les gender studies.
La Society for French Studies invite les participant.es à envisager les aspects les plus divers de la notion de répétition et ce à travers tous les domaines des French and Francophone Studies, toute époque et discipline confondues, y compris la littérature, l’histoire, le théâtre, la poésie, la philosophie, la rhétorique, les translation, queer, gender, et cultural studies.
Les thèmes envisagés incluent :
· Parodie et pastiche
· Tropes de la répétition
· (In)Authenticité
· Originalité
· Humour
· Enseignement/didactique/pédagogie
· La religion
· L’animal
· Mimétisme
· Mimèsis
Les propositions de communication de 20 minutes (250-300 mots), en français ou en anglais, accompagnées du nom de votre institution, du titre de votre thèse et de votre année de doctorat, sont à envoyer à sfsrepetition2018@gmail.com avant le 5 janvier 2018.
Organisateur.ices : Thomas Liano et Charlotte Thevenet




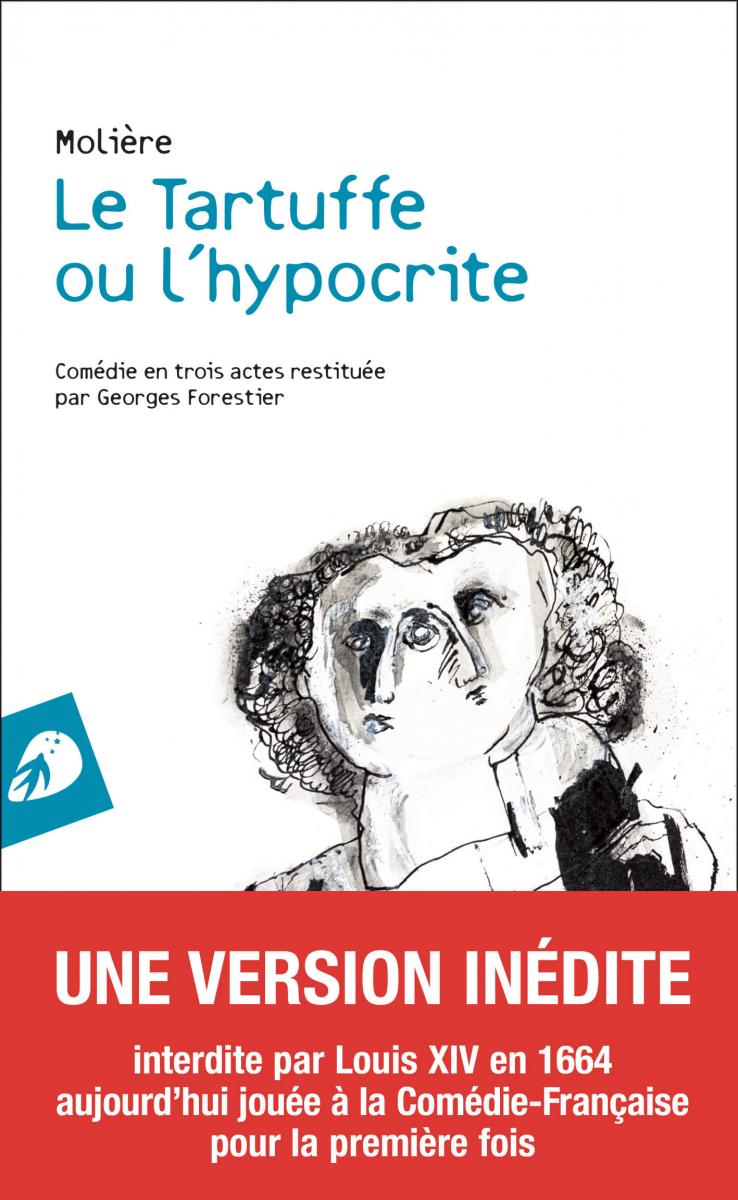 Molière, Le Tartuffe ou l'Hypocrite, Comédie en trois actes restituée par Georges Forestier
Molière, Le Tartuffe ou l'Hypocrite, Comédie en trois actes restituée par Georges Forestier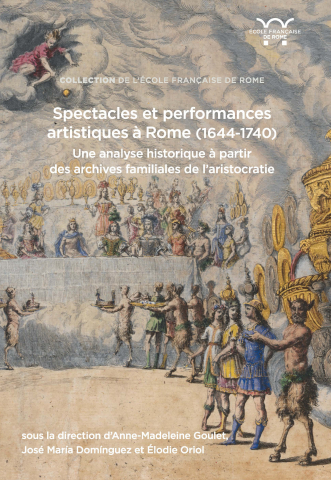 Spectacles et performances artistiques à Rome (1644-1740). Une analyse historique à partir des archives familiales de l’aristocratie, dir. Anne-Madeleine Goulet, José María Domínguez et Élodie Oriol, Rome, Publications de l’École française de Rome, 2021.
Spectacles et performances artistiques à Rome (1644-1740). Une analyse historique à partir des archives familiales de l’aristocratie, dir. Anne-Madeleine Goulet, José María Domínguez et Élodie Oriol, Rome, Publications de l’École française de Rome, 2021.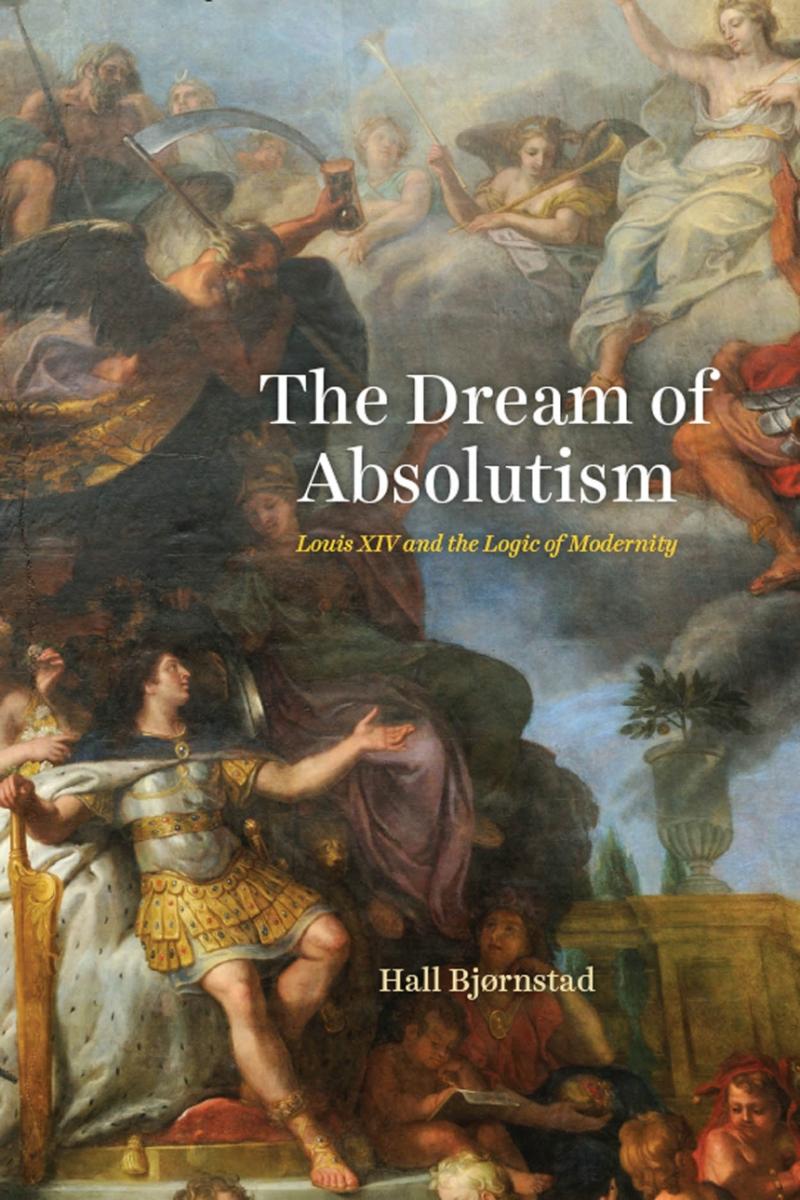 Hall Bjørnstad, The Dream of Absolutism: Louis XIV and the Logic of Modernity (University of Chicago Press, October 2021).
Hall Bjørnstad, The Dream of Absolutism: Louis XIV and the Logic of Modernity (University of Chicago Press, October 2021). 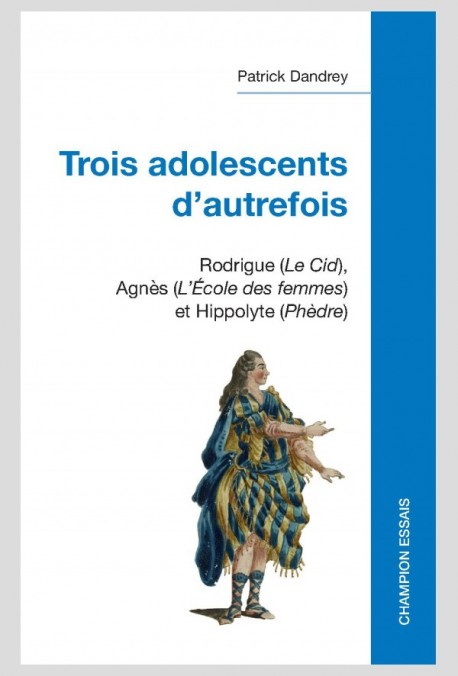 Patrick Dandrey, Trois adolescents d'autrefois, Rodrigue, Agnès et Hippolyte, Paris, Honoré Chamption, "Champion essais", 2021.
Patrick Dandrey, Trois adolescents d'autrefois, Rodrigue, Agnès et Hippolyte, Paris, Honoré Chamption, "Champion essais", 2021.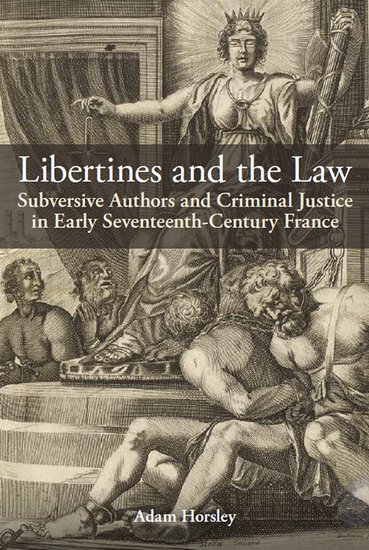 Adam Horsley, Libertines and the Law: Subversive Authors and Criminal Justice in Early Seventeenth-Century France (Oxford: Oxford University Press / British Academy Postdoctoral Fellowship Monographs, 2021), 432 pp.
Adam Horsley, Libertines and the Law: Subversive Authors and Criminal Justice in Early Seventeenth-Century France (Oxford: Oxford University Press / British Academy Postdoctoral Fellowship Monographs, 2021), 432 pp.