Université du Québec à Montréal, 18-19 octobre 2018
Propositions: 15 février 2018
Force, courage, sens de l’honneur, goût de la conquête, de la gloire, sens du sacrifice, patriotisme, valeur de la belle mort (au combat et héroïquement), contrôle de soi, puissance sexuelle, etc. Il en faut beaucoup pour être un homme, un « vrai ». Ou plutôt, il en faut beaucoup pour être un homme viril.
Bâtie à coup de stéréotypes, la virilité semble bien une construction sociale toujours historiquement située et utilisée pour théoriser la supériorité du masculin sur le féminin. Mais pour la philosophe Olivia Gazalé, les femmes ne sont pas les seules victimes de ce mythe de la virilité. Les oppresseurs seraient eux aussi oppressés par leur propre outil de domination [Gazalé, 2017]. Les hommes, constamment contraints de faire la preuve de leur masculinité, tentent de répondre tant bien que mal aux injonctions qu’imposent les stéréotypes de la virilité. Réduits à un nombre limité de caractères et de valeurs supposés les consacrer en tant qu’hommes, ils sont amputés d’une grande partie de leur vie psychique, sociale et familiale. Les masculinités gagneraient ainsi à s’emparer, comme les féministes l’ont fait et continuent de le faire, du profond travail de déconstruction des lieux communs et stéréotypes aliénants.
Pour Françoise Héritier, « l’âge d’homme, c’est le trou noir et le référent ultime » [Héritier, 1996:303]. Notre société peine à voir et à penser les normes de la masculinité, ce qui en fait un terrain fertile pour la reproduction des rapports de genre et de pouvoir. Néanmoins, ces dernières années sont marquées par l’émergence de réflexions sur les hommes. La recherche universitaire s’empare enfin de la question et remet en cause le supposé état de crise de la virilité.
L’anthropologue Mélanie Gourarier émet l’hypothèse que l’état de crise serait constitutif de la virilité et ne serait, non pas la marque de son affaiblissement, mais l’outil de son affermissement : « la rhétorique de la crise de la masculinité […] [devrait être] ainsi appréhendée comme une ressource discursive potentiellement mobilisable, d’ailleurs historiquement mobilisée, afin de reproduire un ordre social qui, passant pour menacé, se transforme, s’ajuste et se normalise » [Gourarier, 2017:11]. Alors, comment devenir homme quand les repères et les modèles donnés sont constamment perçus comme étant en danger ?
Le mythe de la virilité et son état de crise permanent nous apparaissent ainsi, plus que jamais, une question qu'il convient de poser à la littérature puisque celle-ci se révèle être un terrain propice à leur déconstruction. Les romans font partie des rares lieux où il est possible de révéler cette imposture en mettant fin à l’idée d’une prétendue transparence et essentialité de la virilité. Ils appuient sur les zones d’ombre qui entourent ce mythe en mettant en scène, non pas une virilité triomphante, mais une virilité du désarroi.
À partir d'angles critiques divers (ethnocritique, sociocritique, psychanalytique, historique, philosophique, etc.), ce colloque voudrait interroger la place de la littérature dans ce travail de déconstruction. Comment se façonne l’identité individuelle et sociale du jeune homme face aux injonctions à la virilité dans les textes ? Comment les œuvres littéraires éprouvent le modèle pour exposer l'imposture qu’est la virilité ? La littérature peut-elle être un lieu de reconfiguration de la masculinité face aux changements sociétaux ?
Ce colloque voudrait proposer plusieurs axes de réflexion:
La figure du guerrier : force, courage et sacrifice
Pendant longtemps, la virilité a été assignée à diverses formes de sacrifices : sacrifice de soi pour la patrie, de son enfance, de ses émotions, de sa féminité, etc. L’exigence de rationalité ou l’impératif politique de la virilité ont souvent pris la forme d’un sectionnement de soi. L’idéal militaire et ses valeurs sont aussi accompagnés d’une grande part d’abnégation. Aujourd’hui, alors que le service militaire a été abandonné, l’esprit guerrier s’actualise et prend des formes nouvelles. Comment certains jeunes hommes vont-ils construire leur identité virile en introduisant des valeurs guerrières dans de nouveaux lieux ? Dans quelle mesure les personnages littéraires expriment-ils ce morcellement et cette perte d’une part de l’identité ? Comment luttent-ils pour conserver leur intégrité ?
Paternité : quand les hommes engendrent des hommes
Le rôle du père dans la construction des jeunes hommes est présenté comme essentiel. Mais il est curieux de constater qu’une grande partie des discours produits sur la figure paternelle ne chante pas ses mérites mais en pleure plutôt l’absence ou la défaillance : pères faibles, mous, écrasés par les mères, absents, morts, divorcés, abusifs, etc. Or, cette chute de la figure paternelle reste une problématique de la construction masculine. Le jeune garçon semble avoir besoin d’un homme pour en devenir lui-même un. Alors seuls les hommes peuvent-ils engendrer des hommes?
Sexualité : puissance et impuissance
Les hommes ont fait reposer leur virilité sur leur sexe : la puissance du phallus, cet organe « en plus », serait le symbole de leur supériorité. Mais il est aussi la cause de leurs malheurs puisqu’il est un membre faillible. Les hommes sont ainsi hantés par l’angoisse de l’impuissance et remettent en question leur masculinité quand leur corps n’est plus sous leur contrôle. La sexualité est le haut lieu des injonctions à la virilité : puissance phallique mais aussi génésique, désir sexuel constant, capacité à donner du plaisir, etc. La sexualité est également un outil de domination qui fait appel aux valeurs belliqueuses. Dès lors, comment construire son identité en dehors de ces schémas ? Comment les personnages réinvestissent ou renoncent-ils à une certaine sexualité et quelles conséquences sur l’identité?
La maison des hommes : construction, reproduction et hiérarchisation
« Quand on est entre nous, on n’a pas à se gêner ». L’existence de lieux de l’entre-soi masculin est attestée dans de nombreuses sociétés par les historiens : clubs, cafés, chambres parlementaires, etc. Si les femmes sont parvenues à infiltrer tant bien que mal ces haut lieux de la virilité, ces derniers parviennent à se redessiner ailleurs. Cet entre-soi masculin permettrait de produire et reproduire la virilité entre les pairs tout en fabriquant de la hiérarchie entre eux : c’est aux yeux du même que l’on est validé comme « vrai » homme. L’apprentissage de la virilité se fait ainsi entre hommes, à travers des processus initiatiques : bizutage, performances physiques, « faire ses preuves », etc. Comment la communauté influe-t-elle sur la construction des jeunes hommes? Peut-on se construire contre les pairs et à quel prix?
MODALITÉS DE SOUMISSION
Cet appel à communications s’adresse en particulier aux chercheurs travaillant en littérature d’hier à aujourd’hui, mais reste ouvert à d’autres approches disciplinaires (anthropologie, psychanalyse, histoire, histoire de l’art, philosophie, sociologie, études cinématographiques, etc.).
Les propositions de communication, en français, d’une page maximum, accompagnées d’une notice biobibliographique (mentionnant affiliation institutionnelle, axes de recherche et publications majeures), doivent parvenir avant le 15 février 2018 par courriel à l’adresse suivante : imposturevirile@gmail.com
Une publication des actes du colloque est prévue.
COMITÉ D’ORGANISATION
Véronique CNOCKAERT (Université du Québec à Montréal)
Émilie BAUDUIN (Université du Québec à Montréal)
Marion CAUDEBEC (Université du Québec à Montréal, Université Toulouse Jean Jaurès)
Jordan DIAZ-BROSSEAU (Université du Québec à Montréal)
*
BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE
CITTON Yves, Impuissances : défaillances masculines et pouvoir politique de Montaigne à Stendhal, Paris, Aubier, 1994.
CORBIN Alain, COURTINE Jean-Jacques et VIGARELLO Georges, Histoire de la virilité, Paris, Seuil, « l’Univers historique », 2011, 3 tomes.
COURTINE Jean-Jacques, « La virilité est-elle en crise ? Entretien avec Jean-Jacques Courtine », Études, 2012/2, tome 416, p.175-185.
GAZALÉ Olivia, Le Mythe de la virilité. Un piège pour les deux sexes, Paris, Robert Laffont, 2017.
GOURARIER Mélanie, Alpha mâle. Séduire les femmes pour s’apprécier entre hommes, Paris, Seuil, « La couleur des idées », 2017.
HÉRITIER Françoise, Masculin/Féminin. La pensée de la différence, Éditions Odile Jacob, 1996.
LORAUX Nicole, La Cité divisée. L'oubli dans la mémoire d'Athènes, Paris, Payot, 1997.
MEIZOZ, Jérôme, Faire le garçon, Carouges (Suisse), Zoé, 2017.
MOSSE George L., The Image of Man, The Creation of Modernity Masculinity, Oxford University Press, New York-Oxford, 1996.
RAUCH André, Le Premier Sexe. Mutations et crise de l'identité masculine, Paris, Hachette, 2000.
SOHN Anne-Marie, « Sois un homme ». La construction de la masculinité au XIXe siècle, Paris, Seuil, 2009.




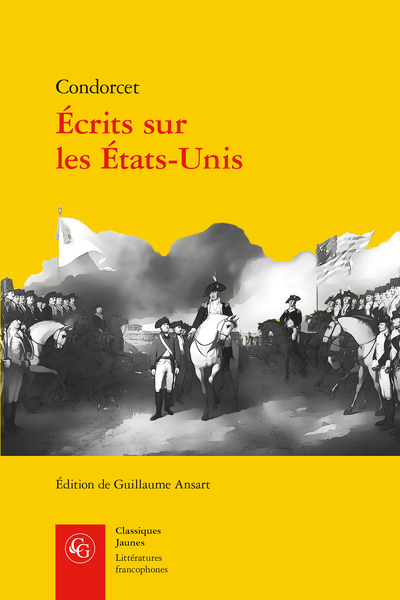 Condorcet, Écrits sur les États-Unis, éd. Guillaume Ansart, Paris, Classiques Garnier, (2012) 2021.
Condorcet, Écrits sur les États-Unis, éd. Guillaume Ansart, Paris, Classiques Garnier, (2012) 2021.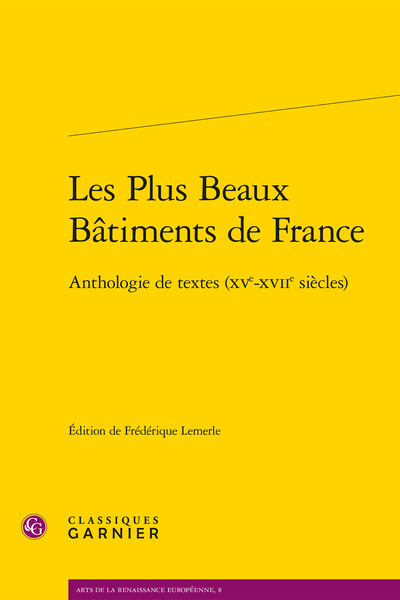 Les Plus Beaux Bâtiments de France. Anthologie de textes (xve-xviie siècles), éd. Frédérique Lemercle, Paris, Classiques Garnier, 2021.
Les Plus Beaux Bâtiments de France. Anthologie de textes (xve-xviie siècles), éd. Frédérique Lemercle, Paris, Classiques Garnier, 2021.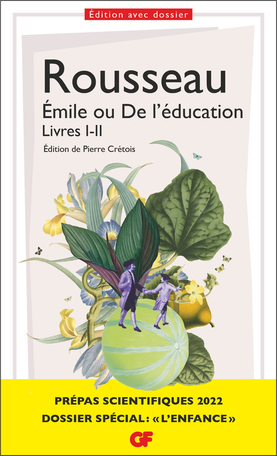 Jean-Jacques Rousseau, Émile ou De l’éducation, Livres I-II. Prépa scientifiques, éd. Pierre Crétois, Paris, GF, 2021.
Jean-Jacques Rousseau, Émile ou De l’éducation, Livres I-II. Prépa scientifiques, éd. Pierre Crétois, Paris, GF, 2021.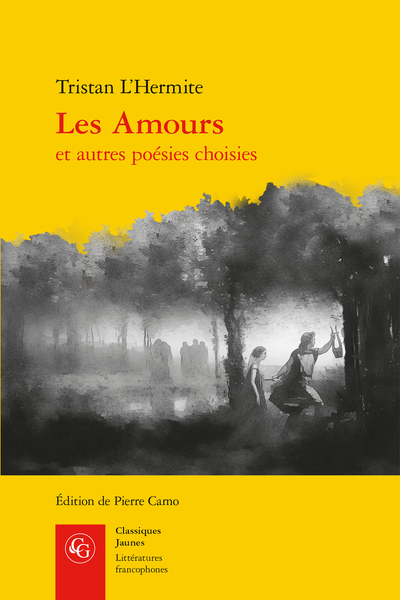 Tristan L'Hermite, Les Amours et autres poésies choisies, éd. Pierre Carno, Paris, Classiques Garnier, 2021.
Tristan L'Hermite, Les Amours et autres poésies choisies, éd. Pierre Carno, Paris, Classiques Garnier, 2021.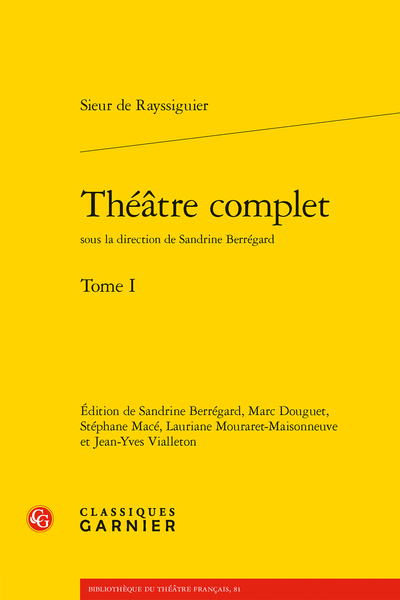 Sieur de Rayssiguier, Théâtre complet. Tome I, éd. dir. par Sandrine Berrégard, avec Marc Douguet, Stéphane Macé, Lauriane Mouraret-Maisonneuve, Jean-Yves Vialleton, Paris, Classiques Garnier, 2021.
Sieur de Rayssiguier, Théâtre complet. Tome I, éd. dir. par Sandrine Berrégard, avec Marc Douguet, Stéphane Macé, Lauriane Mouraret-Maisonneuve, Jean-Yves Vialleton, Paris, Classiques Garnier, 2021.