Colloque international
organisé par
le Centre Interdisciplinaire des Littératures d’Aix Marseille
(CIELAM, Aix Marseille Université)
les 13-15 juin 2019
à la Maison de la Recherche, Campus Schuman, Aix en Provence
Délai de l’appel : 30 juin 218
Humanismes, anti-humanismes et littérature (XIV-XXIe siècles)
Si l’adjectif « humaniste » est attesté dès la fin du XVIe siècle, le mot « humanisme » est une invention des Lumières, que s’approprie d’abord la philosophie politique du milieu du XIXe siècle (Proudhon), avant qu’il devienne une catégorie de l’histoire littéraire. Pour autant, c’est bien la Renaissance qui a inventé l’humanisme comme projet d’humanité fondé sur la philologie et l’éloquence, s’appuyant sur l’héritage médiéval même qu’il nie. L’humain n’est pas nature, mais culture : « Les hommes ne naissent pas hommes, ils le deviennent » (Érasme). Cette faculté de se transformer fait leur dignité pour Pic de La Mirandole. Elle requiert la maîtrise des langues anciennes, la méditation des textes, art du probable qui veut convaincre, plaire et émouvoir. Sans doute l’objectif de former un homme plutôt qu’un spécialiste s’inscrit-il dans une longue lignée médiévale : mais il se politise davantage, rompant avec l’Université et avec le savoir officiel. Le champ apparemment étroit de la philologie et de la rhétorique devient à la Renaissance essentiel pour la formation de l’individu, pour son épanouissement dans la relation à autrui, pour la vie politique et religieuse, l’établissement et l’intelligence des textes de droit, de l’Écriture sainte, ou relevant de telles ou telles grandes traditions littéraires ou philosophiques. Les Lettres sont à la fois savoir, divertissement, perfectionnement de l’individu, instrument de la vie politique et de l’approche authentique des textes fondateurs. Elles inspirent des formes de vie sociale : la conversation, les correspondances, les académies. Un nouveau média, le livre, leur confère une nouvelle audience, une possibilité d’échanges et de débats hors institution, une république des Lettres sans frontières : une première invention de l’Europe ?
Les Lettres, la philologie, les arts du discours et la fréquentation des écrivains portent une culture de l’esprit et une éthique. Ramus loue Agricola d’avoir « fait en sorte que les jeunes gens apprennent des poètes et des orateurs non seulement à parler une langue pure et à discourir avec élégance, mais aussi à penser avec acuité et à juger avec sagesse ». C’est dans cette continuité que Port Royal puis les Lumières construisent la Grammaire comme système rationnel, identifiant logique de la langue et clarté de l’esprit. Parallèlement, la redécouverte des historiens latins par les humanistes de la Renaissance, qui les éditent, sert de support à une réflexion sur l’histoire et sur les mœurs (Montesquieu, Voltaire) qui jette les bases de la mythologie révolutionnaire puis républicaine à laquelle, dès Napoléon, l’éducation publique vient s’adosser, créditant l’enseignement des Lettres de valeurs morales et citoyennes.
Le XIXe et le XXe siècle voient se développer des savoirs et des représentations des mondes non-européens et des lisières de l’Europe qui, de la philologie à l’ethnologie, se réclament d’une nouvelle renaissance (Quinet) ou d’un nouvel humanisme (Lévi-Strauss). Dans le même temps, le nazisme, les totalitarismes, l’extermination des Juifs placent l’Europe face à une remise en question radicale de ses valeurs, avec deux conséquences :
— d’un côté l’interrogation de l’humanisme et de sa filiation avec les Lumières suscite le débat autour de Heidegger et l’hésitation des communistes entre anti-humanisme et humanisme (Althusser).
— de l’autre, les luttes de décolonisations remettent en question les prétentions à l’universalisme de l’humanisme européen (Césaire). Les peuples aspirant à une reconnaissance politique ont eux-mêmes enclenché des processus de « renaissance » linguistique, littéraire, culturelle, pour lesquels la philologie et l’ethnologie ont pu servir de modèle ou de contre-modèle.
Le XXe siècle est celui de la querelle de l’humanisme, qui se déclinera en diverses modulations du préfixe « anti-», « post-» , « trans-» , « hyper-». Dans ces mouvements historiques enchevêtrés, les significations de l’humanisme et de l’anti-humanisme n’ont cessé de se déplacer, impliquant savoirs, représentations et relations de pouvoir. Aujourd’hui, on peut se demander si la littérature mondiale, pour laquelle Erich Auerbach en appelait, en 1952, au développement d’une nouvelle philologie, est une manière de renouveler le projet d’une critique humaniste (E. Said) ou bien si les fondements mêmes du projet humaniste, avec son effort éducatif par relecture de l’héritage culturel et par mise en avant des pouvoirs du langage, sont condamnés par l’explosion de la culture sous l’effet globalisé de nouveaux médias, de nouvelles mobilités et de nouveaux périls.
Ce sont ces débats éthiques et politiques, ces défenses et critiques des Lettres que le colloque explorera. Il ne s’attachera pas à écrire une histoire des humanismes. Il examinera plutôt, à différentes époques, du XIVe siècle à aujourd’hui, comment ceux-ci, dans leurs différentes formulations, se sont voulus littéraires, comment « toute position vraiment humaniste se situe sur le plan poétique » (Eugenio Garin). Et c’est donc bien sur le rapport entre une philosophie et une politique de l’humain et une définition ou une pratique du littéraire qu’il faudra réfléchir. Aujourd’hui encore, qu’il s’agisse du care ou d’un perspectivisme qui permettrait d’adopter le point de vue de la victime ou d’une minorité (Nussbaum), d’écopoétique ou plus banalement de critique sociale et de point de vue compassionnel, le lien des arts du langage, de la morale, de la politique et de la pédagogie ne s’est pas défait. Il est constitutif, tout particulièrement, de ce régime de discours que nous appelons littérature.
On examinera
- les définitions, légitimations et frontières de l’humanisme. Quelle humanité pour l’humanisme ? A quoi s’oppose-t-il ? À l’ignorance, à la barbarie, à la sauvagerie, à la pulsion, au libéralisme ? De quoi se distingue-t-il ? Du religieux, de la communication (l’écriture contre la langue, l’œuvre contre le réseau…) ? Comment l’héritage humaniste et l’héritage des Lumières s’articulent-ils pour nous aujourd’hui ?
- le rapport entre tradition et modernité. L’humanisme de la Renaissance a constitué les Anciens en modèles indépassables qu’il fallait imiter. De là cette culture patrimoniale des textes fondateurs. À côté de ce conservatisme, la relecture du Moyen Âge aux XVIe et XVIIe siècles a pu susciter d’autres inspirations, alimenter d’autres réflexions. Aux côtés du modèle bien balisé et étudié de la renovatio, ont coexisté d’autres modèles, d’autres modalités d’émergence d’un humanisme moderne indissociable d’historicités et de traditions multiples.
- Les anti-humanismes, qu’ils procèdent d’une critique religieuse, philosophique ou politique (Pascal, Dostoïevski, Céline, Houellebecq). Dès le XVIe siècle, l’humanisme s’est trouvé des miroirs critiques (Éloge de la folie, diatribe cynique…). Au XVIIe siècle, les auteurs réunis par Brémond sous l’étiquette controversée d’ « humanisme dévot » (François de Sales, Jean-Pierre Camus, Desmarets de Saint-Sorlin) interrogent « l’inanité » et la « dénéantise de l’homme » (Essais, II, 12), et la controverse janséniste pose la question de l’opposition entre (anti)humanisme et (anti)mysticisme. Aux XIXe et XXe siècles, la volonté de puissance, « la mort de l’homme » (Foucault), la vie nue (Agamben), l’« humanisme de l’autre homme » (Levinas), fondé non sur le sujet mais sur sa faille qui l’expose et le voue à autrui ont apporté d’autres contestations, et Lévi-Strauss a vu dans une définition distinctive de l’humain la source d’une discrimination destructrice.
- L’écopoétique. L’humanisme européen est né avec le Livre. L’idéal d’une civilisation lettrée a configuré en profondeur les temps modernes : c’est en lisant que l’on devient homme. Cette conjonction native entre humanisme et culture des lettres, associée à l'essor des techniques et à la maîtrise croissante du milieu, a coupé l’homme de ses échanges multiples avec les êtres et les lieux. Un des enjeux des lettres contemporaines est peut-être de rouvrir ce dialogue qu’elles-mêmes ont contribué à interrompre et d'inventer un jeu d’humanités élargies, d'une « literrature » où l'humain retrouve son humus.
- L’espace de l’humanisme : la cité, la nation, le monde ? Un espace phantasmatique qui procède de l’humanisme lui-même créant sa propre géographie intellectuelle ? Une élite soigneusement distinguée du populaire, qu’il s’agisse des lettrés classiques partageant un même goût raffiné, ou des avant-gardismes révolutionnaires affranchis de la société de consommation ? L’humanisme introduit d’autre part une géopolitique de l’esprit : il s’agit de penser l’homme avec le sauvage, voire le cannibale (Montaigne, Diderot), de penser l’exercice de la pensée avectoutes les pratiques du corps et de l’esprit. Dans quelle mesure cette géopolitique humaniste est-elle constitutive de ce que nous nommons aujourd’hui, rétrospectivement, littérature ?
COMITE D’ORGANISATION (AMU)
Sylvie REQUEMORA (dir.), Geneviève GOUBIER, Huguette KRIEF, Lou-Andréa PIANA.
COMITE SCIENTIFIQUE DU COLLOQUE
Claire BAREL-MOISAN (CNRS, ENS Lyon), Emmanuel BURY (Université Paris Sorbonne), Jean-Christophe CAVALLIN (AMU), Estelle DOUDET (Université Grenoble Alpes), Jean-Raymond FANLO (AMU), Annick JAUER (AMU), Jan MIERNOWSKI (University of Wisconsin-Madison), Yolaine PARISOT (Université Paris-Est-Créteil).
Les propositions de communication (entre 500 et 1000 signes), accompagnées d’une courte biobibliographie (situation institutionnelle, laboratoire, champs de recherche et publications), devront être envoyées avant le 30 juin 2018 à l’adresse suivante :
colloquehumanismes@gmx.fr
Les langues du colloque seront le français et l’anglais et seront privilégiées les études qui déborderont le cadre français pour interroger les notions selon un spectre plus largement européen, voire international.




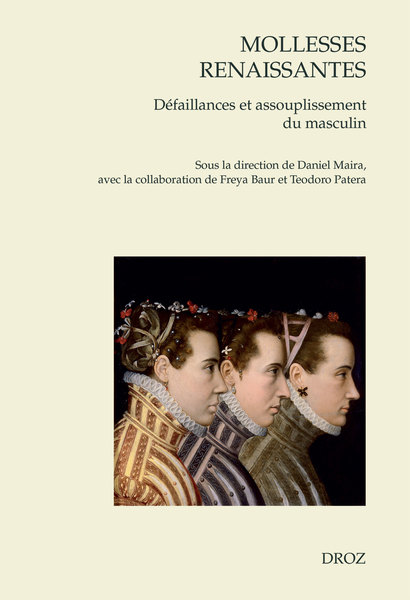 Mollesses renaissantes. Défaillances et assouplissement du masculin. Sous la direction scientifique de Daniel MAIRA . Édité par Freya BAUR, Teodoro PATERA, Droz, 2021, 456 p. 49 €.
Mollesses renaissantes. Défaillances et assouplissement du masculin. Sous la direction scientifique de Daniel MAIRA . Édité par Freya BAUR, Teodoro PATERA, Droz, 2021, 456 p. 49 €.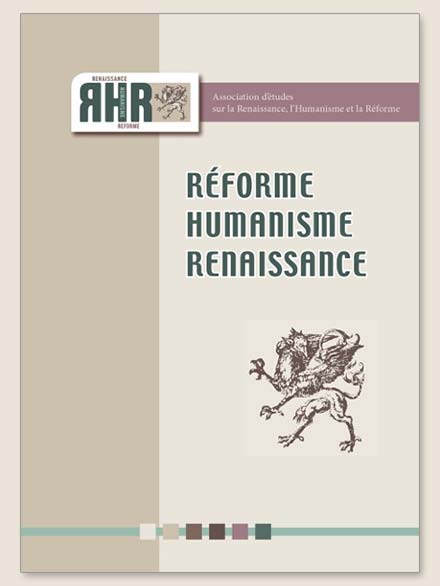 Réforme, Humanisme, Renaissance (RHR), n° 92, 2021/1
Réforme, Humanisme, Renaissance (RHR), n° 92, 2021/1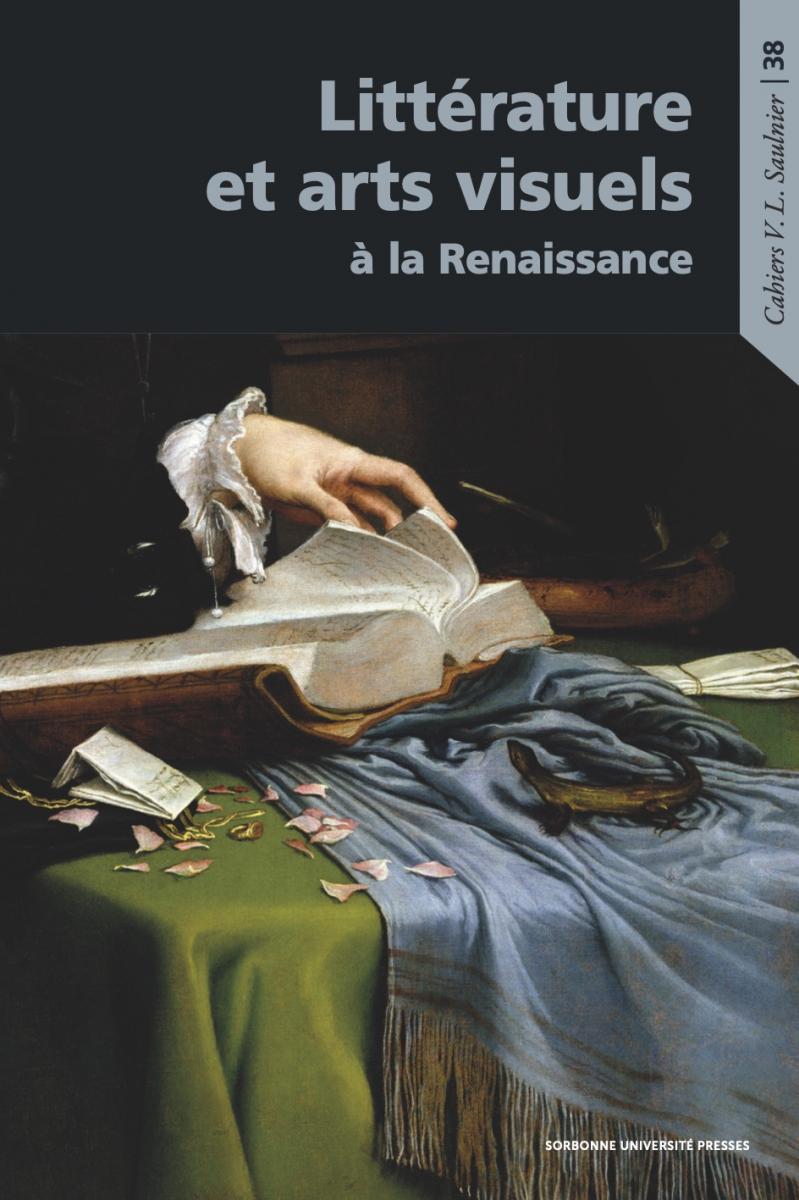 LITTÉRATURE ET ARTS VISUELS À LA RENAISSANCE, sous la direction de Luisa Capodieci, Paul-Victor Desarbres, Adeline Desbois-Ientile et Adeline Lionetto, Paris, SUP, 2021.
LITTÉRATURE ET ARTS VISUELS À LA RENAISSANCE, sous la direction de Luisa Capodieci, Paul-Victor Desarbres, Adeline Desbois-Ientile et Adeline Lionetto, Paris, SUP, 2021.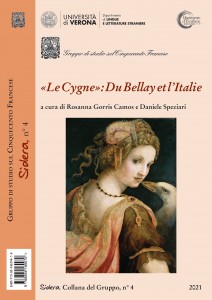 Sidera n. 4: “Le Cygne”. Du Bellay et l’Italie, dir. Rosanna Goris Camos et Daniele Speziari.
Sidera n. 4: “Le Cygne”. Du Bellay et l’Italie, dir. Rosanna Goris Camos et Daniele Speziari.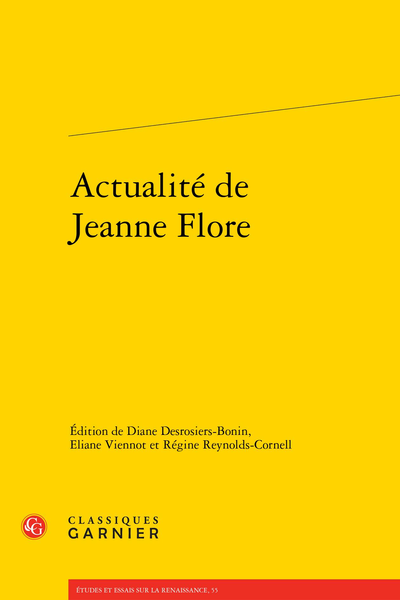 Actualité de Jeanne Flore, dir. Diane Desrosiers-Bonin, Éliane Viennot et Régine Reynolds-Cornell, Paris, Classiques Garnier, [2004] 2022.
Actualité de Jeanne Flore, dir. Diane Desrosiers-Bonin, Éliane Viennot et Régine Reynolds-Cornell, Paris, Classiques Garnier, [2004] 2022.