Announce
Calls for Papers and Contributions
Renaissance Society of America Annual Meeting
Toronto, 17-19 March 2019
“Do you really believe … that everything historians tell us about men – or about women – is actually true? You ought to consider the fact that these histories have been written by men, who never tell the truth except by accident.” – The Worth of Women (1600)
Writing about women in the late medieval and early modern period focused on ideals of female behaviour. In the 16th and 17th centuries the discussion became a public debate over not just how women should act, but also whether or not they were even capable of the prescribed behaviours: what was the nature of woman? The “controversy” reached its height in the sixteenth century, with attacks and defences flying off the printing presses.
Not content to leave their defence to men, writers such as Moderata Fonte (quoted above) produced works that provided a counterpoint to traditional narratives that cast women as incapable and morally weak. From Christine de Pizan’s La cite des dames (1405) to Archangela Tarabotti’s Tirannia Paterna(1654), women have sought to directly confront misogynist views on the purported nature of women and their appropriate roles and behaviours in society.
This panel invites submissions on women who consciously and directly challenged the male- dominated discourse by interjecting their own voices into it. How did these women attempt to change or alter the debate? What argumentative tools/mediums did they choose? What were their expectations of the intervention? Who was the audience? How were such interventions received? What were the ramification of such direct / public actions for these women?
Suggested topics may include but are not limited to: “in defence of” and other activist texts; literary or visual representations of ‘illustrious women’ cycles; conduct manuals or advice texts written by women for women; women educators; political tracts/political activism by women; and philosophical or religious writing on the role and nature of women.
Particularly welcome are papers on un- or understudied women, and non-Eurocentric approaches. Papers from all disciplines will be considered.
Please submit 200-word proposals to Sarah Schell (sschell@aud.edu) and Tabitha Kenlon (tkenlon@aud.edu). Please include your name, email address, institutional affiliation, title of paper, and a brief CV. Feel free to email with any questions.
Deadline: July 25th, 2018
WOMEN IN FRENCH UK 15th BIENNIAL CONFERENCE (WiF UK / CCWW)
INTERVENANTE INVITÉE : Leïla Slimani
APPEL À COMMUNICATIONS
Le thème « femmes et pouvoir » revêt une pertinence particulière dans le contexte de la France d’aujourd’hui. Cinquante ans après les événements de mai 68, la société française est en train de vivre une nouvelle vague de mouvements revendicatifs tels que « La Barbe », ou, plus récemment, la campagne « Balance ton porc » contre le harcèlement sexuel et le sexisme dans la vie publique. De la même manière, l’écriture féministe française a joué un rôle déterminant en lançant un défi aux normes littéraires, sociales et sexuelles du patriarcat et beaucoup d’écrivaines francophones continuent à repousser les limites dans leur façon de représenter les rapports de force qui s’inscrivent dans le vécu féminin. Mais où précisément se situe le pouvoir dans la société française contemporaine ? De quelle manière le pouvoir est-il genré et que nous révèlent ses lignes de faille, dans leurs déplacements même, à propos de l’accession et du maintien des femmes au pouvoir ? Est-il possible de réconcilier l’objectif d’une « égalité dans la différence » porté par certains courants féministes avec une société réellement égalitaire et qui partage le pouvoir ? Comment se manifestent les rapports variés des femmes au pouvoir, en fonction de leur classe, de leur génération ou de leur ethnicité ? Et quelles sont les épreuves et même les contradictions vécues par les femmes au pouvoir ? Ce colloque s’intéressera aux manifestations historiques et contemporaines du pouvoir (et de l’impuissance) des femmes, à leur accès au pouvoir et aux formes de leur marginalisation, pour mieux explorer un sujet insuffisamment étudié jusqu’à présent. Parce que les organisatrices de ce colloque soutiennent que ce vaste thème de recherches sera mieux servi par des approches interdisciplinaires, les propositions de communications et de séances de disciplines diverses seront donc particulièrement appréciées, tout comme les contributions de doctorantes et celles de chercheuses venant de l’étranger. Les communications ne dépasseront pas 20 minutes.
Nous proposons les champs de travail suivants, mais la liste n’est pas exhaustive :
Espaces du pouvoir (y compris virtuels, médiatiques et quotidiens)
Femmes et pouvoir dans la théorie et la pensée
Femmes dans le domaine politique (par exemple, la parité, les politiques publiques, le militantisme)
Femmes et monde du travail (y compris universitaire)
Femmes et médias (par exemple, les maisons d’éditions gérées par les femmes, les metteuses en scène, les traductrices)
Femmes et pouvoir dans la littérature et le cinéma
Femmes, corps et réalités corporelles (par exemple, le sexe, la sexualité, la violence, les politiques de la reproduction)
Pouvoir, langage et voix (par exemple, l’éloquence, le rire) ou impossibilité de se faire entendre
Pouvoir et marginalisation (par exemple, le colonialisme, le postcolonialisme, l’ethnicité)
Pouvoir et cycle de vie (par exemple, l’enfance, l’adolescence, la maternité, la vieillesse)
Par ailleurs, WiF au Royaume-Uni est uni depuis 2017 par un partenariat avec WiF en Amérique du Nord autour du programme « Un Livre, un WiF ». Le projet vise à encourager la collaboration entre les deux associations lors de leurs deux colloques respectifs. Par cette démarche, nous espérons attirer l’attention critique sur le travail d’écrivaines de langue française qui n’ont pas encore acquis la notoriété, en France ou dans le monde francophone. Pour ce colloque, c’est l’écrivaine Claire Legendre qui est proposée, et le livre choisi sera L’Écorchée vive (2009) : toutes les propositions de communications ou de séances qui traitent de cette écrivaine sont les bienvenues.
Ce colloque est organisé en association avec le « Centre for the Study of Contemporary Women’s Writing » (CCWW), qui fait partie de l’Institute for Modern Languages Research à l’université de Londres.
Les propositions de communications, ou de séances entières (chaque séance consistera en trois communications), rédigées en anglais ou en français (300 mots maximum), devront parvenir AUX TROIS CO-ORGANISATRICES DU COLLOQUE (adresses ci-dessous) au plus tard le 1er septembre 2018. Les propositions devront être accompagnées d’une courte biographie (maximum 100 mots) ainsi que d’une affiliation institutionnelle.
Shirley Jordan : shirley.jordan@newcastle.ac.uk
Siobhán McIlvanney : siobhan.mcilvanney@kcl.ac.uk
Jackie Clark : Jackie.clarke@glasgow.ac.uk
a mélancolie face aux crises de l’histoire.
Valeurs esthétiques et politiques d’un rapport au temps (XVIe-XXIe siècles)
Colloque organisé par Anne Teulade
les 6-7 juin 2019 à l’université de Nantes,
avec le soutien de l’Institut Universitaire de France.
À travers ce colloque, on se propose de réfléchir sur l’état mélancolique en tant que rapport au temps. La mélancolie est favorisée par les périodes de rupture et de changement violent de paradigme historique ou politique ; elle résulte d’une prise de conscience aiguë des mutations que ces crises entraînent. Cette association entre mélancolie et conscience du temps est connue s’agissant de la mélancolie romantique – qui est fréquemment corrélée au désenchantement face à l’histoire – et pour les périodes contemporaines, mais elle mérite d’être approfondie pour les XVIe et XVIIe siècles, période de transition où se superposent plusieurs strates de la pensée mélancolique. Au cœur de cette recomposition, la conscience du temps présent est vive, et l’on peut affiner l’idée selon laquelle le XVIIe siècle marquerait une évolution de la conception de la mélancolie, allant de l’affection morbide vers une affliction morale associée à la nostalgie[1]. En effet, cette conception mélancolique du temps n’est pas seulement un sentiment de perte et de rêverie sur le passé, elle peut adopter une tournure plus précise, dirigée contre le temps présent et les développements historiques qui l’ont forgée. La mélancolie des ruines et la déploration de la perte évoquées par Walter Benjamin à propos du drame silésien[2], tout comme la « mélancolie d’anachronisme[3] » mobilisée par Marc Vitse à propos du Siècle d’Or espagnol, constituent une piste à creuser pour penser plus largement la mélancolie de la première modernité comme rapport au temps, et la situer par rapport aux périodes ultérieures.
Ainsi, de la fin du féodalisme à l’écroulement des utopies communautaires[4], en passant par les nouveaux régimes du début du XIXe siècle[5] et le hiatus insondable provoqué par la Shoah[6], nombreux sont les moments qui occasionnent l’émergence d’une mélancolie prise en charge par les arts. On notera d’ailleurs que la mélancolie est plus largement motivée dans les œuvres par des changements de paradigmes temporels : les divers moments de confrontation à des modernités pensées comme des failles sont vécus de manière souvent aussi violente que les catastrophes[7].
À travers ce colloque, on souhaiterait approfondir le sens des liens entre mélancolie et crises de l’histoire :
- Revenir sur le rapport entre mélancolie et rapport au temps, en examinant ses formes et la façon dont il se dit dans les textes : est-il figuré par des personnages, par la figure auctoriale, se modélise dans genres particuliers, poésie épique, lyrique, tragédie, drame, roman comique, roman pastoral, essai, etc. ? Et engendre-t-il des inflexions génériques singulières ?
- Penser la relation entre le changement de régime d’historicité et la mélancolie, en s’attachant aux particularités de chaque période. La mélancolie semble associée aux différents moments qualifiés de « modernes ». Qu’en est-il, et comment interroger à nouveaux frais ce rapport entre mélancolie et modernité ?
- Articuler l’état mélancolique et la construction d’une conscience individuelle. Quels types de subjectivation s’élaborent dans la psyché mélancolique : un solipsisme anomique, une folie réversible, un for intérieur procédant d’une séparation avec la pensée du groupe, une subjectivité entée sur la mémoire ? Et lorsque c’est la figure auctoriale qui endosse la posture mélancolique, comment celle-ci s’élabore-t-elle ?
- Interroger la puissance créatrice de la mémoire mélancolique : de quelles esthétiques cette pensée hantée par les spectres et les images est-elle porteuse ?
- Explorer la traduction politique du refus de faire le deuil du passé : l’anachronisme est-il présenté comme négativité pathologique ou apparaît-il porteur de valeurs utopiques ou positives ? Comment le sujet mélancolique oscille-t-il entre réaction et révolution, entre aveuglement au présent et dissidence ?
Ces approches pourront être développées à partir d’œuvres d’art s’inscrivant dans un empan chronologique large, depuis les textes de Montaigne et Cervantès, jusqu’à Treme (David Simon/Eric Ovemeyer) ou La Villa de Robert Guédiguian.
*
Les propositions (d’environ 2000 signes et assorties d’une courte notice bio-bibliographique) devront être adressées à anne.teulade@univ-nantes.fr, avant le 30 septembre 2018.
[1] Patrick Dandrey, « Nostalgie et mélancolie : de l’affection morbide à l’affliction morale », dans De la mélancolie. Les entretiens de la fondation des Treilles, Paris, Gallimard, 2007, p. 95-129.
[2] Walter Benjamin, Origine du drame baroque allemand, Paris, Flammarion, Champs, 1985 [éd. originale 1974], p. 153-169.
[3] Marc Vitse, Éléments pour une théorie du théâtre espagnol du XVIIe siècle, Toulouse, PUM, 1990, p. 381, notamment à propos du Chevalier d’Olmedo de Lope de Vega.
[4] Michelle Perrot, Mélancolie ouvrière, « Je suis entrée comme apprentie, j’avais alors douze ans », Lucie Baud, 1908, Grasset, 2012 ; Enzo Traverso, Mélancolie de gauche. La force d’une tradition cachée (XIXe-XXIe siècles), La Découverte, 2016.
[5] Voir notamment Anne Larue, Romantisme et mélancolie. Le Journal de Delacroix, Champion, 1998 ; Michael Löwvy et Robert Sayre, Révolte et mélancolie. Le Romantisme à contre-courant de la modernité, Payot, 1992 ; Jean-François Hamel, « Les uchronies fantômes. Poétique de l’histoire et mélancolie du progrès chez Louis-Sébastien Mercier et Victor Hugo », Poétique, 144, 2005/4, p. 429-441 ; Stéphanie Genand, La Chambre noire. Germaine de Staël et la pensée du négatif, Genève, Droz, « Histoire des idées et critique littéraire », 2017, p. 301-307.
[6] Régine Waintrater, « La temporalité mélancolique », dans Luba Jurgenson et Alexandre Prstojevic (dir.), Des témoins aux héritiers, l’écriture de la Shoah et la culture européenne, Éditions Pétra, « Usages de la mémoire », 2012, p. 261-273 ; Raphaëlle Guidée, « Politique de la catastrophe : mélancolie et dépolitisation de l’histoire dans l’œuvre de W.G. Sebald », Europe, 109, mai 2013, p. 53-67 ; Muriel Pic (dir. ), Politique de la mélancolie. À propos de W.G. Sebald, Les Presses du Réel, 2016.
[7] Catherine Coquio, « La ‘Baudelairité’ décadente, un modèle spectral », Romantisme, 82, 1993, p. 91-107 et L’Art contre l’art. Baudelaire, le « joujou » moderne et la « décadence », Vallongues, 2005 ; Jean-François Hamel, Revenances de l’histoire. Répétition, narrativité, modernité, Éditions de Minuit, 2006 ; Karine Winkelvoss, « Trakl et les fantômes. Mélancolie, survivance, métamorphose », Europe, 984, avril 2011, p. 83-95 ; Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire, trad. Olivier Mannoni, préf. Patrick Boucheron, Payot, 2013, p. Miguel Abensour, Les Passages Blanqui. Walter Benjamin entre mélancolie et révolution, Sens&Tonka éditeurs, 2013, p. 57-71.
Source: Fabula
Cambridge, les 9 et 10 janvier 2019
Si l’histoire de l’Europe est essentiellement celle d’États monarchiques, les monarchies encore en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ne ressemblent plus guère à celles qui régissaient le continent à la fin du Moyen Âge. L’époque contemporaine a transformé la monarchie comme état de fait en une opinion, dans le même mouvement qui faisait basculer un monde marqué par l’omniprésence du sacré vers un autre marqué par celle du profane. Les désignants ont pu demeurer inchangés – tout comme se sont perpétués familles, domaines et résidences princières -, mais leur sens s’est modifié en profondeur au fil des siècles et au gré des pays, transformant les mécanismes et les fonctions du pouvoir monarchique comme sa substance même.
Les approches spéculatives et conceptuelles ont peu étudié la signification de la monarchie comme notion complexe, du fait notamment des cloisonnements disciplinaires. La science politique, l’histoire des idées, l’histoire du droit et la critique littéraire l’appréhendent souvent comme un sujet subalterne, tandis que les historiens tendent pour leur part à privilégier la stricte chronologie au détriment des concepts. C’est en partie la nature de la monarchie en soi qui a pu susciter pareilles divergences. Le fondement semi-magique et providentialiste du droit divin, en particulier, contribue à présenter l’idée monarchique comme un paradoxe : celui d’une théorie politique à la fois anti-politique et anti-théorique. Ce colloque se propose, pour la première fois, de rompre ces barrières disciplinaires en croisant les perspectives de spécialistes de la monarchie avec celles de chercheurs en histoire sociale, culturelle, politique, et en anthropologie.
Partant du postulat selon lequel les épisodes critiques sont spécifiquement propices à la lecture de cours des événements et des évolutions marquées, trois (longs) temps forts de l’histoire des monarchies européennes seront privilégiés : la Révolution anglaise, la Révolution française, la généralisation enfin du modèle républicain dans la première moitié du XXe siècle. Ces trois moments ne constituent cependant que des pôles de référence possibles ; les communications abordant les questions de la réinvention, de la représentation ou encore de la conceptualisation de la monarchie pour d’autres périodes, du XVIe siècle à nos jours, seront les bienvenues. Des sujets d’histoire moderne pourront ainsi fournir une matière introductive, et d’autres, plus contemporains, une matière conclusive à nos discussions.
Deux approches sont prioritairement encouragées : l’une se concentrant sur la signification politique de la monarchie, l’autre sur sa signification socioculturelle, psychologique, religieuse, voire spirituelle. L’approche politico-juridique peut embrasser des thèmes tels que la relation historique des monarchies européennes avec les cadres légaux, administratifs et juridiques, ainsi qu’avec les traditions démocratiques, républicaines et aristocratiques. Les perspectives théologiques, sociologiques et anthropologiques s’attacheront quant à elles à considérer la monarchie comme un ensemble de rituels et de processus informels exprimant et donnant à voir la souveraineté, organisant la temporalité et les rapports humains, offrant aux nations un ancrage identitaire et plaçant les individus dans une situation de contact affectif avec les espaces du sacré et avec la sacralité du pouvoir, en particulier dans la représentation qu’en donnent les religions catholique et protestante.
Des études portant sur des monarchies extra-européennes pourront être acceptées, en relation toutefois avec la monarchie européenne.
Les communications pourront s’inscrire dans un ou plusieurs des axes suivants :
La monarchie dans la pensée politique ;
Monarchie et constitution;
La monarchie dans sa relation avec la religion, la théologie et le spirituel ;
La relation entre les pouvoirs spirituels et temporels ;
Royalisme et monarchisme;
La représentation de la nation et de la souveraineté ;
L’imaginaire royal et les représentations de la monarchie, y compris dans la littérature ;
Monarchie et propriété ;
La monarchie et la culture matérielle, l’art, la mode, l’espace ;
Fêtes royales, rituels royaux, processions et célébrations ;
Les femmes dans la monarchie;
Les monarchies extra-européennes, de préférence en rapport avec la monarchie européenne.
*
La durée des communications sera de 20 minutes. Les versions écrites seront soumises à expertise par des spécialistes en vue de la publication d’actes du colloque. Les doctorants sont également invités à participer, et les communications en allemand, anglais, espagnol, français, italien, portugais et hollandais seront acceptées, avec toutefois une préférence pour l’anglais.
Le colloque aura lieu à l’université de Cambridge les 9 et 10 janvier 2019.
Les propositions (200 mots) sont à envoyer, accompagnées d’un CV synthétique d’une page, aux deux adresses suivantes avant le 15 août 2018 :
Carolina Armenteros: cra22@cam.ac.uk
Flavien Bertran de Balanda : flavien.bertran-de-balanda@laposte.net
Source: Fabula
New Publications
Narrations fabuleuses Mélanges en l’honneur de Mireille Huchon (souscription)
|
|||||
|
|
Lettres de femmes Textes inédits et oubliés du xvie au xviiie siècle, éd. Goldsmith (Elizabeth C.), Winn (Colette H.)
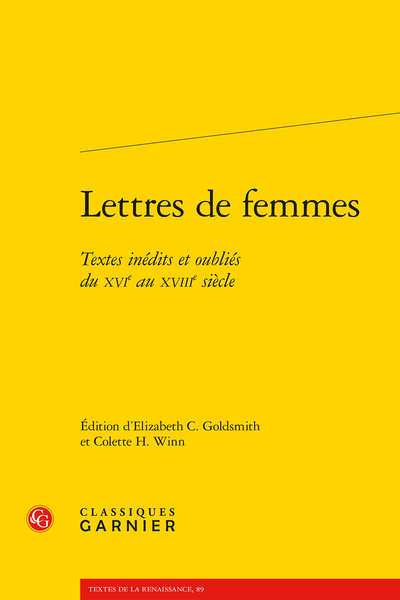 Lettres de femmes Textes inédits et oubliés du xvie au xviiie siècle, éd. Goldsmith (Elizabeth C.), Winn (Colette H.), Paris, Classiques Garnier, (2005) 2022.
Lettres de femmes Textes inédits et oubliés du xvie au xviiie siècle, éd. Goldsmith (Elizabeth C.), Winn (Colette H.), Paris, Classiques Garnier, (2005) 2022.
Le présent ouvrage entend mettre en relief l’apport fondamental des femmes dans le développement de l’art épistolaire. Il réunit un choix de lettres qui n’ont jamais été rééditées depuis leur première parution ou qui n’ont été que partiellement reproduites au xixe siècle.
Disponible en librairie et sur le site de l'éditeur.
Nombre de pages: XLII-448
Parution: 09/02/202
Réimpression de l’édition de: 2005
Collection: Textes de la Renaissance, n° 89
ISBN: 978-2-406-12886-1
ISSN: 1262-2842
David Matteini (trad. Patrick Graille), Lumières et enthousiasme. Histoire d’une idée anthropologique
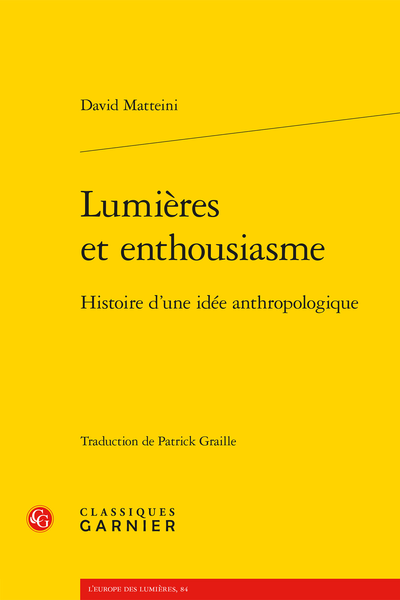 David Matteini (trad. Patrick Graille), Lumières et enthousiasme. Histoire d’une idée anthropologique, Paris, Classiques Garnier, 2022.
David Matteini (trad. Patrick Graille), Lumières et enthousiasme. Histoire d’une idée anthropologique, Paris, Classiques Garnier, 2022.
Depuis l’Antiquité, l’enthousiasme a été une idée discutée par les philosophes, les poètes, les hommes politiques. À l’époque des Lumières, le débat sur l’enthousiasme exacerbe le caractère protéiforme des mentalités et enrichit le concept de nouvelles connotations socio-anthropologiques.
Disponible en librairie et sur le site de l'éditeur.
Nombre de pages: 258
Parution: 09/02/2022
Collection: L'Europe des Lumières, n° 84
ISBN: 978-2-406-12636-2
ISSN: 2104-6395
L’Humanisme juridique Aspects d’un phénomène intellectuel européen (dir. Xavier Prevost et Luigi-Alberto Sanchi)
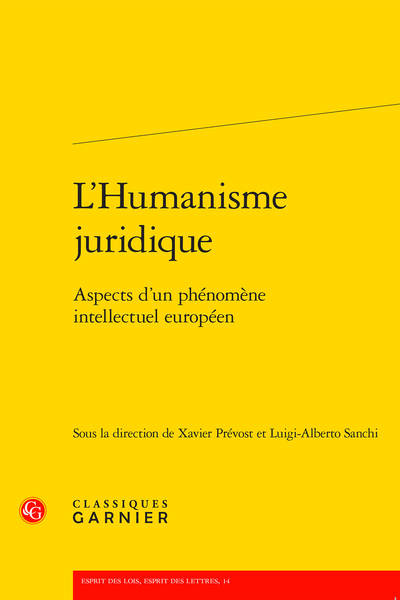 L’Humanisme juridique. Aspects d’un phénomène intellectuel européen, dir. Xavier Prevost et Luigi-Alberto Sanchi, Paris, Classiques Garnier, 2022.
L’Humanisme juridique. Aspects d’un phénomène intellectuel européen, dir. Xavier Prevost et Luigi-Alberto Sanchi, Paris, Classiques Garnier, 2022.
Les spécialistes que réunit ce volume illustrent des aspects essentiels de la naissance et du développement de l’humanisme juridique. Ce courant européen où la philologie s’allie à l’histoire a été particulièrement vital et fécond dans la France de la Renaissance.
Extrait
« Si l’on voulait expliciter ce que l’expression Humanisme juridique recouvre, il conviendrait de cerner deux aspects principaux : il s’agit certes, avant tout, d’une approche humaniste – c’est- à-dire grammaticale, philologique et historique – à l’étude des sources juridiques ; mais on considère en outre, réciproquement, la contribution des juristes à l’Humanisme : l’apport du droit, de la forma mentis et du langage juridique, à l’univers intellectuel propre à l’Humanisme. Dans ses Annotations aux Pandectes, Guillaume Budé illustre ces deux approches complémentaires et révèle les prémices de l’école érudite française, bientôt appelée mos Gallicus iura docendi. Cette philologie s’applique rigoureusement aux textes juridiques romains impériaux, mais Budé convoque dans son travail un grand nombre d’auteurs antiques et médiévaux ressortissant aux genres les plus divers et fait ainsi preuve d’une curiosité et d’une compétence encyclopédiques. »
Enluminure : Guillaume Budé écrivant dans son cabinet sous l’égide de Mercure et Philologie, De l’Institution du Prince, Paris, bibliothèque de l’Arsenal. Crédits : Bibliothèque nationale de France
Disponible en librairie et sur le site de l'éditeur.
Nombre de pages: 429
Parution: 09/02/2022
Collection: Esprit des Lois, Esprit des Lettres, n° 14
ISBN: 978-2-406-11799-5
ISSN: 2261-0324
DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-11801-5
Molière, Le Dépit amoureux, Les Précieuses ridicules (Éd. Charles Mazouer)
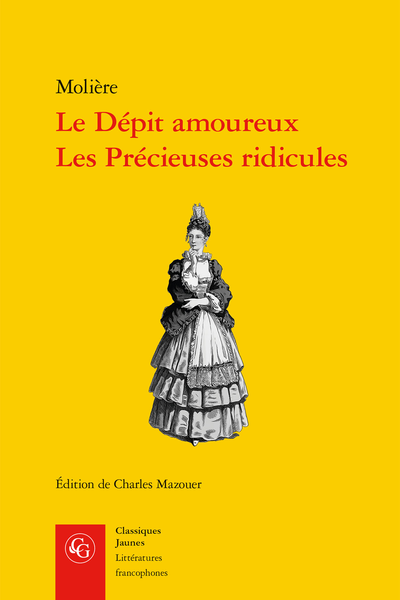 Molière, Le Dépit amoureux, Les Précieuses ridicules, Éd. Charles Mazouer, Paris, Classiques Garnier, coll. Classiques jaunes, février 2022, 289 p.
Molière, Le Dépit amoureux, Les Précieuses ridicules, Éd. Charles Mazouer, Paris, Classiques Garnier, coll. Classiques jaunes, février 2022, 289 p.
Arrivée dans la capitale en juillet 1658, la troupe de Molière reprend Le Dépit amoureux, créé à Béziers en décembre 1655. Mais le coup d’éclat parisien vient du formidable succès des Précieuses ridicules, en novembre 1659. La caricature et le burlesque s’y adossent à la réalité sociale de la préciosité et de la galanterie. Ce volume s'inscrit dans la publication du nouveau Théâtre complet de Molière (2022-2023).
Disponible en librairie et sur le site de l'éditeur.
ISBN: 978-2-406-12435-1
ISSN: 2417-6400
DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-12436-8
Éditeur: Classiques Garnier
Mise en ligne: 09/02/2022





