Université de Nantes, CRINI
Si les magiciennes sont nommées (Alcina, Morgana, Médée, Circée), les femmes accusées de sorcellerie diabolique aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles restent anonymes jusqu’à ce qu’elles soient dénoncées et que leur identité soit déclinée dans les procès pour sorcellerie. Dans ces mêmes procès, plusieurs paramètres sont motifs d’accusation et parmi ceux-ci le corps de la sorcière sur lequel se trouvent les stigmates révélateurs de son appartenance à l’engeance démoniaque.
La magicienne relève plus de la mythologie, de la fiction, tandis que la sorcière diabolique appartient à une réalité paysanne. Le corps de la sorcière moderne est présenté par les démonologues comme un corps hors norme puisqu’il reflète des actions transgressives et marginales. Quelles sont alors les représentations physiques de la sorcière et de la magicienne ? La première est souvent laide et âgée tandis que la seconde est jeune et belle, mais cette polarisation n’est pas systématique. Leur apparence change au fil des siècles et se juxtapose aux changements sociétaux. Le corps se fait miroir du monde ; le rapport entre société et corporalité prend ici tout son sens et met en lumière le paradoxe du corps féminin, victime de conceptions misogynes héritées de l’Ève pécheresse. Sorcières et magiciennes sont des « hommasses », des « viragos » qui bouleversent les codes archétypaux de la société patriarcale.
La sorcière et la magicienne remettent en question la hiérarchisation des sexes et contribuent à diffuser une peur du corps féminin méconnu des hommes scientifiques. La représentation du corps de la sorcière et de la magicienne – décrié et condamné ou élevé et idéalisé – présente dans tous les types de discours se révèle être profondément liée à l’histoire de la construction et de l’affirmation du pouvoir.
Cette journée d’étude est le premier volet d’une réflexion qui souhaite s’inscrire dans les études de genre et la vision du corps considéré comme hors norme, monstrueux, marginal. Cette première partie consacrée au corps des sorcières et des magiciennes accueillera des communications relevant des domaines linguistique, historique, littéraire, artistique, juridique. Elle portera sur les représentations iconographiques, textuelles de ces femmes et « nonfemmes » attirantes ou repoussantes en Europe occidentale. La langue de communication sera le français. Les articles issus de cette journée pourront donner lieu à une publication commune au second volet moderne et contemporain.
Modalités : La journée d’étude aura lieu à la Faculté des langues étrangères (FLCE) de Nantes le jeudi 13 juin 2019. Les propositions de communication (environ 500 mots accompagnés d’une courte biographie) doivent être envoyées simultanément à Ana Condé : ana.conde@univ-nantes.fr et Émilie Lehours : emilie.lehours@univ-nantes.fr avant le 10 mars 2019.




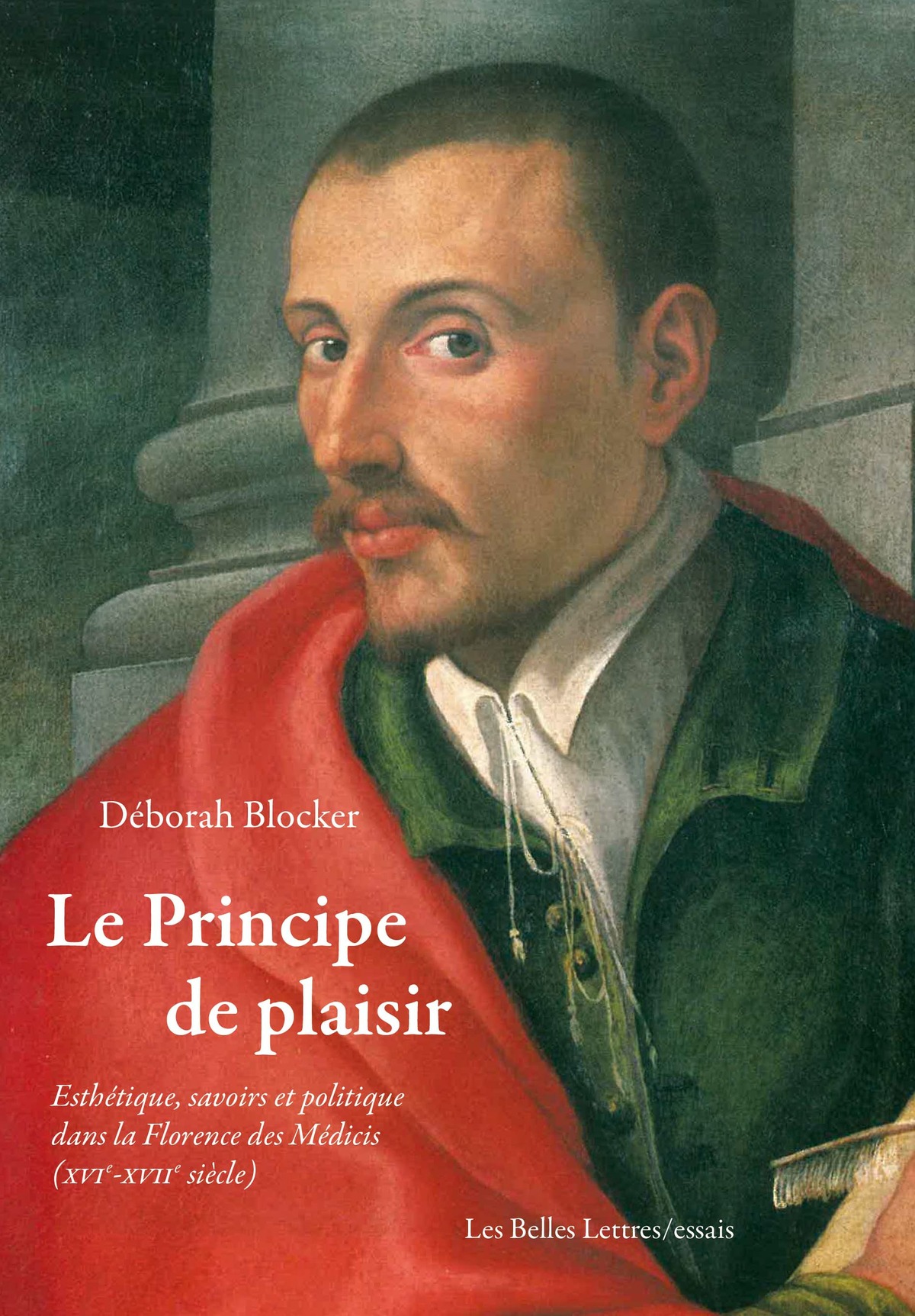 Le Principe de plaisir. Esthétique, savoirs et politique dans la Florence des Médicis (XVIe-XVIIe siècle)
Le Principe de plaisir. Esthétique, savoirs et politique dans la Florence des Médicis (XVIe-XVIIe siècle)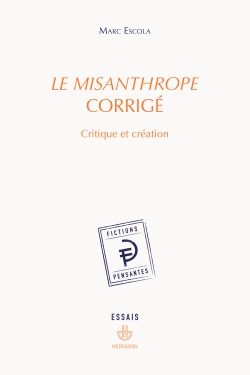 Marc Escola, Le Misanthrope corrigé. Critique et création, Paris : Hermann, coll. « Fictions Pensantes », 2021, 196 p., EAN 9791037014474.
Marc Escola, Le Misanthrope corrigé. Critique et création, Paris : Hermann, coll. « Fictions Pensantes », 2021, 196 p., EAN 9791037014474. Les Métamorphoses du ballet. Histoire et identité d'un genre lyrique (XVIIe-XVIIIe siècles), études réunies et présentées par Alexandre De Craim et Thomas Soury, Aedam Musica, 2022.
Les Métamorphoses du ballet. Histoire et identité d'un genre lyrique (XVIIe-XVIIIe siècles), études réunies et présentées par Alexandre De Craim et Thomas Soury, Aedam Musica, 2022.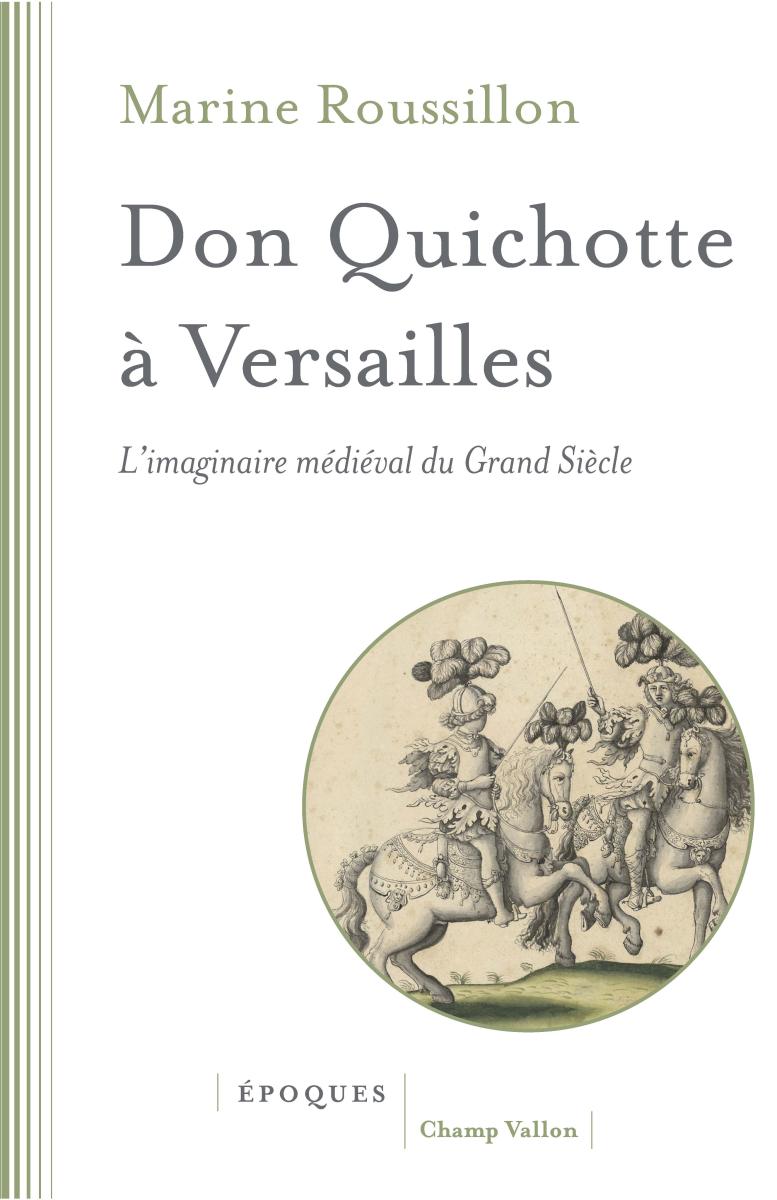 Marine Roussillon, Don Quichotte à Versailles. L'Imaginaire médiéval du Grand Siècle, Paris, Champ Vallon, 2022.
Marine Roussillon, Don Quichotte à Versailles. L'Imaginaire médiéval du Grand Siècle, Paris, Champ Vallon, 2022.