(Centre des Sciences des Littératures en Langue Française, Université Paris Nanterre)
23 mai 2019
Appel à communication (date limite : 28 février 2019)
Cette journée d'étude, qui s’inscrit dans la continuité du séminaire des doctorants du CSLF, entend mettre à l'épreuve la notion d'invention, qu’il s’agisse de découverte ou de création. Il serait aisé de penser que le sens rhétorique d'inventio, tel qu'on le trouve théorisé chez les anciens [Cicéron, Quintilien], précède le sens de création ex nihilo, d’œuvre originale, que l'on relie plus volontiers au basculement vers la modernité, des Belles-Lettres à la Littérature. En effet, l'inventio latine, première partie de la rhétorique, consiste à puiser des arguments dans un fonds de lieux communs préexistants, et cette définition serait dominante durant toute la période classique, laquelle se fixe pour première règle de l'art l'imitation des anciens. L'invention, non plus comme imitation ou comme reprise, mais comme création d'un objet neuf, original, en rupture avec la tradition, serait dès lors une notion moderne. C'est selon cette dernière acception, valorisée dans nos conceptions actuelles, que l'invention devient un critère de sélection et d'appréciation des œuvres, que l'on applique volontiers à l'ensemble du corpus littéraire, de l'Antiquité à la période la plus contemporaine. Ainsi, telle ou telle œuvre entrerait dans le canon littéraire parce que novatrice par rapport à son temps, tel ou tel texte serait, au baccalauréat par exemple, sélectionné dans une liste de textes à enseigner parce qu'il est « original » et représenterait un écart par rapport à une norme souvent définie a posteriori. Il suffit pour s'en convaincre de se remémorer l'arsenal des « problématiques » qui structurent les explications de texte scolaires : « qu'est-ce qui fait l'originalité de ce poème ? », « en quoi cet incipit s'écarte-t-il des incipits traditionnels ? », « en quoi cet apologue est-il original ? », etc. L'invention, comme grille de lecture et de jugement, touche tous les genres littéraires et artistiques et toutes les époques, en mesurant l'écart d'une création à un canon supposé.
À y regarder de plus près, pourtant, il semble que le point de basculement entre ces deux sens, apparemment opposés, du terme « invention » en littérature ou en art, doit être pensé très différemment. Dès l’Antiquité, on constate que la notion est loin d'être univoque : une ligne de partage se situe entre la tradition platonicienne, qui « suppose un créateur inspiré trouvant, grâce au souffle divin, à la muse ou à son propre génie, les ressources d’une création ex nihilo permettant d’atteindre le sublime » [Léoni] et la tradition rhétorique de l’inventio comme mobilisation de lieux communs préexistants. Dans le premier cas, la faculté mobilisée est l’imagination, dans le second, c’est la mémoire. En langue française, il suffit de consulter les dictionnaires pour constater que les deux acceptions coexistent de façon attestée dès la Renaissance, et que la notion d'invention ne s'y limite pas. Les différents sens du mot « invention » touchent tous au rapport à la réalité, qu'ils désignent le dévoilement d'un déjà-là (sens chrétien d' « invention des reliques », sens scientifique de « découverte »), une faculté à puiser dans un vivier intellectuel préexistant (sens rhétorique) ou la capacité à créer quelque chose à partir d'un modèle, voire à partir de rien, ce dernier sens étant déjà applicable à l’œuvre littéraire et artistique au XVIe siècle. Ce rapport à la réalité se double parfois d'un rapport à la vérité, conférant à la notion d'invention une dimension axiologique : si le Moyen-Âge utilise le terme d'invention pour désigner un acte de tromperie (ruse, expédient), cette connotation s'étend dès le XVe siècle au domaine littéraire, où l'on trouve le sens de « fable » ou de « mensonge », de création dénaturant la réalité. Il existe également un contrepoint mélioratif à cette altération de la vérité : la première moitié du XIIe siècle voit apparaître le sens d'invention comme « merveille », « trouvaille merveilleuse », qui se développe à la Renaissance comme « moyen ingénieux, procédé inventif, action de créer quelque chose de nouveau ».
Ce rapide aperçu des définitions montre que le sens de création artistique et littéraire n'est jamais décroché des autres sens du terme « invention ». D'ailleurs, un nouveau détour par l'univers scolaire permet de confirmer cette ambiguïté : une des épreuves de français au baccalauréat s'intitule « écriture d'invention », alors même que l'objet de cet exercice est plus souvent le pastiche d'auteurs du canon qu'un espace de création libre de toute contrainte alloué aux élèves. La notion d'invention n'est donc nullement devenue univoque, et contrairement à certaines idées reçues, le sens rhétorique conserve une actualité. Ce terme et la valeur qu'on lui accorde s'enrichissent donc à toutes les époques mais restent ambigus. Racine, que l'on considère volontiers comme le parangon du classicisme, écrit dans la préface de Bérénice que « toute l’invention consiste à faire quelque chose de rien » alors même que la critique postérieure le place comme l'un des principaux partisans des Anciens, dans la Querelle des Anciens et des Modernes. Ainsi, toute la question de l’invention semble liée à cette hésitation entre l’absence et la présence d’un déjà-là qui précède l’œuvre nouvelle [Léoni].
À partir de ces réflexions, nous avons défini quelques axes dans lesquels les propositions de communication pourront s'inscrire, sans toutefois s’y limiter :
- « Querelles d'Anciens et de Modernes » : l'invention et le rapport aux modèles.
Quel est le rapport entre invention, imitation et originalité ? Quelles façons d’imiter peuvent-elles être qualifiées d’ « inventives » ? L’invention, au sens de création, est-elle systématiquement l’apanage des « modernes » ? Comment peut-on lier l’invention avec la notion de « génie » ?
- L’invention et le rapport au réel.
L’œuvre d'art imite-t-elle le réel ou doit-elle créer quelque chose de totalement neuf ? Cette question se pose-t-elle avant le XXe siècle ? Dans quelle mesure une injonction à l'originalité se développe-t-elle, et quelles sont ses limites ?
- L'invention comme geste critique.
Comment notre regard analytique invente-t-il ou réinvente-t-il les œuvres du passé selon un prisme contemporain ? Quelles terminologies et quels outils inventer pour appréhender des objets nouveaux ou déjà existants ? Comment l’acte de nommer permet-il de créer de nouvelles catégories d’analyse et comment les auteurs eux-mêmes en usent-ils stratégiquement ?
- Valeurs axiologiques de l'invention.
Si être inventif peut être valorisé, en quoi l’invention peut-elle aussi être un objet de méfiance ? Comment en vient-elle à susciter des soupçons de mensonge ou de manipulation des émotions ?
Les propositions de communication, d’une longueur de 500 à 1000 mots, sont à envoyer pour le 28 février 2019 au plus tard au comité scientifique à l’adresse suivante : fabriquedelinvention@gmail.com, accompagnées d’une courte notice bio-bibliographique.
Les propositions de toutes disciplines seront bienvenues (Histoire, Histoire des Arts, Musicologie, Littérature, Stylistique...).
Les réponses seront données début mars 2019. La journée d’étude aura lieu le jeudi 23 mai 2019 à l’Université Paris Nanterre.
Comité d'organisation: Marianne Albertan-Coppola, Marine Champetier de Ribes, Julia Pont, Hélène Parent, Luce Roudier, Émilien Sermier
BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE
Auerbach (Erich), Mimesis, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1977 [1969].
Barthes (Roland), « L'ancienne rhétorique [Aide-mémoire] », in Communications, 16, 1970. Recherches rhétoriques. pp. 172- 223.
Bertrand (Jean-Pierre), Inventer en littérature. Du poème en prose à l’écriture automatique, Seuil, 2014.
Boirel (René), L'invention, Paris, PUF, 1961.
Broglie (Louis de) & Hadamard (Jacques), L’Invention. (Neuvième semaine internationale de Synthèse), Paris, Alcan, 1938.
Butor (Michel), « La critique et l'invention », Répertoire III, Minuit, 1968.
Cicéron, De l'invention, trad. G. Achard, Paris, Les Belles-Lettres, 1994.
Danétis (Daniel) & Toulouse (Ivan) (dir.), Eurêka, le moment de l’invention. Un dialogue entre art et science, Paris, L’Harmattan, « Arts 8 », 2008.
Della Santa (André), Une culture de l'imagination ou l'invention en rhétorique, Genève, Patio, 1986.
Delon (Michel), L’idée d’énergie au tournant des Lumières (1770-1820), Paris, PUF, coll. « Littératures modernes », 1988.
Fumaroli (Marc), L'Âge de l'éloquence : rhétorique et « res literaria » de la Renaissance au seuil de l'époque classique, Genève, Droz, 1980.
Leoni (Sylviane) (dir.), Les Figures de l’invention, Paris, Classiques Garnier, « Rencontres », 2012.
Martel (Jacinthe), « De l’invention. Eléments pour l’histoire lexicologique et sémantique d’un concept : XVIe-XXe siècles », Études françaises, vol. 26, n° 3, 1990, pp. 29-49.
Mortier (Roland), L’Originalité. Une nouvelle catégorie esthétique au siècle des Lumières, Genève, Droz, 1982.
Schlanger (Judith), L’invention intellectuelle, Paris, Fayard, 1983.
Quintilien, Institution oratoire, III, trad. J. Cousin, Paris, Les Belles-Lettres, t. II, 1976.
Simondon (Gilbert), Imagination et invention (1965-1966), Chatou, Éditions de la Transparence, 2008.
Souriau (Paul), Théorie de l’invention, Paris, Hachette, 1881.
Valéry (Paul), « L’invention esthétique », dans Variété, Œuvres, tome I, édition de Jean Hytier, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1957, pp. 1412-1415.
https://cslf.parisnanterre.fr/
Source : Fabula




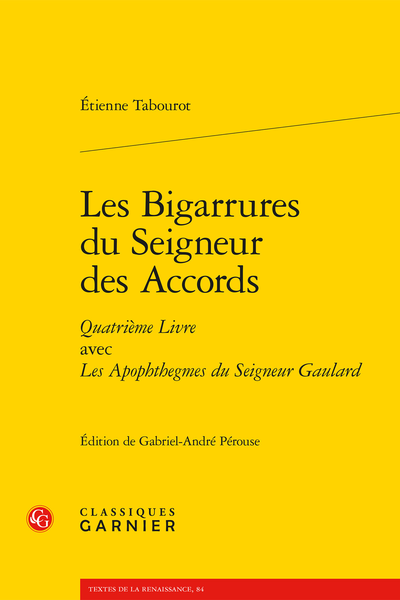 Etienne Tabourot, Les Bigarrures du Seigneur des Accords. Quatrième Livre avec Les Apophthegmes du Seigneur Gaulard, Gabriel-André Pérouse (éd.), Paris, Classiques Garnier, 2022.
Etienne Tabourot, Les Bigarrures du Seigneur des Accords. Quatrième Livre avec Les Apophthegmes du Seigneur Gaulard, Gabriel-André Pérouse (éd.), Paris, Classiques Garnier, 2022.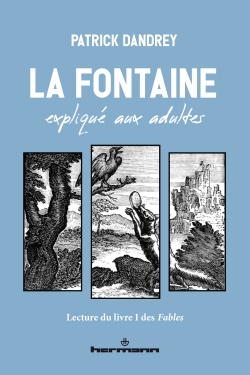 Patrick Dandrey, La Fontaine expliqué aux adultes. Lecture du livre I des Fables, Paris, Hermann, 2022.
Patrick Dandrey, La Fontaine expliqué aux adultes. Lecture du livre I des Fables, Paris, Hermann, 2022.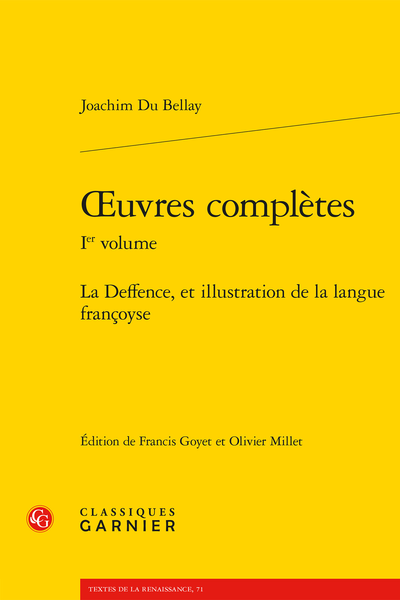 Joachim Du Bellay, Œuvres complètes Ier volume La Deffence, et illustration de la langue françoyse, éd. Goyet (Francis), Millet (Olivier), Paris, Classiques Garnier, 2022.
Joachim Du Bellay, Œuvres complètes Ier volume La Deffence, et illustration de la langue françoyse, éd. Goyet (Francis), Millet (Olivier), Paris, Classiques Garnier, 2022.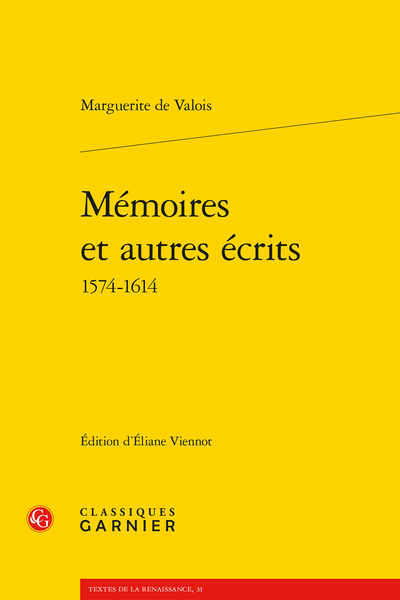 Marguerite de Valois, Mémoires et autres écrits 1574-1614, éd. Eliane Viennot, Paris, Classiques Garnier, (1999) 2022.
Marguerite de Valois, Mémoires et autres écrits 1574-1614, éd. Eliane Viennot, Paris, Classiques Garnier, (1999) 2022.